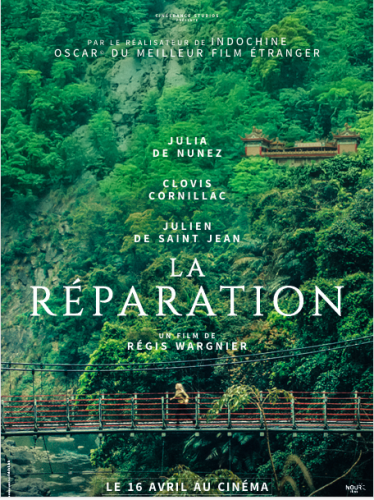Ouverture du 78ème Festival de Cannes et « Partir un jour » de Amélie Bonnin : dansons et chantons sous la pluie…

Il y a quelques jours, je commençais mon article consacré à la sélection officielle de ce 78ème Festival de Cannes (à retrouver ici) par cette citation de Costa-Gavras : « Vous ne pouvez changer la vision politique des gens avec un film, mais vous pouvez au moins engendrer une discussion politique. » La cérémonie d’ouverture de ce 78ème Festival de Cannes, d’une prestigieuse et élégante sobriété, nous rappelait ainsi que le cinéma n’est pas seulement un objet et un sujet de divertissement mais aussi un vecteur d’idées politiques.
Laurent Lafitte, maître des cérémonies de cette 78ème édition, a commencé son discours par un hommage à la lauréate du prix d’interprétation féminine de 1999 pour Rosetta, l’inoubliable et si talentueuse Emilie Dequenne : « Elle est née au Festival de Cannes, sa délicatesse humble et puissante va manquer, j’aimerais dédicacer cette cérémonie d’ouverture à Émilie Dequenne. » Son discours a ensuite principalement rendu hommage aux actrices et aux acteurs, fil directeur de celui-ci, de James Stewart, Jean Gabin, Isabelle Adjani à… Volodymyr Zelensky, nous invitant à imiter leur courage, « par nos discours, nos choix et nos refus, afin d’être à la hauteur de cette phrase de Frank Capra : Seuls les audacieux devraient faire du cinéma. »
Il a aussi mis à l’honneur la sublime (double) affiche de cette année représentant Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant enlacés, dans le chef-d’œuvre de Claude Lelouch, palme d’or 1966, Un homme et une femme : « On se pose toujours la question de savoir si le cinéma peut changer le monde. Mais si on demande au cinéma toujours plus d’inclusivité, de représentativité, de parité, c’est donc bien qu’en effet il peut changer le monde. Et parfois, il suffit de raconter un homme et une femme pour toucher au sublime et à l’universel. »
Il fut ensuite rejoint par les neuf membres du jury international des longs métrages : Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas et Jeremy Strong, et leur présidente : Juliette Binoche, « née actrice dans cette même salle » qui a évoqué les maux du monde actuel, de l’ignominie du 7 octobre, au dérèglement climatique, au drame de Gaza, en rendant hommage à la photojournaliste Fatima Hassouna tuée par un missile et qui, la veille de sa mort, avait appris que le film dans lequel elle figurait ( Put Your Soul on Your Hand and Walk, documentaire de Sepideh Farsi), était sélectionné au Festival de Cannes. « L’art reste, il est le témoignage puissant de nos vies, de nos rêves, et nous, spectateurs, nous l’embrassons. Que le Festival de Cannes, où tout peut basculer, y contribue ! » a-t-elle conclu.
Avec son titre inédit et mélancolique, Mylène Farmer a rendu hommage à David Lynch et bouleversé les festivaliers du Théâtre Lumière.
Leonardo DiCaprio a ensuite rappelé qu'il devait le lancement de sa carrière et sa rencontre avec Martin Scorsese à Robert De Niro à qui il a remis une Palme d’or d’honneur : « Ce soir, j’ai l’insigne honneur d’être devant vous pour rendre hommage à quelqu’un qui est notre modèle. L’œuvre de Robert De Niro se décline dans la façon dont il a inspiré les acteurs à traiter leur métier, pas seulement comme une performance solo, mais comme une transformation. Robert De Niro n’est pas juste un grand acteur, c’est L’Acteur. Avec Martin Scorsese, ils ont raconté les histoires les plus légendaires du cinéma, les histoires sans compromis. Ils n’ont pas seulement fait des films, ils ont redéfini ce que le cinéma pouvait être. Ils ont élevé la relation entre acteurs et réalisateurs au stade d’un creuset de partage des risques. »
Politique, la déclaration de Robert De Niro l’était aussi indéniablement. Vibrante aussi :
« Merci infiniment au Festival de Cannes d’avoir créé cette communauté, cet univers, ce « chez soi « pour ceux qui aiment raconter des histoires sur grand écran. Le Festival est une plateforme d’idées, la célébration de notre travail. Cannes est une terre fertile où se créent de nouveaux projets. Dans mon pays, nous luttons d’arrache-pied pour défendre la démocratie, que nous considérions comme acquise. Cela concerne tout le monde. Car les arts sont, par essence, démocratiques. L’art est inclusif, il réunit les gens. L’art est une quête de la liberté. Il inclut la diversité. C’est pourquoi l’art est une menace aujourd’hui. C’est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes de ce monde. Nous devons agir, et tout de suite. Sans violence, mais avec passion et détermination. Le temps est venu. Tout un chacun qui tient à la liberté doit s’organiser, protester et voter lorsqu’il y a des élections. Ce soir, nous allons montrer notre engagement en rendant hommage aux arts, ainsi qu’à la liberté, à l’égalité et à la fraternité. »
Enfin, c’est avec son enthousiasme légendaire qu’un Quentin Tarantino bondissant a déclaré ouverte cette 78ème édition du Festival de Cannes.

Pour l’ouverture, les sélectionneurs ont eu cette année l’idée judicieuse de choisir un premier film enchanté et enchanteur, Partir un jour d'Amélie Bonnin, idéal pour lancer les festivités, aussi politiques soient-elles. Partir un jour est le premier long-métrage d'Amélie Bonnin, tiré de son court-métrage éponyme, récompensé par le César du meilleur court-métrage de fiction en 2023.
Alors que Cécile (Juliette Armanet) s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique à Paris, et alors qu'elle vient de découvrir qu'elle est enceinte, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse (Bastien Bouillon). Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…
Dès les premières minutes, il se dégage de ce film une justesse qui nous happe, d’autant plus surprenante que les chansons qui traduisent les pensées des personnages pourraient y nuire. Au contraire, elles renforcent ce sentiment, et notre proximité avec leurs émotions, par le réveil de nos propres réminiscences, nous embarquant avec eux d’emblée. Cela commence par Alors on danse de Stromae et se termine par le Partir un jour des 2 be 3 qui donne son titre au film. Entre les deux, des personnages qui se débattent avec leurs regrets, que la réalisatrice filme avec beaucoup de tendresse.
Les scènes chantées ont été enregistrées en direct sur le plateau, sans studio, pour préserver l'authenticité et l'émotion des interprétations, et c’est une entière réussite. Elles ne semblent pas « plaquées » mais s’intègrent parfaitement à l’histoire. La grande majorité des séquences chantées et dansées a par ailleurs été chorégraphiée par Thierry Thieû Niang, ce qui procure beaucoup de fluidité à l’ensemble.
Un film qui allie avec beaucoup d’intelligence la gaieté, la nostalgie, et l’envie d’étreindre le présent, émaillé aussi de belles idées de mises en scène comme un flashback intégrant le présent.
Amélie Bonnin rend aussi un bel hommage à l’universalité des musiques que son long métrage intègre parfaitement au récit comme elles-mêmes s’intègrent à celui de nos vies, à tel point que les premières notes d’une chanson dont nous n’entendrons pas un mot suffit à nous faire comprendre ce qu’un personnage ne parvient pas à formuler.
Si Bastien Bouillon -Une jeune fille qui va bien, La Nuit du 12, Le Comte de Monte-Cristo (que nous retrouverons aussi à Cannes dans la section Cannes Première, dans Connemara de Alex Lutz) nous avait déjà habitués à son talent, qui se confirme ici, dans son étendue, malgré sa coiffure improbable, dans un rôle aux antipodes de ceux dans les films précités, Juliette Armanet nous sidère littéralement par son jeu nuancé et précis, et par sa vitalité qui inonde tout le film. Dominique Blanc et François Rollin, sont tout aussi parfaits dans les rôles des parents de Cécile, l’une complice, et l’autre bougon au cœur tendre. Amandine Dewasmes est particulièrement subtile dans ce rôle d'épouse, faussement aveugle, sur la fragile frontière entre bienveillance et naïveté. Et Tewfik Jallab impose une présence magnétique.
Un film qui ré-enchante le passé, et nous serre le cœur d’une douceur mélancolique, comme un souvenir d’adolescence que le temps n’altère pas mais rend à la fois plus beau et plus douloureux.
Si ce film n’atteint pas la perfection de On connaît la chanson d’Alain Resnais (pour moi un des films les plus brillants et profonds de l’Histoire du cinéma malgré sa légèreté apparente, un mélange subtile –à l’image de la vie – de mélancolie et de légèreté, d’enchantement et de désenchantement, un film à la frontière des émotions et des genres qui témoigne de la grande élégance de son réalisateur, du regard tendre et incisif de ses auteurs et qui nous laisse avec un air à la fois joyeux et nostalgique dans la tête. Un film qui semble entrer dans les cadres et qui justement nous démontre que la vie est plus nuancée et que chacun est forcément plus complexe que la case à laquelle on souhaite le réduire, moins lisse et jovial que l’image « enchantée » qu’il veut se donner) avec lequel certains l’ont comparé, n’oublions pas qu’il s’agit là d’un premier film.
Ce film musical était décidément parfait pour l’ouverture de ce 78ème Festival de Cannes, nous enjoignant à chanter et danser sous la pluie (Alors, on danse ?), donc malgré les maux du monde sur lesquels les films de ce festival seront, comme chaque année, une « fenêtre ouverte ». Une fête du cinéma lucide et engagée, et tant pis si certains y voient là un paradoxe répréhensible. Une danse mélancolique. Peut-être à l’image des films de cette sélection ? Réponse dans quelques jours après le festival en direct duquel je serai la semaine prochaine.