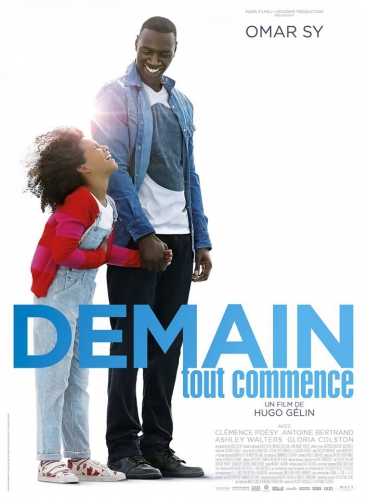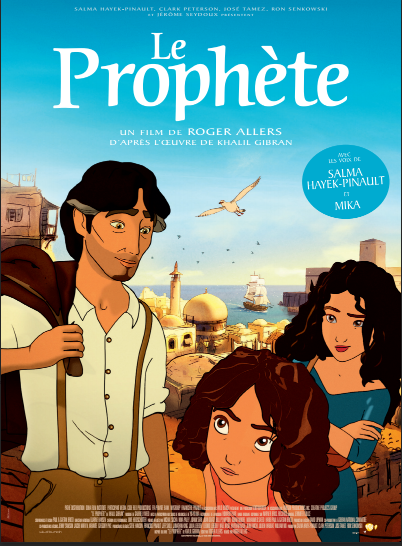Critique - MY SON de Christian Carion (en salles le 03.11.2021)

« Il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï. Seule peut lui être comparée celle du tigre dans la jungle...». C’est au chef-d’œuvre éponyme de Jean-Pierre Melville et à cette citation qui en est extraite que j’ai d’abord songé en sortant de la projection de My son, le nouveau film de Christian Carion, remake de son propre film, Mon garçon (2017).
Certaines « images » de films imprègnent la mémoire. Les premières minutes de Mon garçon imprégnèrent la mienne : le noir sur l’écran et en off le message d’une femme paniquée, sanglotant, annonçant à son ex-mari qu'il était « arrivé quelque chose » à leur enfant. Je me souvenais aussi de cette route sinueuse dans les décors enneigés du Vercors et des déambulations qu’accompagnait la musique sombrement magnétique de Laurent Perez del Mar. Ainsi le film était-il placé d’emblée sous le sceau de la menace, dans une atmosphère oppressante suscitée par cette angoisse absolue, ravageuse, obsédante que représente une disparition mystérieuse, a fortiori celle d’un enfant. L’identification du spectateur était immédiate, dès ces premières secondes, haletantes, le plaçant en empathie avec le protagoniste. Le début de My son est assez similaire (si ce n’est que le père est déjà en plein cauchemar suggéré immédiatement par le cadre et le son) et à l’image de tout le film et de toutes ses composantes (jeu, réalisation, musique, photographie, montage) : plus intense encore.
Pour My son, Christian Carion retrouve ainsi une partie de l'équipe de Mon Garçon : Éric Dumont comme directeur de la photographie, Laurent Perez del Mar comme compositeur et Loïc Lallemand comme chef monteur, en revanche Mélanie Laurent et Guillaume Canet cèdent leurs places à Claire Foy et James McAvoy. Le pitch de My son est lui aussi similaire à celui de Mon garçon. Edmond Murray (James McAvoy), divorcé, s’est éloigné de son ex-femme (Claire Foy) et de son fils de 7 ans pour poursuivre une carrière internationale tout comme Julien (Guillaume Canet) s’était éloigné de son ex-épouse (Mélanie Laurent). Lorsque le garçon disparaît, son père revient précipitamment là où résident ces derniers. Murray va se montrer prêt à tout pour retrouver son fils, apparemment kidnappé. Il se lance alors dans une traque insatiable et acharnée dans les Highlands où est déplacée l’action qui se situait dans le Vercors dans la première version.
La (magnifique) affiche donne déjà le ton. Elle met en scène les deux parents dos à dos qui regardent dans des directions divergentes. Le regard de la mère semble perdu et résigné tandis que celui du père est déterminé et enragé. Leur image se reflète dans les eaux tourmentées du lac avec, intercalée, fantomatique, celle du fils disparu. Le tout dans le décor grisâtre des Highlands avec, en surimpression, cette accroche « Jusqu’où iriez-vous pour retrouver votre enfant ?».
Comme dans Le Samouraï (d’où ma comparaison initiale) mais aussi « L’armée des ombres » d’ailleurs, la claustrophobie psychique des personnages se reflète dans les lieux de l’action (les Highlands) et est renforcée d’une part par le silence, le secret qui entoure cette action et, d’autre part, par les « couleurs», souvent proches du noir et blanc et de l’obscurité. Comme dans les deux films précités de Melville, le film de Christian Carion est en effet auréolé d’une lumière grisonnante, froide, nocturne, comme l’étaient les ombres de l’armée de Melville, condamnées à la clandestinité pour agir. Tout comme le sont les films de Melville, My son pourrait être un hommage aux polars américains auxquels fait aussi songer cette pluie incessante qui renforce ce sentiment d'insécurité.
Les paysages grandioses, sauvages et inquiétants constituent aussi un personnage à part entière rappelant les immenses étendues désertes des westerns, notamment de John Ford. Comme dans la scène mythique de La mort aux trousses d’Hitchcock quand Thornhill (Cary Grant) se retrouve poursuivi par un avion au milieu d’une vaste étendue baignée de lumière, scène qui inverse les codes habituels des poursuites dans les thrillers (qui se déroulent en général dans des rues sombres et étroites), ici également les décors immenses et déserts des Highlands renforcent paradoxalement le sentiment de claustrophobie. On se souvient aussi des scènes de Skyfall de Sam Mendes tournées dans cette même région écossaise avec ces paysages abandonnés d’une tristesse et d’une beauté étrangement ensorcelante. La mélancolie menaçante de ce décor naturel est par ailleurs soulignée par la photographie d’Éric Dumont. La musique, lancinante et obsédante telle la douleur que ressent Edmond Murray mais aussi telle la rage obstinée qui le guide, la renforce aussi, ainsi que le sentiment d’angoisse.
Après Une hirondelle a fait le printemps (2001), Joyeux Noël (2005), L’affaire Farewell (2009) et En mai, fais ce qu’il te plaît (2014), Christian Carion réalisait Mon garçon tourné en six jours seulement. Là n'était pas la seule originalité de ce tournage puisque le comédien principal (Guillaume Canet) ne connaissait pas le scénario, simplement quelques éléments du passé de son personnage. My son reprend ce dispositif original. Dans ce film tourné en 8 jours, James McAvoy devait également improviser en fonction des situations qui se présentaient à lui, ce qui a transformé ce tournage en expérience unique, insolite et perturbante, repoussant et interrogeant les frontières entre réalité et fiction. Il serait cependant réducteur de résumer ce film à ce dispositif qui n'est d'ailleurs pas un simple gadget mais qui apporte une véritable intensité qui va crescendo jusqu'au dénouement.
Grâce au scénario ciselé de Laure Irrmann et Christian Carion, le film est en effet habilement construit pour accroître la tension, mettant en scène des personnages ambivalents. Pour en revenir à Melville, cela me rappelle ainsi le « Tous coupables » prononcé par l’inspecteur général des services (Paul Amiot) au commissaire Mattei (Bourvil) dans Le Cercle rouge (« - Vous voulez rire. Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents mais ça ne dure pas. »), paroxysme du film noir, polar exemplaire qui a inventé un genre (le film melvillien avec ses personnages solitaires) mais aussi un style, épuré, d’une beauté rigoureuse et froide telle celle que la photographie d'Éric Dumont procure au film de Christian Carion. Edmond Murray, en plus de sa quête effrénée de guerrier solitaire (ou de «samouraï»...), doit aussi se confronter à l'obséquieux compagnon de son ex-femme obsédé par la construction de sa nouvelle maison mais aussi à sa propre culpabilité liée à son absence dans la vie de son fils. Tous les personnages ont ainsi leurs zones d’ombre, de fragilité, de secret, de culpabilité. Claire Foy et James MacAvoy livrent des prestations habitées et époustouflantes, sans doute aussi servies par leurs complicité et rôles antérieurs. En 2013, ils s'étaient ainsi retrouvés ensemble sur les planches dans « Macbeth » de Shakespeare.
Edmond Murray fait aussi penser à ces personnages hitchcockiens, des êtres ordinaires plongés dans des situations extraordinaires. Hitchcock avait d’ailleurs lui aussi réalisé un remake de son propre film. L'Homme qui en savait trop de 1956 était ainsi un remake de son film de 1934 pour lequel il avait lui aussi déplacé l'action, en l'occurrence de Saint-Moritz à Marrakech, tandis que James Stewart et Doris Day remplaçaient Leslie Banks et Edna Best. Là aussi, il s’agissait de gens ordinaires qui, bien malgré eux, se retrouvaient plongés dans des circonstances hors du commun, une affaire d’espionnage. D’autres cinéastes ont réalisé des remakes de leurs propres films, là aussi des films magistraux, comme Leo McCarey en 1957 avait réalisé un remake de son chef-d’œuvre de 1939, Elle et lui.
La caméra de Christian Carion, comme son personnage principal, traque la vérité, ces «instants de vérité» qu'évoque souvent Lelouch qui lui aussi met régulièrement en place un dispositif original à cette fin en soufflant les dialogues à ses acteurs qui ne les découvrent ainsi qu’au moment de les prononcer. Elle scrute les réactions d'Edmond Murray, le claquemurant dans son cadre comme ce dernier l'est dans sa détresse et sa solitude, étouffantes, et dans son angoisse, vertigineuse. Une caméra à hauteur d’hommes et à hauteur d'âme comme elle l’est dans chacun des films de Christian Carion, toujours en empathie avec ses personnages. Le travail sur le hors-champ et sur le son est aussi remarquable et amplifie encore le sentiment de paranoïa.
En réalisant le remake de son propre film, Christian Carion aurait pu opérer une redite inutile. Il n'en est rien. Le spectateur se retrouve lui aussi plongé dans une expérience immersive, inédite et captivante. Un thriller passionnant qui nous transporte, ailleurs et dans nos retranchements, en nous confrontant à nos pires angoisses, à nos limites, là où la morale et la loi n’ont plus que faire quand il s’agit de sauver un être cher même si le scénario de Laure Irrmann et Christian Carion évite intelligemment l'écueil de l’apologie de l’auto-défense. Un thriller intense, prenant, réaliste. Une expérience de cinéma inventive à laquelle sied plus que jamais la salle qui lui procure toute sa force et son ampleur. Un film entêtant comme la majestueuse musique qui l’accompagne, ces notes lancinantes et obsédantes, obscurément envoûtantes, qui nous hantent encore après la projection. Un film d'une indéniable puissance émotionnelle qui nous laisse à bout de souffle mais ravis de ce voyage, extrême mais palpitant, de la première à la dernière seconde. À découvrir et à vivre absolument en salles dès le 3 novembre.