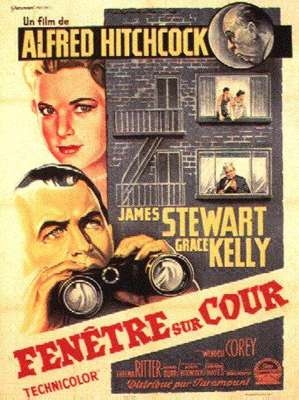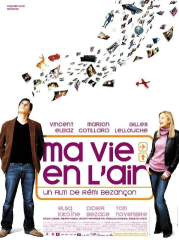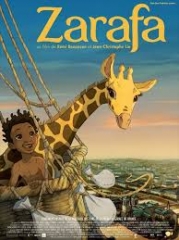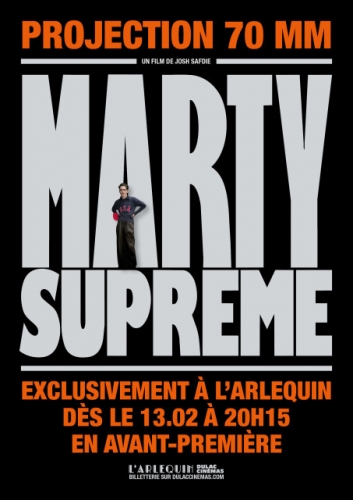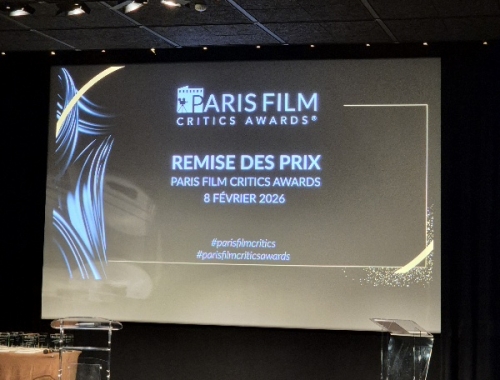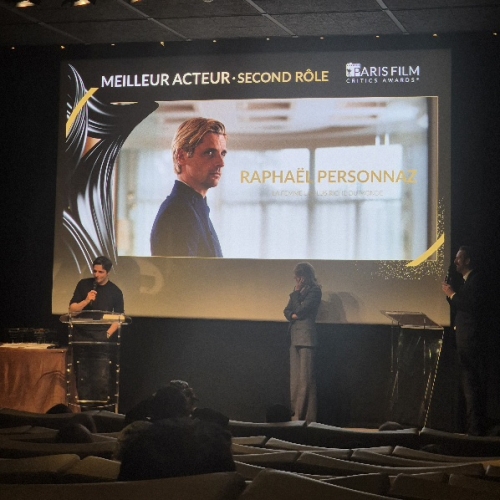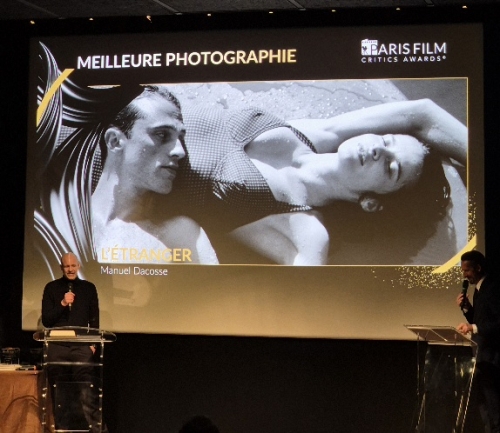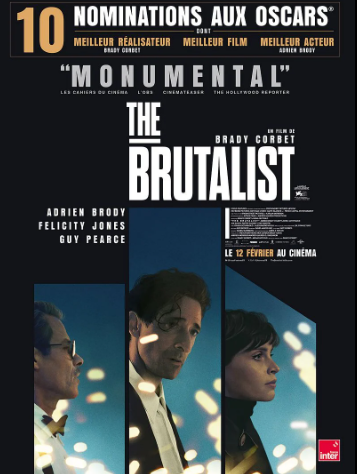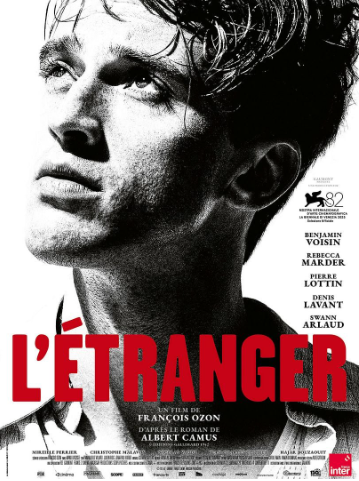Critique - LES RAYONS ET LES OMBRES de Xavier Giannoli (au cinéma le 18 mars 2026)

« Tout s’excuse et se justifie à une époque où l’on a transformé la vertu en vice, comme on a érigé certains vices en vertus. » Cette citation, extraite du roman Illusions perdues de Balzac, adapté en 2021 par Xavier Giannoli, aurait pu aussi être employée au sujet des personnages de son nouveau film, Les Rayons et les ombres. Un film qui ne cesse de me hanter depuis que je l’ai vu, il y a une semaine.
Ils sont rares, les films qui continuent à vous accompagner et à vous questionner des jours après les avoir découverts. Tout aussi rares sont les films de plus de trois heures (trois heures quinze en l’occurrence). Et rare, le dernier film de Xavier Giannoli, qui porte pour titre magnifique celui d’un recueil de poèmes de Victor Hugo, l’est indéniablement.
Ce nouveau long-métrage est inspiré d’une histoire vraie, celle de Jean Luchaire (Jean Dujardin) et Corinne Luchaire (Nastya Golubeva), un père et sa fille pris dans l'engrenage de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la magistrale adaptation du chef-d’œuvre de Balzac et ses 7 César, dont celui du meilleur film, il était difficile pour Xavier Giannoli de proposer une œuvre encore plus marquante…Et pourtant…
Il en fallait certainement de la détermination pour réaliser ce film de 30 millions d’euros de budget sur l’Occupation. Tant de films ont déjà évoqué cette période, cependant Les Rayons et les ombres n’est pas un film de plus mais une œuvre qui fera date.
Cela commence par le plan d’un miroir dans une chambre spartiate, signifiant l’effacement d’une identité. Un miroir dans lequel apparaît ensuite un visage, celui de Corinne. Un visage triste, livide, malade. À la fin de ce périple aussi passionnant qu’éprouvant nous reviendra cette image initiale de ce miroir sans reflet à laquelle succèdera celle de ce visage éprouvé. Accompagnée d’une petite fille au manteau rouge (rappelant un célèbre film sur cette période avec une autre petite fille au manteau rouge), elle est insultée, frappée, se fait cracher au visage. Elle va alors raconter son histoire pour l’enregistrer grâce à l’appareil d’une voisine et de son mari, et tenter d’expliquer comment une jeune star du cinéma des années 30 en est arrivée là, à être ainsi détestée. La vraie Corinne publia ainsi, en 1949, l’année précédant sa mort, une autobiographie intitulée Ma Drôle de vie.
Nous la retrouvons ensuite, petite fille, entre les deux guerres mondiales, au Cercle franco-allemand, avec son père, journaliste, alors pacifiste convaincu : « Plus jamais ça », « La guerre ne résout rien, elle ne fait que préparer la prochaine guerre. », « J'en fais le serment, elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits entre les peuples ». Jean est alors guidé par de nobles principes. Avec lui, son ami Otto Abetz veut « préserver la paix coûte que coûte ». Ce dernier est un amoureux de la littérature française dont il traduit les grands auteurs. La petite fille grandit dans cette « illusion rassurante » avec ce père qui « aimait un peu trop les petites actrices », un père qu’elle admire et qu’elle veut impressionner. La mère mène sa vie, dissolue, de son côté. C’est à peine si nous la voyons. Le père tousse beaucoup, crache du sang. Il découvre rapidement qu’il est atteint de cette maladie qui fait alors 100000 morts par an, la tuberculose, un mal qu’il a transmis à sa fille : un poison qui condamne leurs destins avant même que l’Histoire ne s’en charge. Comment ce père, fou de sa fille, pacifiste prosélyte, en arrive-t-il à être finalement condamné à mort pour « collaboration avec l’ennemi » et exécuté le 22 février 1946 ? Si Lucien de Rubempré vendait sa plume au plus offrant, Jean Luchaire, lui, aliène son âme pour une illusion de paix d’abord, pour l’argent ensuite. Où s'arrête alors l'aveuglement ? Où commence la lâcheté ? Quand devient-elle coupable ?
Otto convainc son ami : Hitler a fait la couverture du Times, « il faut discuter avec Hitler », « Chaque révolution a ses excès. », « Il n'y aura pas de grand projet européen sans une Allemagne forte. En attendant mieux, c'est avec Hitler qu'il faut parler. » « L'Allemagne veut la paix. » À Vichy, Jean voit Laval dont il reçoit même de l’argent. C’est lui qui lui demande de voir Otto devenu ambassadeur du Troisième Reich à Paris, rue de Lille. « Laval m'a dit : Allez voir votre ami Abetz et essayez de savoir ce que les Allemands ont dans la tête. » Pour Jean, la collaboration est alors une vertu destinée à éviter la guerre. Pendant ce temps, Corinne démarre sa carrière d’actrice, avec Prison sans barreaux, le film d’un Juif ukrainien : « c’est un humaniste, un vrai, comme mon père ». Le réalisateur refuse de serrer la main d’Otto. Il la met en garde : « Ce n’est pas qui tu crois. » « Mon père a voulu défendre son ami victime d’un complot national socialiste » continue à clamer Corinne. Pour Jean, l’idée d’Otto est « une politique de collaboration loyale et sincère ».
Rien ne laisse alors présager que Jean Luchaire deviendra l’un des défenseurs les plus fervents de la collaboration. Les Rayons et les ombres dissèque ce glissement des rayons vers les ombres et comment l’un, Jean, devint un défenseur ardent de la collaboration et l’autre, Otto, un de ses artisans. Comment leurs bonnes intentions initiales (éviter la guerre) ont-elles pu les conduire à épouser le pire ? Pour Jean, la collaboration, c’était d’abord poursuivre le dialogue pour éviter la guerre. Pour Otto, il s’agissait de « limiter la casse. »
Cette architecture du récit doit beaucoup à la plume de Jacques Fieschi. Avec ce dernier au scénario, nous pouvons toujours nous attendre à un travail d’orfèvre, ciselé, nuancé, et sensible, et c’est à nouveau le cas ici pour ce film dans lequel il insuffle une densité psychologique qui évite tout manichéisme, et navigue habilement sur une fragile frontière au seuil de la complaisance (toujours soigneusement évitée), avec le souci de vérité historique et de refléter la complexité des âmes. Il est notamment le scénariste de Claude Sautet (Quelques jours avec moi, Nelly et Monsieur Arnaud et le chef d’œuvre Un cœur en hiver), de Nicole Garcia (Le fils préféré, Place Vendôme, Mal de pierres, Un balcon sur la mer…), du film Yves Saint Laurent de Jalil Lespert ou encore d’Olivier Assayas (Les Destinées sentimentales). Le scénario est à l’image de la réalisation : un maelström foisonnant.
Peut-on comparer Jean Luchaire à Lucien de Rubempré ? L’un et l’autre utilisent le journalisme comme un marchepied. L’opinion est devenue un commerce comme un autre au temps de la Restauration. Un outil de l’arrivisme carnassier. Les moyens importent peu, il faut arriver à ses fins (briller, paraître, gagner de l’argent) et, comme chez Machiavel, elles les justifient. C’est aussi le cas pour Jean. Otto le qualifie même de « généreux ». Jean est pourtant avant tout soucieux de conserver son train de vie : « L’important, c'est de sortir le journal. Sans cela, je ne suis rien. ».
« Vous connaissez mon engagement sincère pour la collaboration. » À l’entendre, la collaboration serait le côté du bien. C’est pourtant le même Jean qui laissera utiliser ses locaux par des résistants qu’il surprend (du moins il ne les dénoncera pas), et qui aidera une famille juive à s’enfuir. Mais comment le défendre ou l’excuser quand il dit dans sa lettre à Céline : « je suis même devenu entièrement antisémite. Je ne suis pas enjuivé. » Céline raconte partout dans Paris qu’il n’a pas de convictions. Cela peut lui nuire comme à sa fille, lui explique Otto. « Il n'y a jamais eu des idées comme ça dans ma famille. » « On a voulu l'oublier mais les gens soutenaient Pétain au début de l'Occupation, le héros de Verdun » rappelle Corinne.
Le glissement progressif va s’opérer. Le père de Jean va s’éloigner de lui (André Marcon, toujours d’une grande justesse et ici dignité). Il lui adresse une lettre intitulée L'exercice de la vertu, publiée dans Le Figaro. « Tu regardes ailleurs » l’accuse-t-il. Jean hausse les épaules : « C'est à ses amis les bien-pensants et ceux de sa femme qu’il écrit. » Le discours d’Otto se radicalise, aux portes de la folie : « Un pays divisé est plus vulnérable, manipulable. » Et à propos d’une rafle : « C'est la police française qui a organisé l’opération, ils ont manqué de zèle d’ailleurs. » Mais toujours il se justifie ainsi, de vouloir éviter les combats armés : « Il vaut mieux une vache à traire qu'une vache à tuer. » Jean a bien conscience que « l'opinion n'acceptera jamais cette violence. » « C'est pour cela qu’on a besoin de la presse » lui rétorque Otto.
Père et fille ont « le goût du sang dans la bouche » comme le raconte Corinne à propos de leur maladie. Peut-on expliquer alors leur aveuglement coupable, et plus ou moins inconscient, par ce désir de défier la mort ? « On avait notre guerre à nous contre la douleur. Pendant tout ce temps, je pensais à ma douleur et pas à celle des autres. » Lors du séjour de Corinne au sanatorium, d’effroyables traitements lui sont infligés. Coralie dans Illusions perdues et Corinne dans Les Rayons et les ombres : deux actrices au corps malade à l’image d’un monde en décomposition. La tuberculose qui ronge le père et la fille semble être alors la métaphore de leur déchéance morale. Père et fille se laissent entraîner dans ces réceptions où il y a tout Paris, dans la débauche aussi. Et puis si tout Paris est là, c’est qu’il n’y a rien de répréhensible : Guitry, Céline. Et tant d’autres. « Des collaborateurs, des fanatiques, des opportunistes. » Corinne a une confiance aveugle en son père : « J’ai suivi le mouvement. J'ai suivi mon père. Il ne pouvait pas me compromettre. » Et quand une amie tente de lui ouvrir les yeux : « Regarde-les bien, ils vont tous être pendus » elle répond : « Des envieux. On fait rien de mal, tu sais. » Otto lui promet des ausweis et en échange lui demande de venir aux cocktails à l'ambassade. Il lui montre fièrement sa collection de tableaux, ce que les nazis appellent « l’art dégénéré », comme il semble le déplorer, mais il en occulte pourtant l’effroyable provenance.
Au milieu de ce naufrage, l’amour filial demeure le seul point fixe. Ce qui traverse tout le film jusqu’à la fin, c’est l’amour qui unit ce père et sa fille jusqu’à leur fuite à Sigmaringen. Et c’est ce qui est aussi troublant dans cette histoire. Cet amour, sans excuser, semble tout justifier. « C’était mon père. On ne savait pas » clame Corinne de son côté, un cri déchirant auquel fera écho celui de son père. En effet, lors de son procès, le seul moment où le père réagira, c’est quand on mettra en cause sa fille : « C'est ignoble ce que vous dites ! » Le grand amour de la vie de Corinne, celui dont la photo l’accompagne dans son portefeuille, même après son exécution, c’est son père.
La seule fois où Corinne a peut-être trouvé un autre amour et l’apaisement, c’est le recueil d’Hugo qui en est le magnifique liant et symbole. Mais, une fois de plus, l’ombre l’emporte : elle choisira de fuir avec son père. Les Rayons et les Ombres est un recueil de 44 poèmes écrits après 1830 que Victor Hugo publia en 1840. Il reflète la dualité du monde. Les rayons évoquent la beauté, l'amour, la nature en fête et le souvenir des jours heureux. Les ombres expriment la tristesse, les morts, les héros oubliés. Les rayons représentent la connaissance avec le poète pour guide et, à l'inverse, les ombres désignent l'ignorance.
Le contrepoint nécessaire à cet étourdissement arrive avec le discours vibrant de l’avocat général ( désormais trop rare Philippe Torreton, qui en quelques plans, d’une justesse et d’une force mémorables rétablit la vérité) désamorce les éventuels reproches de complaisance. Il rappelle que pendant ce temps, il y avait des actes de bravoure, qu’un résistant n’aura donné qu’un seul nom, « le sien. » Mais Jean, lui, « a choisi l'ennemi. Il a choisi l'or. Il a choisi de trahir. », il a choisi « l'intelligence avec l’ennemi. » « Lui, l'homme de gauche » a été « complaisant avec les pensées les plus nauséabondes ». Son réquisitoire vient déchirer le voile des rayons pour faire apparaître la réalité des ombres.
Alors, vous lirez ici et là dire que le film est trop long. On vous rappellera même que À l’origine, un des précédents films de Giannoli, avait été amputé de 25 minutes après sa projection cannoise. Je crois au contraire que la durée de ce film est une de ses grandes qualités. Il nous fait entrer dans la danse macabre, brouille nos repères entre le bien et le mal, la conscience et l’inconscience, la lucidité et l’aveuglement. Souvent avec des coupes abruptes, il empêche l’émotion de s’installer, et donc toute complaisance. Abrupte et rude comme cette période. Nous voilà nous aussi entraînés dans une folie qui ne nous laisse pas le temps de réfléchir, de vraiment distinguer le bien du mal. Tout devient flou. L’anti Marty Suprême en somme parce que le film ne cherche pas à nous séduire ou hypnotiser mais à nous éclairer en nous plongeant dans les abîmes de l'Histoire avec ses personnages. Ces 3H15 ne sont donc pas une coquetterie de cinéaste mais une nécessité immersive. Il faut ce temps long pour ressentir l’étourdissement des cocktails de la rue de Lille, ce tourbillon de rayons faciles qui finissent par occulter les ombres de la déportation jusqu’à ce discours de l’avocat général qui nous remet les idées en place et nous rappelle la vérité historique. L’aveuglement et l’amour qui unit un père et sa fille ne peuvent tout excuser, au mieux peut-être expliquer.
Giannoli aime ces personnages troubles, guidés par l’orgueil souvent. Dans À l’origine, Philippe (François Cluzet) éprouve avant tout ce besoin de ne pas être seul, et surtout d’être considéré. Il devient quelqu’un dans le regard des autres par une escroquerie. Dans Illusions perdues, Lucien Chardon est un jeune poète inconnu et naïf dans la France du XIXe siècle. Il quitte l’imprimerie familiale et Angoulême, sa province natale, pour tenter sa chance à Paris, aux côtés de de sa protectrice Louise de Bargeton. Peu à peu, il va découvrir les rouages d’un monde dominé par les profits et les faux-semblants, une comédie humaine dans laquelle tout s’achète et tout se vend, même les âmes et les sentiments. Comme dans Les Rayons et les ombres… Un monde d’ambitions voraces dans lequel le journalisme est le marchepied pour accéder à ce après quoi tous courent alors comme si résidait là le secret du bonheur, symbole suprême de la réussite : la richesse et les apparences. Pour Philippe, le marchepied est l’escroquerie. Pour Lucien, le journalisme mordant. Pour Jean, le journalisme aussi, les trafics…et la collaboration.
Après Les Corps impatients (2003), Une aventure (2005), Quand j'étais chanteur (2006), À l'origine (2009), Superstar (2012), Marguerite (2015), L'Apparition (2018), Illusions perdues (2021), Les Rayons et les Ombres est le neuvième long-métrage de Xavier Giannoli.
La caméra de Xavier Giannoli, une nouvelle fois, filme au plus près des visages, au plus près de l’émotion, au plus près du malaise. Dans Illusions perdues, la voix off n’est pas destinée à pallier d’éventuelles carences scénaristiques. Elle donne au contraire un autre éclairage sur ce monde de faux-semblants. Ce qui est pur semble pourrir de l’intérieur comme le cœur noble de Lucien sera perverti, mais surtout comme Coralie et son corps malade dont les bas rouges sont une étincelle de vie, de sensualité, de poésie qui traverse le film et ce théâtre de la vie, vouées à la mort. Dans Les Rayons et les ombres, la voix off n’est pas non plus un artifice suranné. Elle nous fait entrer dans cette histoire d’ombres par la personnalité rayonnante de Corinne, pour faire trembler nos certitudes.
Cette sensualité dans les mouvements de caméra nous emporte dans chacun de ses films. Je me souviens de ces plans étourdissants dans À l’origine quand il filmait ces machines, véritables personnages d’acier, qui tournoyaient comme des danseurs dans un ballet, avec une force visuelle saisissante et captivante, image étrangement terrienne et aérienne, envoûtante, avec la musique de Cliff Martinez qui achève de rendre poétique ce qui aurait pu être prosaïque. Ici, Giannoli filme les rouages de l’horreur de la collaboration comme une valse macabre. Des passages en noir et blanc rappellent la frénésie du temps passé. Tant de plans mémorables… Comme celui-ci : dans les coulisses d’un cabaret, entre teintes sombres et rougeoyantes, comme se retrouvant en Enfer, entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, Jean s’assied, toussant jusqu'à l'étouffement, accablé, avec ces masques autour de lui et la voix de son père, de sa conscience qui lui assène : « Je vais t'écrire, Jean. »
Nous retrouvons la même minutie dans la reconstitution de la France sous l’Occupation que dans la reconstitution historique de la vie trépidante et foisonnante de Paris sous la Restauration. Pareillement, dans Les Rayons et les ombres, tout virevolte et fuse, les mots et les gestes et les avis, dans ce monde constamment en mouvement dont la caméra de Giannoli épouse avec brio la cadence effrénée telle celle d’Ophuls, une caméra observatrice de ce monde impatient dans lequel le cynisme est toujours aux aguets, au centre du spectacle de la vie dont, malgré les décors et les costumes majestueusement reconstitués, nous oublions presque qu’il est celui du monde d’hier et non d’aujourd’hui. Le chef décorateur Riton Dupire-Clément accomplit ici pourtant des merveilles de réalisme.
Le scénario multiplie les échos avec le présent. Là encore, à qui accuserait le film de complaisance, il résonne avant tout comme un avertissement : « Les Centristes croient qu'en s'associant avec l’extrême droite, ils pourront la contrôler. » « On nous disait : ne vous inquiétez pas. La France a été humiliée en quelques semaines. » Et puis il y a cet homme qui veut faire « un groupe de presse. Il en profite pour acheter tout ce qui passe. » Le parallèle avec la concentration actuelle des médias, arme de propagande, est évident.
Que dire du casting ! Nastya Golubeva, accessoirement fille de Leos Carax, vue auparavant dans Revoir Paris et Annette, nous plonge dans ce récit, nous touche souvent, sans nous attendrir totalement, mais en tout cas nous emporte avec elle dans cette plongée en Enfer, livrant une performance d’une dualité saisissante, lumineuse et spectrale.
Quant à Dujardin, il nous avait déjà prouvé l’étendue de son talent en incarnant George Valentin dans The Artist qui lui valut tant de récompenses, à commencer par l’Oscar du meilleur acteur en 2012. Il fallait déjà beaucoup de sensibilité, de recul, de lucidité et évidemment de travail et de talent pour parvenir à autant de nuances dans un même personnage, sans compter qu’il incarne aussi George Valentin à l’écran, un George Valentin volubile, excessif, démontrant le pathétique et non moins émouvant enthousiasme d’un monde qui se meurt. Il y est aussi flamboyant puis sombre et poignant, parfois les trois en même temps, faisant passer dans son regard, une foule d’émotions, de la fierté aux regrets, de l’orgueil à la tendresse, de la gaieté à la cruelle amertume de la déchéance. Dans Un balcon sur la mer de Nicole Garcia, il est bouleversant dans le rôle de cet homme qui retrouve son passé, son enfance et ainsi un ancrage dans le présent. Dans les OSS 117, il est hilarant, n’économisant ni ses rictus, ciselés, ni ses soulèvements de sourcils, ni ses silences, ni ses incoercibles rires gras. Jean Dujardin a déjà maintes fois prouvé la large palette de son jeu et de son talent. Il faudrait encore citer les remarquables Möbius, Un + une ou encore Sur les chemins noirs dans lequel il a l’intelligence de ne pas forcer le trait, de faire corps avec le paysage ( la balafre comme un sillon sur son visage, un autre chemin noir : comme ces paysages hors des sentiers battus, portant l'empreinte du passé). Là aussi, dans le film de Giannoli, il incarne corps et âme cette personnalité trouble, le pacifiste prosélyte qui devient le traître à la nation. Celui qui voulait « limiter les dégâts » qui devient l’artisan du désastre, qui s’est persuadé de « vivre sans se compromettre ». Il n’est jamais totalement antipathique (ses propos, parfois, sont en revanche indignes) sans être jamais vraiment sympathique.
August Diehl (La disparition de Josef Mengele de Kirill Serebrennikov, Une vie cachée de Terrence Malick) dans le rôle d’Otto, Vincent Colombe dans le rôle de Guy Crouzet…apportent tous une épaisseur tragique à cette galerie ombrageuse.
La photographie de Christophe Beaucarne sculpte la lumière pour rendre compte de cet étourdissement doré et funeste.
La musique de Guillaume Roussel (La French, Kompromat, Les Trois Mousquetaires, 13 jours, 13 nuits), qui travaille pour la première fois avec Xavier Giannoli, est aussi d’une rare puissance. Elle est notamment magistrale, emphatique et lugubre, sur la scène du retour des cendres de l’Aiglon, fils de Napoléon 1er, le 15 décembre 1940, lors de la « messe noire aux Invalides » terrifiante, quand on nous explique la déception qu’Hitler et Pétain ne fussent pas venus. La musique personnalise alors l’horreur de la collaboration comme si elle murmurait à l’oreille ce que les personnages ne veulent pas admettre.
Comme presque tous les films de Giannoli, celui-ci est aussi un hommage à l’art en général, au cinéma en particulier. Cette « réponse pacifiste à la folie des hommes. » Surtout avec la dernière réplique du film que je vous laisse découvrir. À l’origine était aussi une belle métaphore du cinéma et du métier de comédien qui est finalement aussi une imposture, qui fait devenir quelqu’un d’autre, fabriquer un chemin, un univers qui ne mène pas forcément quelque part mais reste, là aussi, une belle aventure humaine. À l’origine nous fait croire à l’impossible, à ce que le cinéma lui aussi était à l’origine : un mensonge exaltant qui peut nous faire croire que tout est possible. Même si la réalité, un jour ou l’autre, finira par reprendre ses droits.
« Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude, il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. », « Là où l'ambition commence, les naïfs sentiments cessent. », « Il se méprisera lui-même, il se repentira mais la nécessité revenant, il recommencerait car la volonté lui manque, il est sans force contre les amorces de la volupté, contre la satisfaction de ses moindres ambitions » écrivit Balzac dans Illusions perdues. Le romantisme et la naïveté de Lucien Chardon céderont bientôt devant le cynisme et l’ambition de Lucien de Rubempré. « Je ne sais même plus si je trouve le livre bon ou mauvais » dira-t-il ainsi dans le film, tant son opinion est devenue une marchandise qui se vend au plus offrant. On pense alors aux « idées » défendues par Jean dans son journal, pour vendre.
Comme Lacombe Lucien (Louis Malle, 1974), les Luchaire ne sont pas au départ des idéologues du nazisme, mais des opportunistes, à deux échelles différentes. Comme dans Monsieur Klein de Losey (1976), les décors cachent une abjection croissante, mais Luchaire n’aura jamais le sursaut final que connaît Klein qui finira par rejoindre le destin des opprimés. Le Dernier Métro de Truffaut (1980) met en scène une actrice dans une bulle de théâtre alors que le monde s’effondre. Le cinéma est le refuge de Corinne, mais quand la Marion de Truffaut protège un homme juif, Corinne ne sert que ses intérêts. Pour l'une, le théâtre est un refuge héroïque, pour l'autre le cinéma est une bulle narcissique. Dans L’Armée des ombres de Melville (1969) tout est gris, froid, silencieux. Chez Giannoli, tout est bruyant, excessif, d’une opulence asphyxiante. Les uns meurent dans l'ombre, tandis que les autres s'étourdissent dans la lumière. À l’inverse de la sobriété sépulcrale de Melville, Giannoli choisit une mise en scène flamboyante pour souligner l’ivresse et la décadence.
Quand s’achève cette fresque historique et cet implacable engrenage nous revient cette phrase de Corinne qui, pour un rôle, répète jusqu’aux frontières de la folie et de l’épuisement « Je suis innocente ! Innocente ! Innocente ! » Et cette question à son réalisateur : « Comment on dit je suis innocente en ukrainien ? ». Pouvons-nous la juger totalement coupable, sans pour autant l’excuser ? Quel défi réalisé par ce film que de disséquer ainsi la complexité de l’âme humaine et d’une période lors de laquelle l’impensable survint. Savaient-ils vraiment ce que personne n’aurait pu imaginer ?
Jacques Fieschi, une fois de plus, signe un scénario magistral (coécrit avec Giannoli). L'histoire de ce Luchaire, artisan de la paix devenu artisan de l’horreur, résonne comme un avertissement. Cette dualité traverse le film de Giannoli, qui refuse la caricature pour mieux nous confronter à la zone grise de notre propre conscience. Les Rayons et les ombres nous laisse avec le goût du sang dans la bouche et une question vertigineuse : à quel moment le compromis devient-il une compromission irréparable ? Si Hugo voyait le poète comme un guide sauveur, Luchaire est un guide qui mène les siens vers l’abîme. Mais ce qui reste finalement de cet immense film, courageux, audacieux, foisonnant, passionnant, éprouvant, fascinant, pas toujours aimable mais toujours admirable, ce sont les derniers mots du film, hommage au cinéma réconciliateur, c’est le « Je suis innocente » scandé par Corinne, et ce sont les mots sentencieux de l’avocat général :
« Se voyant déjà condamné, il a voulu danser avec la mort, mais la mort qui rôde peut vous élever au-dessus de vous-même, faire de vous un résistant et pas un traître.»