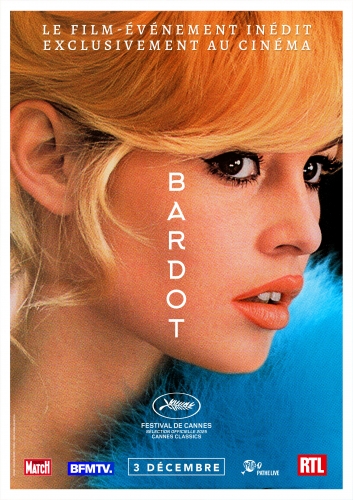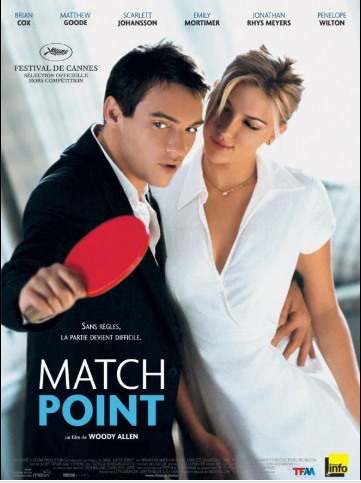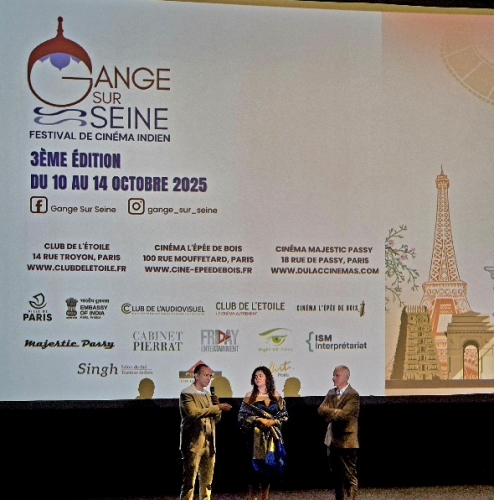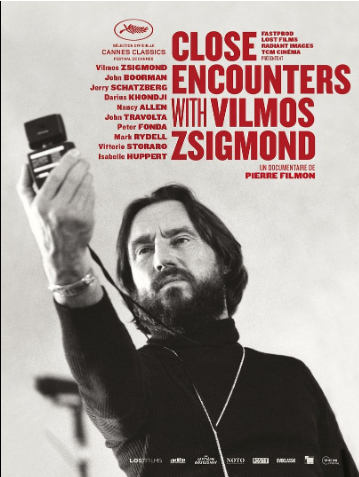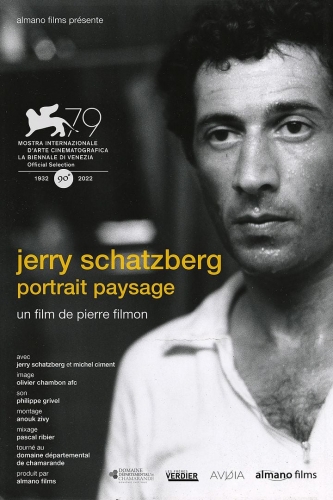« L’atmosphère et les personnages sont plus importants pour moi que l’intrigue elle-même. Une histoire originale ne vaut rien si les personnages sont conventionnels. » Marcel Carné
Du Quai des Brumes, vous connaissez très certainement ses inoubliables personnages Nelly et Jean et la célébrissime réplique de Gabin à Morgan « T'as d’beaux yeux tu sais ». Ce film culte ne se réduit pourtant pas à cette réplique. Oeuvre majeure du réalisme poétique français, Le Quai des brumes est aussi l’incarnation d’un cinéma du désenchantement. Un film sur lequel plane la fatalité, métaphore d’une société d’avant-guerre qui court à sa perte et reflet d’une angoisse collective. Jean Gabin y incarne le héros tragique contemporain.
Le Quai des brumes est disponible pour la première fois dans sa sublime restauration 4K. Il a été restauré en 4K par Studiocanal et la Cinémathèque française, avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée et de Chanel. Cette restauration réaffirme l’engagement de Studiocanal et de la Cinémathèque française en faveur de la préservation du patrimoine cinématographique. Les travaux d’image ont été réalisés au laboratoire Transperfect à partir du négatif original, quoique incomplet, du film et d’un internégatif nitrate standard de 1938. L’étalonnage des couleurs s’est appuyé sur une copie nitrate 35 mm d’époque afin de restituer avec la plus grande fidélité la photographie envoûtante d’Eugen Schufftan et de rendre hommage aux décors mythiques d’Alexandre Trauner.
Le synopsis du Quai des brumes laisse déjà entrevoir le pessimisme qui en émane et qui suffira à certains pour le qualifier de « film manifeste » du réalisme poétique. Ainsi, par une nuit ténébreuse, un déserteur de la Coloniale Jean (Jean Gabin), arrive au Havre en espérant s’y cacher avant de partir à l’étranger. Dans la baraque du vieux Panama (Edouard Delmont) où il trouve refuge grâce à un clochard, il rencontre le peintre fou Michel Krauss (Robert Le Vigan) et une orpheline, Nelly (Michèle Morgan), qui le bouleverse immédiatement. Cette dernière vit chez son tuteur, le terrifiant Zabel (Michel Simon). Par amour, Jean va se retrouver entraîné dans un engrenage périlleux...
Dès le début, le sceau de la fatalité est apposé : ce panneau « Le Havre, 20 kms », la route mouillée qui émerge de la nuit et Gabin dans la lueur des phares qui y erre, seul, le regard désespéré. Sa bonté se révèle cependant d’emblée lorsqu’il empêche le chauffeur qui le prend en stop d’écraser un chien qui l’accompagnera tout au long du film. Le Quai des brumes, tourné au Havre et au Studio de Joinville-Le-Pont, est une adaptation du roman de Pierre Mac Orlan de 1928 qui se déroule à Montmartre en 1900.
Les services de propagande de l’UFA jugent le sujet du film décadent et font savoir qu’il n’est pas souhaitable de le réaliser. Il devait en effet être tourné en Allemagne dans le cadre des accords de coproduction franco-allemande mais les censeurs d’outre-Rhin effarouchés par le pessimisme du sujet refusèrent l’autorisation de tourner à Hambourg les scènes qui dans le roman se déroulaient à Montmartre. La ténacité de Gabin permit néanmoins au projet d’aboutir et c’est d’ailleurs lui qui imposa le scénariste Prévert et le réalisateur Carné.
Gabin avait refusé de jouer dans Jenny et avait été intrigué par Drôle de drame qui, au passage, fut un échec, le public ayant été désorienté par son ton acéré et par son synopsis rocambolesque (que la précision de son écriture rend néanmoins parfaitement compréhensible).
Rabinovitch, le producteur qui reprit le projet, l’accepta sur le nom de Gabin sans même avoir lu le scénario. Il le lut la veille du tournage et n’eut de cesse ensuite de répéter « c’est sale, c’est sale », refusant même que son nom apparaisse au générique et insistant pour qu’il y figure lorsque le film connaîtra un triomphe : un triomphe aussi bien en salle, où il sera applaudi à l’issue de sa première projection au cinéma Marivaux le 18 mai 1938, que chez les professionnels. Il fut récompensé à Venise en 1938 (prix de la mise en scène) et reçut le prix Louis-Delluc 1939.
À l’exception de L’Humanité et de L’Action Française, le film est également encensé par la presse. Mac Orlan lui-même dira aimer cette « version nettement désespérée ». Le projet parvint donc à se monter sans veto de la commission de censure, si ce n’est le ministère de la guerre qui exigea tout de même que le mot déserteur ne soit jamais prononcé et que le héros plie soigneusement ses effets militaires au lieu de les jeter en vrac, au cours d’une scène où il doit les remettre au tenancier de l’auberge. Le producteur essaiera d’obtenir d’autres coupures mais, grâce à l’obstination de Carné, la seule qu’il parvint à obtenir fut celle d’une scène où l’on devait voir Michel Krauss nu et de dos s’avancer dans la mer. Dans la version définitive, son suicide est seulement évoqué mais pas montré à l’écran.
Dès les premiers plans, le décor (finalement celui du Havre) est planté, l’atmosphère est caractérisée. Jean est un personnage seul, taciturne, suivi par un chien abandonné tel un miroir de lui-même. L’inéluctabilité du malheur résulte bien sûr du récit mais avant tout des personnages : un peintre fou, un mauvais garçon jaloux et violent, un tuteur qui convoite sa pupille, un déserteur. Le destin de chacun semble être tracé dès les premières minutes du film et voué à la tragédie et au drame. Le décor et son charme triste, créé par la pluie et la brume, et les dialogues de Prévert, renforcent cette impression. Les dialogues sont ceux de personnages pessimistes, et même davantage : désenchantés. Ainsi, pour le peintre : « Je peins malgré moi les choses cachées derrière les choses. Quand je peins un nageur, je vois un noyé. », « Oh, le monde il est comme il est, plutôt sinistre, plutôt criminel. », « Je verrais un crime dans une rose ». Les personnages ne croient plus en la vie, ni en l’amour : « Qu’est-ce qu’ils ont tous à parler d’amour, est-ce qu’il y a quelqu’un qui m’aime, moi ? » regrette, quant à lui, le personnage incarné par Michel Simon qui se dit « amoureux comme Roméo avec la tête de Barbe bleue. »
Si la fatalité de la guerre semble planer comme la tragédie au-dessus des têtes des protagonistes, elle se confond avec le regret de 1936 : « C’est beau d’être libre. Oui, c’est beau, l’indépendance, la liberté. » Le cadre de la fête foraine à la fin du film rappelle également l’euphorie de 1936 et exacerbe encore le désenchantement dont elle est alors le cadre. Le thème de la solitude revient également comme un leitmotiv : « C’est difficile de vivre. », « Oui, on est seuls », « On rencontre des gens qu’on ne reverra peut-être pas et qui nous rendent service. »
C’est un univers hanté par la mort comme la réalité est hantée par le spectre de la guerre : la mort se présente sous plusieurs formes. C’est d’abord le suicide avec le peintre, le meurtre avec Zabel, et la mort par la fatalité, dont la rencontre avec Nelly n’a fait que repousser l’échéance, celle du déserteur tué par la police. Nelly semble être la seule à matérialiser une forme de rêve et un ailleurs mais ses propos ne sont pas moins pessimistes : « Mais ce n’est pas le fond de la mer. Le fond de la mer, c’est plus loin, plus profond. »
Le couple formé par Jean Gabin et Michèle Morgan dans Le Quai des brumes est caractéristique du climat de lourde fatalité de l’avant-guerre. Les personnages démissionnent tous face au cataclysme qui les menace comme la guerre menace la France et le monde. Ce pessimisme vaudra au Quai des brumes d’être un des premiers films interdits par le gouvernement français au moment de la déclaration de guerre, celui-ci le qualifiant de « démoralisateur ».
Même si, chronologiquement, Le Quai des brumes n’est pas le premier film à pouvoir s’inscrire sous la dénomination de réalisme poétique, même si c’est déjà le troisième film de Marcel Carné, il est bien souvent qualifié de « film manifeste » de ce mouvement et même parfois de film créateur. Il en a peut-être en revanche poussé les caractéristiques à leur paroxysme. Son atmosphère lugubre, et mélancolique, ses personnages voués à un destin tragique, les décors embrumés de Trauner et la poésie de Prévert le classent indéniablement dans cette catégorie. Le réalisme poétique, également synonyme de classicisme, sera donc bien souvent décrié même si certains le défendirent comme le critique Claude Briac qui écrivit qu’il « n’y a pas au monde dix réalisateurs capables de réaliser un tel film. » Marcel Carné lui-même réfutait d’ailleurs cette dénomination de réalisme poétique à laquelle il préférait celle de « fantastique sociale » imaginée par Mac Orlan. Cela n’empêchera pas certains critiques d’encenser le film justement parfois grâce à ses caractéristiques propres à cette dénomination. Ainsi, dans L’avant-garde du 28 Mai 1938 on pouvait lire : « en dépit de cette atmosphère de misère morale, physique et physiologique, peut-être même à cause de cette atmosphère, trouble, floue, brumeuse, Le Quai des brumes est un chef d’œuvre. »
Cette inéluctabilité du malheur s’incarne essentiellement dans un acteur, Jean Gabin, et dans un mouvement cinématographique, le réalisme poétique. Dès La Bandera, l’image de Gabin était marquée du sceau de la fatalité et l’enchaînement inéluctable de ses infortunes procèderait, dans ses films à venir, d’un crime commis par désespoir d’amour : La Belle équipe qui se solde par le meurtre de Charles Vanel, Pépé le Moko dont le héros meurt sur le port d’Alger après avoir voulu rejoindre celle qu’il aimait etc. L’image du garçon malchanceux poursuivi par la fatalité sociale et victime du trop grand prix qu’il accorde à l’amour des femmes, sera celle de Gabin jusqu’au Jour se lève. Tous ses personnages sont voués à la mort comme la France est vouée à la guerre : que ce soit le sableur du Jour se lève, le déserteur du Quai des brumes ou le cheminot fou de La bête humaine ou encore le pittoresque Pépé de Pépé le Moko. C’est néanmoins toujours un personnage doté de morale et s’il tue, il n’est pas pour autant un assassin. C’est bien souvent la folie ou la fatalité qui le poussent au crime. Zola définit ainsi Lantier comme « un homme poussé à des actes où sa volonté n’était pour rien », une définition qui pourrait s’appliquer à chacun des personnages incarnés par Gabin. Dans tous ses films, Gabin incarne un séducteur, la plupart du temps malgré lui, qui ne croit plus en rien mais dont l’amour s’empare et que le destin implacable pousse à une fin tragique. Tout en continuant à incarner le Front Populaire, Gabin incarne donc ces destins tragiques comme s’il incarnait, au-delà de personnages fictifs, le destin d’un Etat.
D’après la définition communément admise, le mythe est une croyance, largement représentée dans l’imagination collective, en une fable porteuse de vérité symbolique et répondant aux inspirations souvent inconscientes de ceux qui la partagent. Le mythe transmet, justifie, renforce et codifie les croyances, valeurs et coutumes sociales. Il permet la projection des fantasmes et des problèmes d’une société lorsque celle-ci ne peut les satisfaire ou les résoudre. Elle apporte à l’homme moderne la certitude et la cohésion dont il a besoin, l’aide à se définir et lui fournit des modèles d’authentification. Les films, comme les autres œuvres humaines, véhiculent des mythes, archétypes, symboles, et stéréotypes qui expriment la mentalité collective de leur époque… Le mythe de Jean Gabin représente donc une mentalité pessimiste et les films dans lesquels il évolue : l’angoisse collective de la guerre. Au-delà de son immense talent le succès de Gabin s’explique donc aussi par les attentes, les craintes plus ou moins conscientes de la population, qu’il incarne. Les angoisses de ses personnages coïncident avec celles de la population, voyant en Gabin le « héros tragique par excellence du cinéma français d’avant-guerre », un héros dont les craintes résonnent avec une étonnante humanité et vérité dans ce contexte où l’héroïsme sera parfois le fruit des circonstances. Gabin c’est aussi l’incarnation du peuple ouvrier représenté pour la première fois à l’écran. Ainsi, selon Jean-Michel Frodon « Avec la double mort de Gabin-Lantier (La bête humaine) et de Gabin-François (Le jour se lève), le peuple ouvrier français quitte pour toujours les écrans. Le Gabin d’avant-guerre incarne donc une défaite, celle de l’idéologie et de l’époque du Front Populaire, qui voyait dans la classe ouvrière l’avenir du monde. » Pour d’autres comme Weber, ce « mythe emblématique et récurrent de l’ouvrier », « voué à l’échec » et « écrasé par la fatalité » reste l’image que se font les producteurs et les cinéastes de l’époque du prolétariat et qui selon lui représentent un « bel exemple d’idéologie dominante. »
Le succès du Quai des brumes agit comme un révélateur. Les principaux succès de l’époque sont des comédies, des films d’espionnage ou d’aventures exotiques qui contrastent avec la noirceur absolue du film de Carné comme si les spectateurs se sentaient inconsciemment attirés par ce film comme par un miroir, celui de ses angoisses. Comme l’affirmait Ferro, le cinéma « offre un outil d’investigation irremplaçable pour dévoiler le réel et révéler les non-dits d’une société (…) de découvrir le latent derrière l ‘apparent, d’atteindre des zones inaccessibles par l’écrit » et de montrer, comme l’a écrit Maurice Merleau Ponty, la « pensée dans les gestes, la personne dans la conduite, l’âme dans le corps ». Le réel n’est donc pas celui que donne à voir les comédies mais celui qui semble si surréaliste par son pessimisme et qui sera pourtant bientôt la tragique réalité. La France court à sa perte, ne croit plus en son avenir comme Jean dans Le Quai des brumes, le poète Michel Krauss et les autres. Ce qui est encore invisible est pressenti par les réalisateurs. C’est avant tout en cela que le réalisme poétique peut être qualifié de mythe : les préoccupations des spectateurs s’incarnent dans ces films.
La fin avec ce chien (et qui influencera Hazanavicius pour The Artist), lui aussi condamné à errer seul sur la route, nous rappelle le début du film et Jean, âme abandonnée et esseulée, dans la même situation. Même si ce long-métrage semblera à certains suranné, le revoir hier une énième fois m'a provoqué une émotion intacte. Comment ne pas être émue par cette poignante histoire d’amour impossible sur laquelle d’emblée plane le sceau de la fatalité. Le port du Havre et son épais brouillard tel un piège inextricable. L’« atmosphère, atmosphère » -pour paraphraser Arletty dans un autre film de Carné- si singulière des films de Carné. La beauté ensorcelante et tragique du couple formé par Morgan et son « rire triste » et Gabin et son regard égaré et son phrasé las. La musique dramatique de Maurice Jaubert. L présence terrifiante du possessif personnage incarné par Michel Simon fou de jalousie et de désir (« amoureux comme Roméo avec le tête de Barbe bleue »). La couardise du personnage de Pierre Brasseur. Les seconds rôles joués par Édouard Delmont et Robert Le Vigan. Les dialogues d’une poésie désespérée de Jacques Prévert. Le cadre spatio-temporel qui étouffe les personnages (règle des trois unités). La noirceur étrangement envoûtante de la photographie et des répliques. Les décors de Trauner. Les mots d’amour et le regard brûlant de vie et de passion de Michèle Morgan.
L’influence de Lang, Murnau, Hawks, Sternberg plane aussi sur cette histoire d’amour vouée à l’issue tragique. La restauration sublime les clairs-obscurs d'Eugen Schüfftan. Et les contrastes. Entre les ombres et les lueurs. Les âmes sombres et les regards étincelants de désir ou d’amour. La grisaille et le brouillard menaçant encerclent le port et enserrent les êtres. Et les pavés mouillés luisants, tel un diable facétieux, avertissent d’un malheur imminent. Seule la mélancolie contagieuse et le brouillard insondable en sortent victorieux... Longtemps après la projection résonnent encore les dialogues de Prévert qui reflètent l’amour qui foudroie Jean, leur simplicité percutante et entêtante, leur douceur et leur pessimisme… même si pour les cinéastes de la Nouvelle Vague ils représentaient cette fameuse Qualité française qu’ils méprisaient (films trop écrits, artificiels et de studios) :
— Il est à vous ? Il a une jolie tête.
— Toi aussi. T'es belle et tu me plais T'es pas épaisse mais tu me plais. Comme au cinéma, je te vois et tu m'plais. Le coup de foudre. Le coup de bambou. L'amour quoi.
Tu sais le petit mec avec ses ailes dans le dos puis les flèches. La romance puis les larmes.
— Quand une fille est belle, qu'elle est jeune et qu'elle veut vivre eh ben, c'est comme un homme qui essaie d'être libre, tout le monde est contre comme une meute.
— J t'oublierai pas Nelly. Tu peux pas savoir ce que tu me plais.
— Chaque fois que le jour se lève, on croit qu'il va se passer quelque chose de nouveau et puis le soleil se couche …
—J'ai qu'à te regarder t'écouter et puis tu me donnes envie de pleurer.
— Personne ne dansait vraiment. Personne ne riait. Tout le monde faisait semblant.
— C’est difficile de vivre, hein.
— Non, les gens s'aiment pas. Ils n'ont pas le temps.
— Une fois j'avais été heureux dans la vie à cause de toi.
En complément, je vous propose une analyse d’un autre film majeur de Carné, Le Jour se lève, et je vous invite à revoir le chef-d’œuvre du duo Carné-Prévert, Les Enfants du paradis, dans lequel résonne le célèbre « Paris est si petit pour ceux qui s’aiment d’un aussi grand amour » prononcé par la voix si inimitable et reconnaissable d’Arletty.
Le Jour se lève de Marcel Carné (1939)

Je vous propose en complément une analyse du Jour se lève de Marcel Carné, cinéaste dont certains raillent le classicisme mais qui, avec ce film en particulier, a pourtant influencé un grand nombre de réalisateurs.
Le jour se lève : la fin d’une « grande illusion »
Pour Mitry, le film phare du réalisme poétique n’était pas Le Quai des Brumes mais Le jour se lève qui marqua indéniablement les esprits surtout par sa construction singulière qui, a posteriori, en fait une œuvre particulièrement clairvoyante et un constat désespéré sur son époque.
Le constat désespéré de la fin d’un monde
À la recherche d’un scénario qui pourrait reformer le trio qu’il formait avec Gabin et Prévert, Carné est enthousiasmé par un synopsis de Jacques Viot et surtout par le procédé de narration que celui-ci a l’intention d’utiliser et qui comprend trois longs retours en arrière et une structure dramatique respectant la règle des trois unités. Il trouvait en revanche que l’histoire était assez inconsistante. Finalement, ce sera celle de François (Jean Gabin), assassin de son rival Valentin (Jules Berry), un ignoble dresseur de chiens. François est assiégé dans sa chambre par la police et il revoit en une nuit les circonstances qui l‘ont conduit au crime. François est un ouvrier sableur, enfant de l’Assistance publique qui s’éprend d’abord de Françoise (Jacqueline Laurent), une petite fleuriste, elle aussi de l’Assistance. Il apprend ensuite que Valentin a sans doute été l’amant de Françoise, celui-ci se vantant de l’avoir séduite pour se venger de François. Il rencontre Clara (Arletty), l’ancienne et sulfureuse maîtresse de Valentin dont il tombe également amoureux. François remonte son réveil pour aller travailler. Valentin vient le provoquer chez lui. Le réveil ne sonnera plus l’heure du travail mais l’heure de la mort comme il aurait pu sonner l’heure inéluctable de la guerre. La police fait évacuer la place et lance des bombes lacrymogènes dans l’appartement, mais François s’est déjà tiré une balle dans le cœur. Le film est sorti le 17 juin 1939, c’est-à-dire quelques semaines seulement avant la guerre.
Le désenchantement du film semblait anticiper sur la déception amère qui submergea la France à la veille du second cataclysme mondial. Comme le destin tragique des personnages scellé par l’armoire mais aussi scellé par le compte à rebours du réveil, le destin tragique de la France semble être scellé. La fin du film en devient donc d’autant plus symbolique : les policiers donnent l’assaut contre François et laissent un espace vide que parcourt un aveugle qui hurle, ne comprenant pas ce qui se passe. L’euphorie du Front Populaire est chassée par la guerre comme les ouvriers par la police, et la succession et le contraste de ces deux évènements diamétralement opposés sont si soudains que le spectateur de l’époque ne comprend pas non plus ce qui se passe. L’innocent est condamné au suicide. Il n’y a plus d’espoir. Il n’y a plus d’avenir.
D’ailleurs, avant même le générique, tout espoir est banni : « Un homme a tué …, enfermé, assiégé dans une chambre. Il évoque les circonstances qui ont fait de lui un meurtrier. » François n’a plus d’espoir. La France n’a plus d’espoir. Le prénom du personnage même semble insister sur la métaphore du désespoir connu alors par l’Etat qui voit la guerre comme un avenir inévitable. Dans cette optique les dialogues prennent alors une étrange résonance. Ainsi, lorsqu’un gendarme répond à une voisine inquiète « Mais vous ne courez aucun danger madame » et qu’on lui répond « On dit ça, on dit ça » on songe autant à la situation inquiétante de la France qu’à celle de François. D’autres répliques font ainsi écho à celle-ci : « On dirait que tout le monde est mort », « vous êtes nerveux parce que vous êtes inquiet et vous êtes inquiet parce qu’il y a des choses qui vous échappent. » Son destin échappe à François comme le destin de la France lui échappe et il s’évanouit dans un dernier cri de désespoir : « François, mais qu’est-ce qu’il a François, y a plus de François, il est mort François. » Cette menace semble être davantage encore mise en exergue par des répliques qui rappellent les idéaux du Front Populaire si proche et pourtant si lointain comme « Le travail c’est la liberté puis c’est la santé. » ou encore les paroles d’Arletty : « la liberté, c’est pas rien. » Ces idéaux sont encore symbolisés par la solidarité dont les amis de François font preuve à son égard.
Cette dichotomie entre une France encore marquée par cette euphorie mais néanmoins consciente du danger qui la menace pourrait se résumer dans cette réplique de Françoise à propos de l’ours en peluche qu’elle compare à François : « vous voyez il est comme vous, il a un œil gai et l’autre qui est un petit peu triste », comme la France partagée entre les réminiscences de la gaieté de 1936 et la tristesse suscitée par le danger imminent.
Une innovation formelle : une homologie esthétique entre la forme et le fond
Ainsi, pour Mitry, la raison de la réussite du film n’en tient pas essentiellement à l’histoire, ni à l’interprétation mais à ce que « le scénario, entièrement bâti sur un retour en arrière construit une structure narrative parfaitement en adéquation avec son contenu. Le flashback n’est plus un flashback plus ou moins judicieusement utilisé pour faire avancer l’histoire mais il devient la figure de style en quoi une homologie esthétique s’instaure entre la forme et le fond, ce à quoi fort peu de films sont parvenus (Citizen Kane de Welles, Vivre de Kurosawa, 8 ½ de Fellini, Providence de Resnais). »
Sans sa construction singulière le film aurait peut-être été noyé dans le flot de ceux du réalisme poétique mais sa construction, son scénario original de Jacques Viot, l’adaptation et les dialogues de Prévert, en ont fait pour beaucoup « le chef d’œuvre du réalisme poétique. » C’est donc la première fois en France qu’on construit entièrement une histoire sur le principe du retour en arrière même si le procédé n’était pas entièrement nouveau puisque Renoir l’avait aussi utilisé dans Le crime de Monsieur Lange, le cinéma muet recourant également à quelques incursions dans le passé de ses personnages, il apparaît néanmoins ici comme novateur. Ce procédé a bien sûr été immortalisé par un mythique film américain, en 1941 : Citizen Kane d’Orson Welles. Il paraissait alors tellement novateur que le distributeur, craignant une réaction négative du public, par mesure de précaution, avait fait précéder le générique du Jour se lève d’un « carton » destiné à expliquer à un public supposé trop ingénu le fonctionnement du « retour en arrière » même si ce procédé avait déjà été utilisé dans un film américain : The power and the glory écrit par Preston Sturges et réalisé par William K.Howard en 1933.
Cette innovation du flashback et de ce film qui se déroule donc en une nuit, du meurtre à l’assaut de la police n’est pas la seule contenue dans Le jour se lève. Il était également audacieux de montrer un ouvrier sur les lieux de son travail, en l’occurrence François dans l’exercice de sa profession de sableur, ce qui était jusqu’alors considéré comme ennuyeux et donc susceptible de lasser le public. Des ouvriers ont donc été mis en scène et ne l’ont été auparavant que dans Toni (1934) et La vie est à nous (1936), encore invisible. Il sera ainsi qualifié de « huis clos prolétarien ». Rarement en effet le cadre de vie de la population ouvrière aura été décrite avec autant de précision, le travail de François n’étant pas un simple cadre mais aussi au centre de certains dialogues, celui-ci évoquant : « le chômage...ou bien le boulot. Ah ! J’ai fait des boulots, jamais les mêmes, toujours pareils…La peinture, le pistolet…ou bien le minium…Pas bon non plus le minium…le sable…et la fatigue…la lassitude ».
Si les décors paraissent réalistes, une observation plus minutieuse permet de constater qu’ils ne sont pas dénués d’expressionnisme à l’exemple de l’immeuble de François démesurément vertical et situé à côté d’un réverbère presque aussi haut que lui. Trauner, le décorateur, avait ainsi insisté pour que le personnage soit isolé, loin et très haut et donc pour que l’immeuble fasse cinq étages et que François soit en haut de celui-ci. Le producteur menace de se suicider quand Carné annonce que cet immeuble fera cinq étages et sera construit aux studios de Joinville mais le réalisateur finira par obtenir gain de cause. Le remake américain de Litvak de 1947 prouve d’ailleurs à quel point ce fut judicieux. Le protagoniste s’y trouve en effet au deuxième étage, ce qui fait perdre toute sa force à ces scènes.
Malgré toutes les précautions du distributeur, le film fut jugé déconcertant par le public, pourtant il fut reconnu tout de suite comme un chef-d’œuvre dont l’envoûtement résulte d’un ensemble : les leitmotiv musicaux de Maurice Jaubert et qui accompagnent les lents fondus enchaînés, la lumière de Curt Courant et le décor de Trauner alliés aux dialogues de Prévert et au jeu contrasté de Gabin qui murmure différemment avec Françoise ou Clara et qui crie face au cynisme de Berry. Pour Bazin, ainsi on « y éprouve le sentiment d’un parfait équilibre, d’une forme d’expression idéale : la plénitude d’un art classique » ou encore René Lehmann dans L’intransigeant en 1939 c’est « un film extrêmement attachant et fort, dont on n’aimera peut-être pas la substance mais qu’on ne pourra pas s’empêcher d’admirer. » ou encore dans La Lumière Georges Altman écrivit en 1939 : « mais c’est là une œuvre d’art sans défaillance ni concession ».
Le jour se lève étant considéré comme le chef d’œuvre du réalisme poétique, on lui imputera donc les défauts ultérieurement reprochés à ce mouvement, le trouvant trop « fabriqué » ou même que le symbolisme était « de pacotille » et la mise en scène « rudimentaire ». Le réveil qui sonne au dénouement du film pour appeler l’ouvrier mort au travail est peut-être jugé « de pacotille » mais le pessimisme du film et justement ce symbolisme témoignent de l’état d’esprit de l’époque avec une étonnante lucidité. Il est vrai que dans ce long-métrage rien ne semble laissé au hasard. Tous les objets ont leur signification et constituent même des personnages du film concourant à cette impression que le dénouement tragique est inéluctable. L’ours en peluche, la broche, les photos, les boyaux de vélo, tout va prendre peu à peu une signification. Ainsi Bazin en a fait une analyse détaillée lui permettant de dresser un véritable portrait anthropomorphique de François et en démontre l’utilisation dramatique et le rôle symbolique en fonction du caractère du personnage de François, le fait qu’il prenne par exemple bien soin de faire tomber dans le cendrier la cendre de cigarette qui macule le tapis de la chambre : « Tant de propreté et d’ordre un peu maniaque révèle le côté soigneux et un peu vieux garçon d’un personnage et frappe le public comme un trait de mœurs ». L’armoire joue alors un rôle central :« Cette armoire normande que Gabin pousse devant la porte et qui donne lieu à un savoureux dialogue dans la cage d’escalier entre le commissaire et le concierge (…). Ce n’est pas la commode, la table ou le lit que Gabin pouvait mettre devant la porte. Il fallait que ce fut une lourde armoire normande qu’il pousse comme une énorme dalle sur un tombeau. Les gestes avec lesquels il fait glisser l’armoire, la forme même du meuble font que Gabin ne se barricade pas dans sa chambre : il s’y mure. »