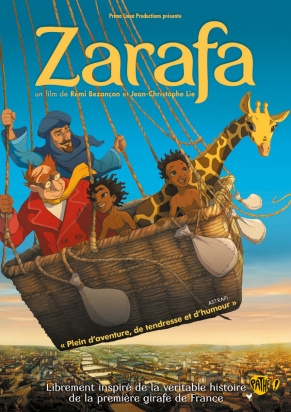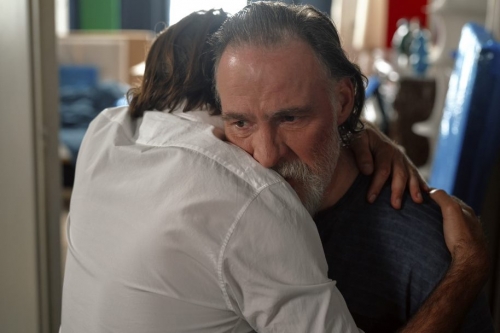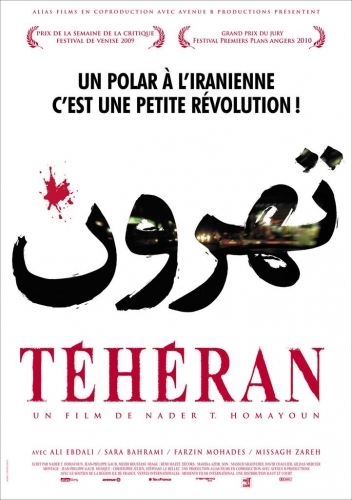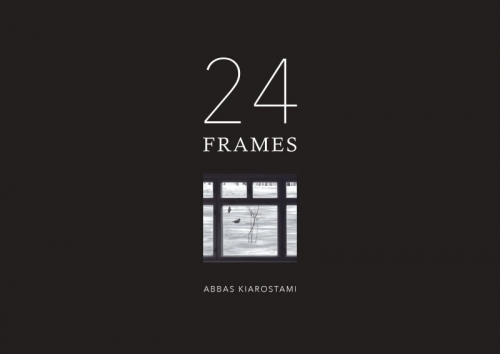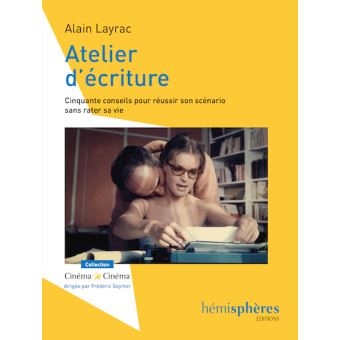Critique Le REPAIRE DES CONTRAIRES de Léa Rinaldi (au cinéma le 1er novembre 2023)

Selon Robert Bresson, « ce qui est beau au cinéma, ce sont les raccords, c'est par les joints que pénètre la poésie. »
De la poésie. Et des fascinants contrastes. Voilà ce qui se dégage avant tout du nouveau documentaire de Léa Rinaldi, une poésie et des contrastes déjà contenus dans le titre, nom de la magnifique compagnie sur laquelle la réalisatrice porte son regard aiguisé. Une poésie qui surgit là où on ne l’attend pas, et qui exhale alors d’autant plus de force. Une poésie et des contrastes présents dès les premiers plans. Dans les flaques d’eau qui reflètent le gris des immeubles et le bleu du ciel. Dans le visage grave, coloré et chatoyant d’un enfant grimé en Indien devant le portrait de Rimbaud. Dans cet arbre devant un immeuble. Ou plus tard, dans les ballons multicolores qui s’envolent devant des immeubles. Et dans les sons, de la ville, mais surtout de la musique d'inspiration indienne. A la radio du véhicule qui circule dans la cité, judicieusement, par la voix d’une journaliste qui en émane, nous est présenté le cadre du documentaire. Celui de Chanteloup-Les-Vignes (encore un nom riche de contrastes !), « une des banlieues les plus défavorisées de l’ouest parisien, des hlm défraichis, des rues tristes, des enfants souvent livrés à eux-mêmes ». Et son quartier de la Noé, « véritable tour de Babel », avec « jusqu’à 50 nationalités », « ses rixes, son trafic de drogue ». Mais ce n’est pas à cela que va s’intéresser le documentaire qui plante ainsi astucieusement le décor. Au désespoir, Léa Rinaldi oppose un lieu synonyme d’espoir qui déjoue la fatalité. Un lieu de liberté en opposition à ces immeubles où on « se ronge les doigts ». Le repaire des contraires.
Ce n’est pas au décor mais à des personnalités que s’intéresse avant tout Léa Rinaldi : le cinéaste indépendant Jim Jarmusch, les rappeurs Los Aldeanos, le marin Ian Lipinski. Et cette fois la metteuse en scène Neusa Thomasi. Plus qu’une personnalité, un vrai personnage. Et quel personnage ! De ceux qui semblent émaner d’une fiction. Comme à chaque fois, Léa Rinaldi s’intéresse à des individus marginaux qui évoluent dans des milieux conflictuels, voire hostiles, mais qui restent tournés vers les autres, animés par leur passion. Réalisatrice et productrice indépendante, spécialisée dans le documentaire d’immersion, Léa Rinaldi s’intéresse avant tout à leur « vision singulière de l’existence ». Avec sa société aLéa Films, elle a ainsi porté de nombreux projets documentaires au cinéma. Après le diptyque Behind Jim Jarmusch (2011) / Travelling at night with Jim Jarmusch (2013) sur le réalisateur américain, elle réalise Esto es lo que hay, chronique d’une poésie cubaine (2015), le portrait intime d’un groupe de rap cubain contestataire à l’heure de la transition du régime castriste. En 2019 sort Sillages, son film sur la traversée atlantique solitaire de Ian Lipinski, double vainqueur de la Mini-Transat. Le Repaire des Contraires sortira en salles le 1er novembre 2023. En latin, aléa signifie « jeu de dés », « métaphore du défi que représente la réalisation d’un film en immersion complète avec ses protagonistes, avec la part de hasard liée aux rencontres et à l’instant présent ». Et il faut dire que dans ce documentaire, le hasard s’en est donné à cœur joie…
Léa Rinaldi a ainsi posé sa caméra à Chanteloup-les-Vignes, banlieue la plus pauvre d’île de France située à 30km au nord de Paris. En contrebas de la ville se trouve la cité de la Noé, un grand ensemble qui, dans les années 1990, était complètement marginalisé. Les trois quarts des habitants de la ville vivaient alors dans des logements sociaux. Cette ville, jusque dans les années 90 surnommée Chicago en Yvelines, a été rendue célèbre par le film La Haine qui y fut tourné. Le film de Léa Rinaldi pourrait être le « repaire » du « contraire » de celui de Kassovitz. Ici dominent la couleur et l’amour que la metteuse en scène Neusa Thomasi porte à son art et à ses "élèves". Personnalité forte, atypique, fascinante, haute en couleurs, on comprend aisément que Léa Rinaldi se soit décidée à réaliser ce documentaire après avoir rencontré la metteuse en scène brésilienne. Ainsi raconte-t-elle leur rencontre à l’origine de ce documentaire : « Conseillée par des amis communs, Neusa est un jour venue toquer à la porte de ma société de production, vêtue de plumes et de bottes colorées, pour me présenter ce nouveau projet de construction de cirque social. Car cette femme indépendante voit enfin son action reconnue par la municipalité: Un chapiteau en dur, financé par la mairie, sera construit et Neusa en deviendra la résidente permanente. Je crois qu’il faut faire un film... Il va y avoir du spectacle ! » m’avait-t-elle prévenue ! ».
La metteuse en scène engagée est ainsi restée en France après une tournée de théâtre, vivant d’abord comme immigrée sans papiers. Cette femme, véritable personnage de cinéma, par son humanité, sa parole libre, franche et singulière, son engagement, sa combattivité, son rôle primordial dans la cité et sa passion méritait sans aucun doute un portrait. Dommage qu’il ait fallu que son chapiteau parte en fumée pour que les politiques et médias s’intéressent à son travail. Lorsqu'en 1993, elle vient présenter sa pièce, elle découvre un désert culturel où les populations n’arrivent pas à cohabiter. Malgré tout, elle décide de rester et de créer la Compagnie des Contraires. Son objectif : utiliser les arts du spectacle comme outil pour créer du lien social et offrir aux jeunes un lieu d’expression libre. La Compagnie est d'abord itinérante. Elle sillonne la ville à la rencontre des habitants pour leur proposer des ateliers créatifs. Au fil du temps, son action va progresser jusqu'à la construction en 2018 d'un chapiteau permanent, financé par la région et destiné à accueillir tous les enfants de Chanteloup, Le Repaire des Contraires, un endroit où s’exprimer librement, où tous les rêves sont permis et ce, grâce aux arts du cirque. Elle se lance pour défi de recréer du lien social grâce à l’art et à l’éducation populaire. La Compagnie des Contraires est un véritable refuge pour les enfants de la cité ; une bulle de poésie, où l’art prend vie au milieu du béton. Avec sa compagnie, elle cherche à fédérer les jeunes de la ville autour de la création artistique et espère ainsi renouer les liens sociaux qui manquent à la banlieue. Au fil des années, la compagnie est parvenue à s’implanter, jusqu’à ce que la mairie décide de financer la construction d’un lieu permanent, au pied des tours de la cité de la Noé. Malheureusement, dans la nuit du 2 novembre 2019, le chapiteau est ravagé par un incendie criminel qui réduit en cendres tout le bâtiment. Dévastées par cet événement, Neusa et sa troupe devront redoubler d’efforts pour survivre à cette tragédie et reconstruire.
Ce film a été tourné sur trois années. Témoignage du combat d’une « guerrière » confrontée aux réalités souvent âpres d'un territoire auxquelles elle oppose la poésie, l'art, l'espoir, il se penche sur les aléas de la vie du chapiteau, mais aussi en particulier sur parcours de quatre enfants qui s'émancipent et évoluent grâce à cela. La diversité de leurs âges et origines socio-culturelles constitue une richesse, un atout de ce lieu fédérateur et hors du commun. Vous n’oublierez pas Marwan, Joachim, Saibatou et Victoria, l’intelligence de leur discours, la passion qui pétille dans leurs yeux, et leur talent éclatant qui sans doute serait à jamais resté en sommeil sans ce cirque et sans l'aide de Neusa. Grimés en Indiens, comme les guerriers conquérants qu’ils sont eux aussi, ou leurs beaux visages à nu, ils ont toute leur place sur « la place des poètes » devant les visages de Paul Valéry, Arthur Rimbaud et Victor Hugo, et l’énorme « pied » en sculpture, présent dans le film de Matthieu Kassovitz. C’est un tout autre visage de la ville que montre Léa Rinaldi, une ville bigarrée, colorée, riche de ses contrastes, loin du noir et blanc de Kassovitz avec ses barres d’immeubles hostiles. Ici, il y a de la joie, de la poésie, de l’espoir, de la renaissance, de la verdure. Cette verdure qui résiste même à l’incendie, comme le souligne Neusa : « Les arbres n'ont pas vraiment brûlé, un signe de renouveau. La nature est plus forte que l'homme. La nature sera toujours plus forte que l'homme. »
Au cœur de cette cité, en son cœur battant, il y a donc Neusa avec son énergie communicative et sa parole lucide, qui aime passionnément cette ville sans en édulcorer les aspérités, les blessures et les faiblesses, comme elle ne cache rien aux enfants de la dureté de la vie : « Tout est un passage dans la vie. La vie c’est un passage. » « On pleure quand on arrive. On pleure quand on en repart et on n’en repart pas. » « L'être humain manque de passion et parfois il n'arrive pas à les réaliser, quand il n'arrive pas il devient fou, notre société est une machine à créer des fous. » Comme souvent, ce sont les êtres qui ont survécu au pire et n’ont pas cédé à l’aigreur mais se sont tournés vers les autres qui sont les plus passionnants. Neusa raconte ainsi avoir été rejetée par ses deux parents qui attendaient un garçon, avoir été battue jusqu’à ses 17 ans, avoir eu une approche de la mort quotidienne, un "désir de la mort quotidien", et ne pouvoir vivre sans « conscience de la mort », raison pour laquelle elle parle aux enfants de la mort comme « quelque chose de léger », pour « démythifier la peur de la mort».
Ce documentaire est aussi passionnant pour ses contradictions, ce qu’il dit de notre société et de notre époque, de ses béances et ses forces, en ce que ce lieu de « création artistique pour tous » émerge dans une cité réputée pour sa violence. Pour que la compagnie puisse jouer, Neusa a parfois été en danger de mort. Certaines personnes ne voulaient pas de la présence de compagnie. Le chapiteau a été incendié lorsqu’il est devenu un lieu municipal. La réalisatrice exprime cela comme ayant pu provenir « de jalousies ou de l'ignorance de certains habitants, comme cela aurait pu émerger des suites de bavures policières, du démantèlement de réseaux de trafics de drogue, etc. Son succès a mis trop de lumière dans ce quartier, qui préférait rester dans l’ombre…Peut-être aussi ont-ils attaqué le chapiteau car il est le symbole du travail de deux femmes, Neusa et Catherine Arenou, mairesse de Chanteloup. L’importance de leurs contributions a pu attirer les regards et les foudres de certains misogynes. En outre, c’est un lieu très résilient qui renaît déjà de ses cendres. Et cela peut aussi déranger. »
Le documentaire est aussi singulier et captivant en raison de son attention au son et à l'utilisation astucieuse de la musique, intradiégétique et extérieure, dont il est très empreint, avec notamment la magnifique musique composée par Julien Tekeyan, ou celle accompagnant des séquences contemplatives magnifiant l’image, mettant en exergue avec lyrisme le travail des enfants, notamment sur un sublime requiem de Mozart.
Avec ce documentaire, riche de lumière et d'humanité, et sa caméra toujours à bonne distance, comme celle qu'elle filme, respectueuse et engagée, Léa Rinaldi porte un regard différent et salutaire sur la banlieue. Ce cirque y devient un symbole de réussite, d’harmonie et d’intégration, riche de ses contrastes et paradoxes, un monde d’évasion pour les enfants, faisant de leurs différences une force et les réunissant dans la même passion, un espace de respiration et de rêve, mais aussi un symbole d’obstination et d’espoir avec la renaissance du chapiteau après l’incendie, témoignage de la ténacité et la solidarité de la compagnie dans l’adversité. Comme son sujet, ce documentaire a été un combat, et comme son sujet, il est une bulle de poésie et d’utopie, « un lieu de lumière, de liberté», « l’éclat d’une luciole dans la nuit ». Nous restent en mémoire : les couleurs qui inondent ce film, la joie, la poésie, les visages d’enfants face caméra, leurs numéros impressionnants sur la musique lyrique. Des images qui survivent aux cendres, et en effacent le souvenir. La vie et l'art plus forts que tout. Et bien sûr la personnalité fascinante de Neusa. On aurait envie d’en voir encore plus sur son travail comme celui, passionnant, qu'elle effectue sur Jean de Florette, cet « étranger qui arrive dans petit village », symbole de la « peur de la culture de l'autre », cette « méconnaissance de la culture de l'autre qui donne de la discrimination », cet « homme cultivé qui parle un vrai français qui aime la poésie, les fleurs et la culture française. »
Un documentaire à l'image de son sujet : riche de ses contrastes et contraires, entremêlant brillamment poésie et réalité, âpreté de la vie et utopie, d’autant plus nécessaire en ces temps troublés qu'il met en lumière un lieu de (ré)conciliation (« on est une famille avec ce cirque ») qui exalte le pouvoir de l’art, qui réunit ceux qui se côtoient sans se connaître et crée du lien social, là où « le contraire engendre la vie ». Ne le manquez pas ! Voilà qui me rend d’autant plus impatiente de découvrir le premier long-métrage de fiction de Léa Rinaldi, Des Rives qui « raconte l’histoire d’une jeune trentenaire qui hérite du bateau à voile de son père et se lance dans une croisière pirate qui l’amènera à rencontrer toutes sortes de migrations (politiques, écologiques, touristiques, trafics, etc.) »
Pour en savoir plus sur la compagnie : http://www.compagniedescontraires.com/lacompagniedescontraires.html