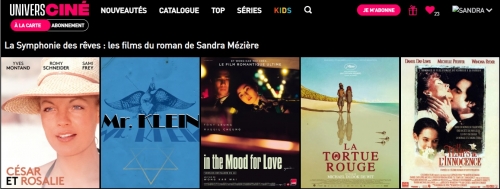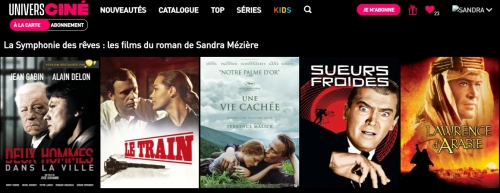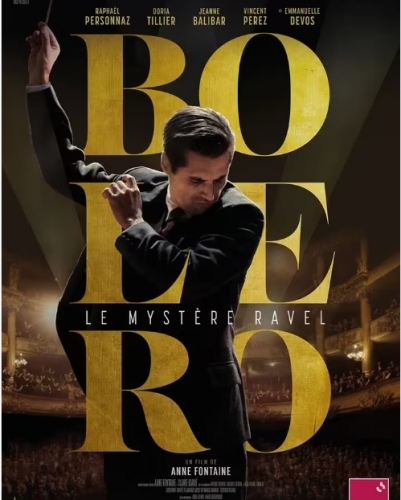Critique de HORS-SAISON de Stéphane Brizé

Sélectionné en compétition de la 80ème Mostra de Venise, Hors-saison est le 10ème film de Stéphane Brizé, deux ans après Un autre monde.
Mathieu (Guillaume Canet) est acteur. Il vit à Paris et vient passer une semaine de thalassothérapie en Bretagne, dans un hôtel en forme de paquebot situé dans une petite cité balnéaire. Il l’ignore mais c’est là que vit désormais Alice (Alba Rohrwacher), professeure de piano, qu’il a aimée quinze ans plus tôt, puis quittée. Évidemment, la présence de l’acteur parisien en ces lieux ne passe pas inaperçue, et arrive aux oreilles d’Alice. Elle lui laisse un mot à la réception de son hôtel. Il la rappelle…
Cela commence et cela s’achève par une voiture filmée en plongée qui arrive, puis repart. Entre les deux, une parenthèse de vie hors-saison, douce, parfois burlesque, surtout mélancolique.
Quand Mathieu arrive dans ce décor grisâtre, même la mer semble déprimer, d’un bleu gris triste à pleurer. Le premier client de l’hôtel que Mathieu aperçoit est un vieil homme en peignoir qui avance, péniblement, grâce à un déambulateur. Le hall est désert, grand, clinique, froid. Mathieu est lui aussi filmé en plongée, perdu au milieu de cet univers aseptisé. Sa femme (Marie Drucker, dont on entendra simplement la voix), présentatrice du journal télévisé, semble lui faire une faveur quand elle lui accorde royalement deux minutes au téléphone lorsqu’il essaie de lui faire part de son mal-être, et d’évoquer les raisons pour lesquelles, 4 semaines avant la première, il a abandonné la pièce de théâtre dans laquelle il devait jouer. Elle se contente de répéter « Quel est le problème ? » ou « Quelle est la question ? », comme si tout était une affaire de bien ou de mal, de rentabilité, comme si elle avait face à elle un de ses invités récalcitrants. Pour elle, c’est un « dossier classé. »
Mathieu se retrouve seul dans sa chambre, dépassé : par la machine à café, par des scénarios insipides qu’il doit lire, par ses larmes qui jaillissent. « Tout va bien mais le tout va pas bien », dit-il à Alice. À l’extérieur, il a tout de celui qui a réussi. À l’intérieur, cela ressemble plutôt au chaos. Il s'évertue pourtant à afficher l’image de réussite que les autres lui renvoient.
Guillaume Canet est particulièrement convaincant et émouvant dans le rôle de cette sorte de double mélancolique, en proie aux questions existentielles et aux doutes, face à la peur de ne pas être à la hauteur dans ce premier rôle au théâtre, et dans la vie.
Le décor reflète cet entre-deux, ce désespoir, ce vide, d’une effroyable modernité, faussement parfait. La ville est endormie, les volets sont fermés, la plage et les rues sont désertes. Plus de caméra à l’épaule comme dans les derniers films de Stéphane Brizé pour refléter le chaos. Ici c’est plutôt l’immobilité qui tétanise. Le chaos est invisible, doit être masqué.
Face à Guillaume Canet, Alba Rohrwacher est lumineuse, mystérieuse, bouleversante. Elle semble s’être construit une vie avec son mari et sa fille. Mais quand cet amour qu’elle n’a jamais oublié ressurgit, les émotions contenues toutes ces années, elles aussi, ressurgissent.
Le film est émaillé de scènes burlesques, de la rencontre drôle et décalée entre deux mondes, avec ce professeur de « sport mystique » que Mathieu regarde comme un extraterrestre quand il lui dit être en retard parce qu’il s’est arrêté pour contempler un oiseau. Mais, même lors des scènes burlesques, la mélancolie affleure toujours joliment, tendrement. Comme lors de ce mariage, où enfin les couleurs remplacent le gris de la thalasso et de la mer, lors duquel les Chanteurs d’oiseaux (Johnny Rasse et Jean Boucault) suscitent une complicité silencieuse. Stéphane Brizé sait nous décontenancer aussi, avec cette rupture de ton, ce long récit de la mariée, une vidéo envoyée par Alice à Mathieu, qui nous émeut, de concert avec lui.
Je n’ai jamais cessé de suivre et d’aimer le cinéma de Stéphane Brizé depuis la découverte de son premier film au Festival du Cinéma Américain de Deauville 1999 où il avait obtenu le prix Michel d’Ornano. Je l’ai toujours comparé à Claude Sautet, en ce qu’il s’attache et nous attache à des personnages qui nous accompagnent après le générique de fin, qui « existent ». Comment oublier le Amédéo (Vincent Lindon) du film En guerre ? Cet homme constamment en colère, dévoré par son engagement, sa rage de défendre et de résister ? Comment oublier ce dénouement qui nous saisit et nous laisse KO d’émotion, a contrario de l’analyse clinique de la chaîne d’information qui le relate ? Comment oublier Thierry, de nouveau incarné par Vincent Lindon, dans La loi du marché, un homme de 51 ans qui, après 20 mois de chômage commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral ?
Les personnages de ses films d’amour sont tout aussi inoubliables. En 2005, dans Je ne suis pas là pour être aimé, nous suivions Jean-Claude Delsart (Patrick Chesnais) qui, dans les premiers plans, monte l’escalier d’un immeuble, essoufflé, haletant, lassé. Essoufflé par la situation autant que par sa vie. Comme la protagoniste du Bleu des villes, il a un métier a priori plutôt ingrat (huissier de justice), il ne nous apparaît pas « aimable » (dans les deux sens du terme) d’emblée. Sa vie routinière, monotone, se partage entre le cadre claustrophobique de son étude, grisonnante, voire sinistre, et celle de la chambre de la maison de retraite de son père, un père irascible. Et puis un jour la fenêtre de son étude s’ouvre et, de là, on découvre l’appartement qui lui fait face, s’y oppose même : celui où sont donnés des cours de tango dans une ambiance chaleureuse. Les couleurs du lieu sont aussi chaudes que celles de l’étude sont froides, la musique emplit autant le lieu que le silence de l’étude la vide. Une fenêtre s’ouvre aussi dans son existence. Ses désirs, ses échecs enfouis se réveillent soudain, ses « bleus » à l’âme aussi. Là pourrait avoir été résumé tout le film, pourtant c’est bien plus que cela. Quelle danse plus sensuelle que le tango ? C’est avec cette même sensualité que Stephan Brizé filme ses personnages, filme celle qui s’empare peu à peu d’eux, un trouble imperceptible capté par la caméra : une main qui progressivement se rapproche d’une épaule, le frémissement d’un visage, et sans dialogues, le temps d’une danse, par son talent de réalisateur et par celui de son acteur principal, une histoire qui naît de manière indicible, avec la noblesse du silence. Les scènes dialoguées sont tout aussi réussies : percutantes, cruelles parfois (scènes de famille de la future mariée en proie aux doutes, scènes avec son père, etc) aux accents de réalité indéniables.
En 2009, avec Mademoiselle Chambon, il nous racontait l’histoire de Jean (Vincent Lindon), maçon, bon mari et père de famille, qui croise la route de la maîtresse d'école de son fils, Mademoiselle Chambon (Sandrine Kiberlain), leurs sentiments réciproques vont s'imposer à eux. Les mots sont impuissants à exprimer cette indicible évidence. On retrouve cette tendre cruauté et cette description de la province, glaciale et intemporelle. Ces douloureux silences. Cette sensualité dans les gestes chorégraphiés, déterminés et maladroits. Cette révolte contre la lancinance de l'existence. Et ce choix face au destin. Cruel. Courageux ou lâche. (Magnifique scène de la gare dont la tension exprime le combat entre ces deux notions, la vérité étant finalement, sans doute, au-delà, et par un astucieux montage, Stéphane Brizé en exprime toute l'ambivalence, sans jamais juger ses personnages...). On retrouve aussi cet humour caustique et cette mélancolie grave, notamment dans la scène des pompes funèbres qui résume toute la tendresse et la douleur sourdes d'une existence et qui fait écho à celle de la maison de retraite dans Je ne suis pas là pour être aimé.
On retrouve tout cela aussi dans Hors-saison. Mais surtout des personnages infiniment touchants et justes lorsqu’ils laissent apparaître leur vulnérabilité, leurs vérités à nu, leurs regrets, leurs faiblesses, leurs peurs. Un film qui, malgré la grisaille qui l’environne, nous enveloppe de chaleur, nous réconforte, nous embarque dans cette parenthèse mélancolique, comme pour nous dire qu’il existe toujours un hors-saison pour réparer le passé, et repartir un peu moins blessé vers l’avenir, comme pour nous dire qu’il est permis de tomber, que la vie n’est pas toujours une saison ensoleillée mais que le soleil peut surgir aux moments les plus inattendus, au creux de l’hiver. Ou avec quelques notes de Vincent Delerm (auteur de la BO, là aussi teintée de douce mélancolie, comme la photographie d'Antoine Héberlé). L’acteur qu’incarne Guillaume Canet a un peu du Bill Murray de Lost in translation (comme ce dernier dans son hôtel japonais, il est un peu perdu dans un univers hostile), avec ce mélange de drôlerie, de poésie, d’élégance. Les dialogues (le scénario, particulièrement sensible et subtil, est coécrit par Marie Drucker et Stéphanie Brizé) sont eux aussi toujours à la lisière entre humour et mélancolie, nuancés comme la vie. Et les silences sont aussi porteurs d'émotions (magnifique scène de danse, à nouveau), parabole amoureuse tout en pudeur et délicatesse. Un film dont on ressort apaisé. L’effet de la thalasso ? Non, d’un scénario ciselé, et de deux interprètes entre lesquels l’alchimie fonctionne merveilleusement. De leur couple se dégage un charme irrésistible qui inonde tout le film. Un tendre coup au cœur et de cœur pour ce film, et ces personnages une fois de plus dans un film de Brizé, forts (de leurs fragilités) et inoubliables.