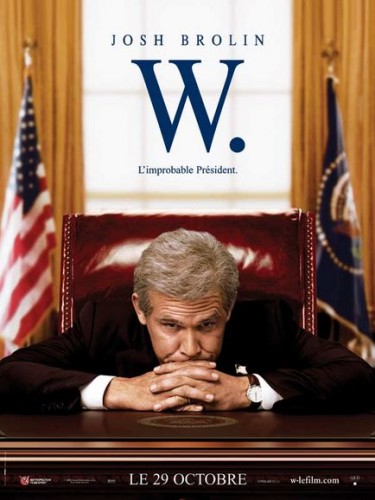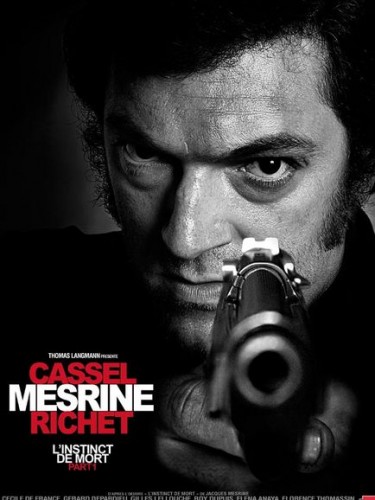« The Visitor » de Thomas McCarthy : Grand Prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2008
La semaine dernière sortait en salles « The Visitor », le film auquel fut décerné le Grand Prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2008 par le jury présidé par Carole Bouquet, le seul de la compétition que j’avais manqué et que j’étais donc impatiente de voir. A l’heure à laquelle les Etats-Unis retrouvent un nouvel espoir et un nouvel élan, ce film apporte un éclairage édifiant sur les dysfonctionnements et les injustices du système américain et de nouveau sur l’immense attente que suscite le nouveau président américain Barack Obama.
Professeur d'économie dans une université du Connecticut, Walter Vale (Richard Jenkins), la soixantaine, est englué dans sa routine : il ne donne d’ailleurs plus qu’un cours par semaine, depuis 20 ans. Son seul loisir consiste à apprendre le piano, d’ailleurs sans grand enthousiasme. Lorsque l’Université l’envoie à Manhattan pour lire un article qu’il a cosigné (où il part seulement parce qu’on l’y oblige), il découvre qu’un jeune couple s’est installé dans l’appartement qu’il y possède : Tarek (Haaz Sleiman), d’origine syrienne et, et Zainab (Danai Jekesai Gurira), sa petite amie sénégalaise. Comme ils n’ont nulle part où aller, Walter leur propose de rester. Si Zainab est très réticente et méfiante, en revanche, Tarek, touché par la gentillesse de Walter, lui apprend le djembé. Malgré (ou grâce à) leurs différences, les deux hommes deviennent amis et Walter retrouve un sens à sa vie et lorsque Tarek est arrêté dans le métro, emprisonné, et menacé d’expulsion, Walter fait tout pour lui venir en aide…
Si la portée du film est évidemment politique, du moins sociale, son propos n’est jamais appuyé. C’est avant tout l’histoire de deux hommes, ou même de quatre personnages (la mère de Tarek interprétée par Hiam Abbass va les rejoindre) qui a priori n’auraient jamais dû se croiser mais que la magie et les aléas de l’existence font se rencontrer, et changer. Les personnages, à l’image du scénario et de la mise en scène, sont d’une grande pudeur et sobriété, et ne tombent jamais dans les clichés.
Si ce film nous montre (sans jamais démontrer avec ostentation), à travers l’exemple d’un drame humain, les conditions inhumaines de détention et d’expulsion des immigrés clandestins aux Etats-Unis et les conséquences d’une politique d’immigration rigide mais aussi de la paranoïa post 11 septembre, c’est aussi un hymne à la musique, la musique qui peut relier deux personnes que tout pourrait opposer, la musique qui leur sert de langage commun et qui transcende les différences, la musique qui redonne goût à la vie. Un échange et un enrichissement.
« The visitor » ce pourrait d’ailleurs autant être Walter que Tarek : Walter qui rend visite à Tarek en prison mais aussi Tarek qui en s’installant chez Walter lui redonne le goût de vivre, Walter qui au début du film regarde la vie s’écouler derrière sa fenêtre et à la fin est « dans » la vie, dans sa belle et redoutable violence. Le djembé va devenir son cri de révolte et de vie, l’allié et le réceptacle de ses sentiments.
Les 4 acteurs sont judicieusement choisis au premier rang desquels Richard Jenkins (habituellement abonné aux seconds rôles, qui trouve là son premier grand rôle), parfait en faux misanthrope retrouvant le goût des autres et de la vie, tout en retenue, mélancolie et révolte contenue qui explose dans une très belle scène où il crie son impuissance face au mur infranchissable de l’injustice, face au terrifiant silence de l’administration.
Ce film poignant est empreint de la douceur mélodieuse d’un air de piano et de la force entraînante du djembé, il vous ensorcelle doucement, vous parle de deuil, de retour à la vie, d’injustice, de tolérance, de solitude, sans jamais être moralisateur ou didactique, mais il est alors plus parlant que n’importe quel discours.
Avec ce second film après « The Station Agent », Thomas Mc Carthy (qui est également acteur) nous donne à voir une autre Amérique que celle des blockbusters avec un regard empli d’empathie, de justesse, de sensibilité et nous embarque avec ses personnages que nous quittons, laissons, à leur rage et désespoir, avec regrets, mais que nous embarquons avec nous bien plus loin et bien après le générique de fin, avec, en mémoire, le tempo douloureusement répétitif et le son sublimement retentissant du djembé, lors de la dernière scène, terrible et magnifique.
Pour tout savoir sur le 34ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, rendez-vous sur mon blog consacré à celui-ci. Je reste persuadée qu’ « American son » de Neil Abramson aurait mérité de figurer au palmarès…
Site officiel du film: http://www.tfmdistribution.com/thevisitor/
Sandra.M