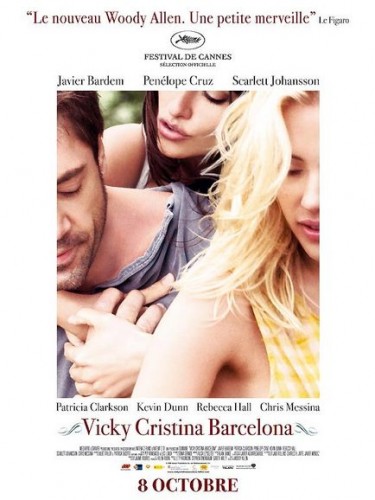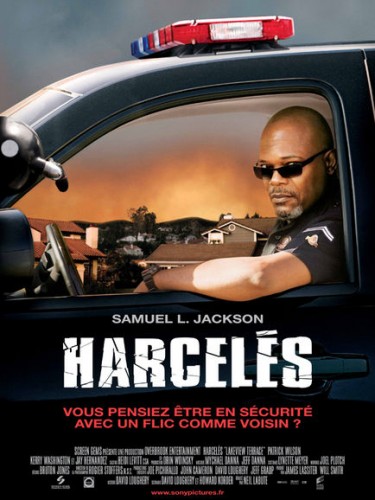"Le crime est notre affaire": la comédie policière réjouissante de Pascal Thomas
Arrivée juste à temps pour voir le générique du film (de début, hein, je précise, je ne fais pas comme certains critiques qui arrivent dix minutes après le début ou partent dix minutes avant la fin…), sans grande envie de le voir mais avec pour objectif de satisfaire ensuite ma frénésie d’écriture ( de tout ce qui est à portée de clavier, j’ignore si ça se soigne et n’en ai d’ailleurs pas envie…) par une critique cette fois-ci donc, eh bien j’ai été très agréablement surprise par ce film dont je n’attendais rien d’autre que matière à satisfaire mon insatiable soif d’écriture. J’aurais d’ailleurs dû me souvenir de « L’heure zéro » du même Pascal Thomas, un film vu à Dinard lors du Festival du Film Britannique et dont l’intrigue se déroulait d’ailleurs dans la cité balnéaire bretonne en question. Auparavant, Pascal Thomas avait déjà signé « Mon petit doigt m’a dit » qui mettait déjà en scène Prudence et Bélisaire Beresford sous les traits de Catherine Frot et André Dussolier, un succès autant dans les salles (1 200 000 spectateurs) que dans les critiques qu’il pourrait bien renouveler cette fois-ci.
Prudence et Bélisaire Beresford (colonel des services secrets à la retraite) se reposent désormais dans leur château qui domine le lac du Bourget. Prudence qui trouve qu’elle dégage une odeur de vieux ne déteste rien tant que se reposer. Elle rêve qu’un mort titubant frappe à la porte et vienne les sortir de leur léthargie, les plongeant dans une affaire palpitante et mystérieuse. Cela tombe bien : sa pittoresque tante belge Babette (Annie Cordy) a assisté à un crime de la fenêtre du train. Bien que Bélisaire soit incrédule, Prudence (la mal nommée) part à la recherche du cadavre et se fait employer comme cuisinière dans une inquiétante demeure (dont les habitants le sont au moins autant) où elle est persuadée qu’elle trouvera des indices. Entre un vieillard irascible, le père de famille (Claude Rich), et ses quatre enfants qui attendent l’héritage (interprétés par Chiara Mastroianni- ici, mélancolique à souhait, et qu’on ne voit d’ailleurs pas suffisamment au cinéma-, Melvil Poupaud, Christian Vadim, Alexandre Lafaurie) elle n’est pas au bout de ses surprises. Et nous non plus…
Les surprises ne résident d’ailleurs pas là où on pourrait les attendre dans une adaptation d’Agatha Christie, à savoir dans la résolution de l’intrigue, finalement ici secondaire, les suspects n’étant pas bien nombreux et le coupable facilement identifiable… mais que cela ne vous surtout arrête pas ! Si vous aimez Agatha Christie, vous retrouverez le second degré, l’ironie, le ton même parfois irrévérencieux de l’auteur que Pascal Thomas a librement et intelligemment adaptée.
Je pourrais reprendre ma critique de « L’heure zéro » et l’adapter à ce film qui présente les mêmes ingrédients avec tout de même des qualités supplémentaires et avant tout le couple savoureux formé par André Dussolier et Catherine Frot, « Hercule Poirot en deux personnes » pour reprendre l’expression utilisée par Pascal Thomas...avec les fameuses petites cellules grises qui vont avec. Le film s’inspire ainsi du recueil « Partners in crime » dans lequel Tommy et Tuppence Beresford mènent l’enquête et l’intrigue est similaire à celle du « Train de 16H50 » (dans lequel l’enquête est néanmoins menée par Miss Marple).
Ce qui fait d’abord le charme convaincant de ce film, c’est le talent de Catherine Frot (j’ai beau avoir vu et revu « Un air de famille » un nombre incalculable de fois, je l’y trouve toujours aussi remarquable et hilarante), dont le personnage prend un malin plaisir à mener son enquête, et que l’actrice semble prendre aussi un plaisir à interpréter, et nous à la suivre dans ses rocambolesques péripéties. Elle est rayonnante, virevoltante, malicieuse et elle forme avec André Dussolier un couple impertinent et libre comme on aimerait en voir plus souvent au cinéma. Leur élégance imprègne tout le film : des décors aux dialogues, savoureux. Ni leurs personnages ni ceux qui les interprètent ne redoutent l’autodérision comme quand André Dussolier se prend, malgré lui, pour Marilyn Monroe dans « Sept ans de réflexion ». Leur couple a un côté touchant qui, si le scénario avait quelques faiblesses, nous les ferait oublier tant nous les suivons avec plaisir et intérêt, voire jubilation, d’autant plus que les membres de la famille où s’est fait employer Prudence se détestent tous cordialement, mettant ainsi en valeur leur complicité.
Comme dans ses précédents films adaptés d’Agatha Christie, Pascal Thomas brouille astucieusement les repères entre les temporalités. Si l’intrigue se déroule de nos jours, ses personnages ont un caractère intemporel, ses décors et ses costumes un air joliment désuet qui nous embarquent dans son univers distrayant, et pas seulement.
Si vous voulez passer une heure trente (un peu plus même) réjouissante en joyeuse compagnie, alors ce crime-là sera aussi votre affaire, préférez-le au « Grand Alibi » de Pascal Bonitzer -voir ma critique ici: http://www.inthemoodforcinema.com/archive/2008/04/16/avant-premiere-le-grand-alibi-de-pascal-bonitzer-au-cinema-l.html - (autre adaptation récente d’Agatha Christie) qui n’en avait ni la saveur, ni l’originalité. Un film à l’image de son affiche : (re)bondissant, coloré, décalé, joyeux.
Sandra.M