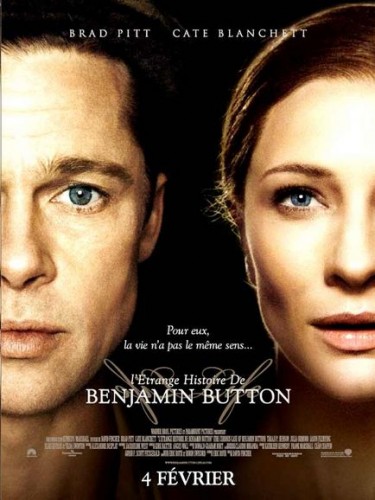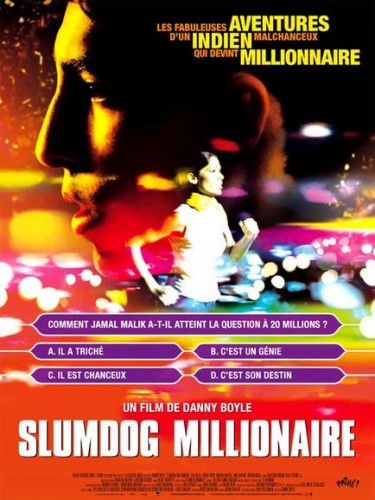"Le code a changé" de Danièle Thompson
Dans le cinéma de Danièle Thompson, on retrouve souvent les mêmes "codes" : un film choral (« La bûche », « Fauteuils d’orchestre »…) qui voit se croiser les destins de plusieurs personnages, des personnages le plus souvent parisiens ou du moins vivant à Paris (Paris étant souvent un personnage à part entière) engoncés dans des conventions sociales ou dans leurs masques sociaux factices censés voler en éclats au cours du film. Le cadre de son nouveau film (le quatrième en temps que réalisatrice) est idéal pour ce jeu des apparences puisqu’il s’agit d’un dîner donné par ML (Karin Viard), avocate redoutable spécialisée dans les divorces, et son mari Piotr (Dany Boon), chômeur, le soir de la fête de la musique. Il y a là aussi : Jean-Louis (Laurent Stocker) qui a conçu la cuisine où se déroule le dîner et amant de ML, Juliette (Marina Hands), la sœur de ML accompagnée de son ami qui a l’âge d’être son père (Patrick Chesnais), son père justement (Pierre Arditi) à qui cette dernière n’adresse plus la parole depuis 2 ans caché dans une chambre de la maison pour ne pas croiser sa fille, Lucas, (Christopher Thompson) le futur collaborateur de ML et sa femme Sarah (Emmanuelle Seigner), Alain (Patrick Bruel) et Mélanie (Marina Foïs), le couple de médecins, lui cancérologue et elle gynécologue et enfin Manuela (Blanca Li), le professeur de flamenco de ML invitée au dernier moment. Les angoisses et les secrets de chacun sont dissimulés par l’humour et les éclats de rires, par le rôle que chacun joue dans ce manège mondain. Le code c’est celui de l’hypocrisie, la bonne humeur, la cordialité… mais aussitôt le dîner terminé et le chemin du retour emprunté, les masques tombent…
Qui n’est jamais allé à un dîner auquel il avait autant envie d’assister que de se pendre ? Qui n’a jamais jouer la comédie, sociale, donner le change pour sauver les apparences ? Sur une situation convenue à laquelle chacun peut s’identifier, Danièle Thompson fait du spectateur le 12ème invité, celui qui, voyeur, sait ce qui se trame derrière les masques souriants et derrière les plaisanteries qui ne sont finalement là que pour détourner l’attention.
Danièle Thompson aime ses acteurs et le leur rend bien s’attachant à donner à chacun sa scène, son bon mot, sa réplique qui fait mouche au premier rang desquels Pierre Arditi (qui donne au film ses plus belles scènes dans son duo irrésistible avec Patrick Chesnais), Patrick Bruel, crédible et touchant en cancérologue jouant aux bons vivants en réalité dévoré par la souffrance à laquelle il fait face et face aux malheurs qu’il ne sait plus annoncer, Christopher Thompson et Emmanuelle Seigner en couple finalement plus mélancolique que réellement cynique et désabusé, chacun parvenant à sortir du stéréotype auquel le grand nombre de personnages et donc la nécessité de les rendre facilement identifiable aurait pu les réduire. Les personnages sont finalement tous plutôt attachants et leurs fêlures plutôt attendrissantes.
Le tout est particulièrement rythmé et nous fait passer un très agréable moment, seulement…seulement les masques glissent et vacillent plus qu’ils ne tombent réellement, alors qu’on aurait parfois aimé les voir exploser (on n’est certes pas dans « Festen » ou dans « Pardonnez-moi »), chacun restant finalement retranché derrière ses codes, et la morale étant toujours sauve, finalement un peu trop. Le drame affleure, l’émotion parfois aussi, mais on reste finalement toujours dans la comédie et le vaudeville. A vouloir aborder trop de thèmes ( la maladie, le deuil, le mensonge, la rancœur, la vie, la mort…) dans un temps trop court, les ellipses sont inéluctables et parfois frustrantes, faisant perdre de l’épaisseur à certains personnages et à certaines situations.
Pour ne pas donner un sentiment de théâtre filmé et pour renforcer cette impression de manège et de valse des apparences, la caméra de Danièle Thompson virevolte habilement entre les invités nous faisant passer d’une conversation à une autre, jonglant savoureusement entre les répliques, et entre les temporalités, ne laissant aucun temps mort, et mettant ainsi en exergue les contradictions de chacun, l’absurdité que le code social donne parfois aussi à la situation.
Dommage que la fin nous laisse un sentiment d’inachevé. Dommage aussi que la fête de la musique propice à apporter un élément poétique ne soit ici qu’un élément perturbateur. Voilà un film qui ferait une excellente pièce de théâtre dont on quitte finalement ses personnages à regret.