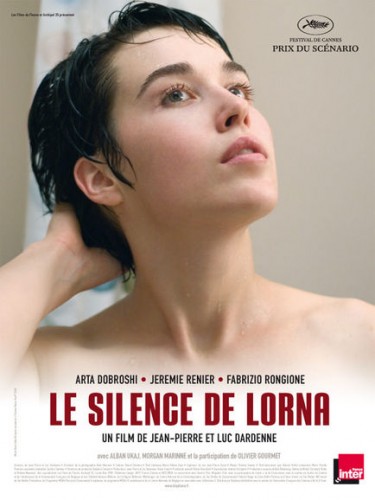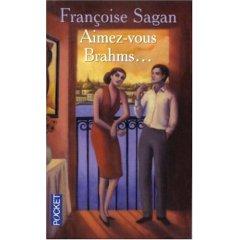« Faubourg 36 » de Christophe Barratier : un hommage au cinéma d’hier
Je l’avoue : je n’avais aucune envie de voir ce film, la bande annonce me laissait présager un film daté et artificiel mais ayant vu tous les autres films à l’affiche dans mes cinéma favoris, je me suis finalement laissée tenter. Il m’a fallu un petit bout de temps pour m’accoutumer à ce cinéma désuet, à sa succession frénétique de plans, de situations et de personnages stéréotypés et puis je me suis replongée sans déplaisir dans mes souvenirs de ce cinéma que j’aimais tant : celui de Carné, de Duvivier, de Becker (Jacques) , celui de l’avant-guerre , perdu quelque part entre les espoirs du Front populaire et la montée des extrêmes et de l’antisémitisme, avec des références aussi à celui que l’on appelait de qualité française (cinéma de studio et de scénaristes d’après-guerre. )
Evidemment ce film n’a rien à voir avec « Entre les murs » par exemple actuellement à l’affiche et il ne prétend d’ailleurs nullement au même cinéma (si vous ne devez voir qu’un film ce mois-ci c’est évidemment celui de Laurent Cantet) mais aussi diamétralement opposés que soient leurs styles et leurs écritures (d’ailleurs ne vous y trompez pas « Entre les murs » est un film très écrit, parfaitement écrit même au point de donner cette parfaite illusion du documentaire, de vérité prise sur le vif) je les crois portés par la même sincérité, la même envie de mener un genre à son paroxysme, le même perfectionnisme.
Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l'élection printanière du gouvernement de Front Populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est là que trois ouvriers du spectacle au chômage Pigoil, Milou et Jacky ( respectivement incarnés par Gérard Jugnot, Clovis Cornillac et Kad Merad) décident d'occuper de force le music-hall qui les employait il y a quelques mois encore, pour y monter un "spectacle à succès".
Clovis Cornillac ressemble à s’y méprendre à Jean Gabin dans les films d’avant-guerre, Nora Arnezeder (la découverte du film comme Jean-Baptiste Maunier dans « Les Choristes » avec lequel elle a un commun une fraîcheur et un talent éclatants) à Michèle Morgan : tous deux font inévitablement penser au couple mythique Nelly et Jean du « Quai des Brumes » de Marcel Carné auquel un plan d’ailleurs fait explicitement référence. Bernard-Pierre Donnadieu (Galapiat), quant à lui, fait penser à Pierre Brasseur (Frédérick Lemaître) dans « Les enfants du paradis » de Carné et à Jules Berry (Valentin) dans « Le jour se lève » du même Carné ou dont j’ai d’ailleurs cru reconnaître le célèbre immeuble dessiné par Alexandre Trauner dans le premier plan du film… Les décors du film entier font d’ailleurs penser à ceux de Trauner, avec cette photographie exagérément lumineuse entre projecteurs de théâtre et réverbères sous lesquels Paris et les regards scintillent de mille feux incandescents et mélancoliques. Et l'amitié qui unit les protagonistes de ce "Faubourg 36" fait évidemment penser à celle qui unissait ceux de "La belle équipe" de Duvivier. (Voir mes critiques des films précités dans ce paragraphe en cliquant ici).
Barratier assume donc ses références, celles d’un cinéma académique, classique et populaire, prévisible, empreint d’une douce nostalgie. Dommage qu’il n’ait pas trouvé un dialoguiste du talent de Prévert et qu’à la fin les personnages incarnés par Clovis Cornillac et Nora Arnezeder passent au second plan mais après tout le film s’intitule « Faubourg 36 » : c’est lui le vrai héros du film, lequel n’est pas vraiment une comédie musicale (même si la fin du film s’y apparente avec une belle énergie), plutôt un film sur un music hall, ceux qui le font vivre, pour qui il est une raison de vivre. Le destin, le conte de fée d’une « Môme » qui assume pleinement le genre du film sans les excès mélodramatiques et les maquillages outranciers du film éponyme...auquel quelques plans font d’ailleurs étrangement songer.
On en reste peut-être un peu trop à distance comme on regarderait un beau spectacle avec l’impression que ses artistes s’amusent beaucoup entre eux mais ne nous font pas totalement entrer dans la danse mais ce voyage dans le temps et dans le cinéma d’hier que Christophe Barratier fait revivre le temps d’un film vaut néanmoins le détour ne seraient-ce que pour la beauté des plans emportés par une caméra dynamique, et pour ses comédiens portés par une énergie admirable au premier rang desquels François Morel qui apporte ici sa fantaisie imparable, Pierre Richard et sa bonhomie clownesque, Gérard Jugnot sa touchante justesse, Kad Merad son goût du second degré et sa –belle- voix que l’on découvre, et les seconds rôles qui, à l’image de ceux du cinéma auquel Barratier rend hommage, existent réellement.
Quatre ans après « Les Choristes » (8 million de spectateurs) Christophe Barratier avec son second film a eu l’intelligence de ne pas forcer sa nature, d’être fidèle à ses convictions cinématographiques et impose ainsi son style joliment désuet, musical, mélancolique, sentimental, photogénique (Tom Stern, photographie de Clint Eastwood signe ici la photographie) et enthousiaste avec une résonance sociale finalement très actuelle. Le film d’un réalisateur qui aime indéniablement le cinéma, ses acteurs et ses artifices revendiqués, et rien que pour cela, pour cette sincérité ce « Faubourg 36 » vaut le détour.
 Et après l’hommage au cinéma des années 30, mercredi prochain sort en salles l’hommage au western classique, l’hymne à l’amitié signé Ed Harris, « Appaloosa » que je recommande à tous les amateurs du genre...dont je suis (présenté en avant-première au dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville) !
Et après l’hommage au cinéma des années 30, mercredi prochain sort en salles l’hommage au western classique, l’hymne à l’amitié signé Ed Harris, « Appaloosa » que je recommande à tous les amateurs du genre...dont je suis (présenté en avant-première au dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville) !
A suivre sur "In the mood for cinema": l'avant-première de la série "Flics" d'Olivier Marchal en présence de toute l'équipe du film.
Sandra.M