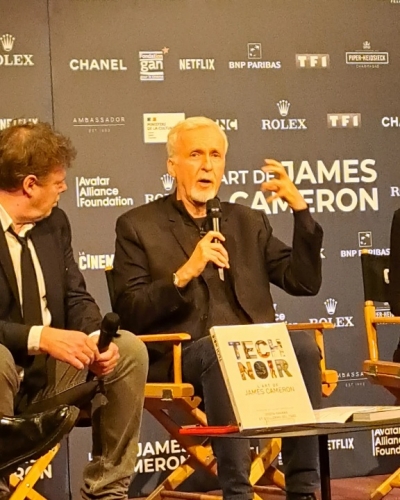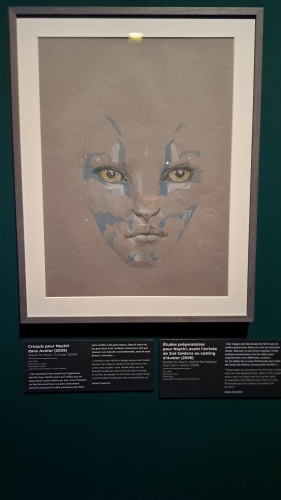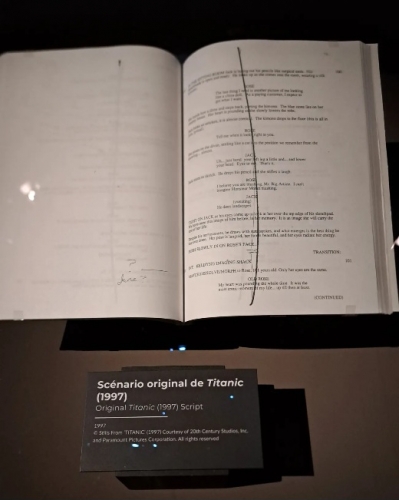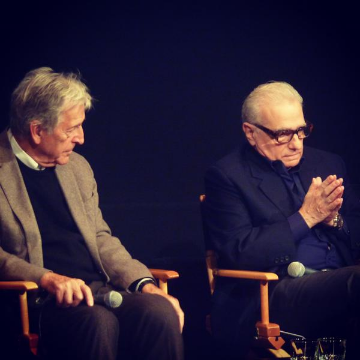Critique de LUMIÈRE, L’AVENTURE CONTINUE ! de Thierry Frémaux (au cinéma le 19 mars 2025)

« Le cinéma est un mélange parfait de vérité et de spectacle. » Cette citation de François Truffaut résume parfaitement ce qu’était déjà le cinéma à ses origines, lors de la première projection publique payante qui eut lieu dans le Salon Indien du Grand Café, à Paris, le 28 décembre 1895. Dès cette première projection, il était évident que Lumière n’était pas uniquement un inventeur mais aussi un cinéaste, et que le cinéma n'était pas simplement le reflet d’une réalité, mais aussi un spectacle, une vérité légèrement mensongère, une écriture singulière. Lumière ne filmait pas seulement le mouvement, il l’écrivait déjà. Telle est d’ailleurs la signification du substantif Cinématographe, « écrire le mouvement ».
Avant-hier, je vous parlais de la projection en copie restaurée de Quatre nuits d’un rêveur de Robert Bresson au cinéma Le Champo, une séance dont je suis ressortie émerveillée. Par le film. Sublime et douloureux, comme l’amour qu’il dépeint dans un Paris exhalant une séduisante nostalgie : le récit de quatre soirées aux accents d’éternité. Mais aussi par ce plaisir incommensurable et intact que me procure toujours la salle de cinéma. Lieu demeuré depuis l’enfance ainsi : rassurant et exaltant. Refuge les jours de tempête et complice les jours de soleil. Ces digressions pour vous dire que c’est cela que m’évoque d’abord cette projection de Lumière, l’aventure continue !. Un émerveillement permanent. Une joie enfantine et irrépressible : les puissantes réminiscences des premières émotions suscitées par la salle de cinéma.
Pourquoi allons-nous au cinéma ? Pour de multiples raisons dont celles précitées mais aussi pour celle-ci, évoquée dans le documentaire par Thierry Frémaux : « Lumière envoie ses opérateurs filmer ce qui ne leur ressemble pas. Le cinéma, au fond, n’aura jamais fait que ça. Il me dit qui je suis et il me dit qui sont les autres. » Se connaître soi-même et connaître les autres…
Alors que, entre les réseaux sociaux et les chaines d’information en continu, un flux permanent d’images et d’informations capture notre regard, ce formidable documentaire nous réapprend à le (re)poser.

Le 17 mai 2015, à Cannes, j’avais eu le plaisir de voir le précèdent documentaire de Thierry Frémaux (directeur de l’Institut Lumière de Lyon, délégué général du Festival de Cannes depuis 2007, fondateur du Festival Lumière de Lyon, auteur également, notamment récemment de Rue du Premier-Film), déjà consacré aux films des frères Lumières, intitulé Lumière ! L’aventure commence. Cette projection avait eu lieu dans le si bien nommé et plus que jamais à-propos Grand Théâtre Lumière. Quel bonheur cela avait été d’entendre une salle (Lumière) rire éperdument devant les images des frères Lumière…120 ans plus tard. C’était en effet à l’occasion des 120 ans du Cinématographe que leurs films restaurés avaient été projetés aux festivaliers, le tout avec les commentaires érudits, inénarrables et passionnés de Thierry Frémaux, avec la traduction (qui l’était tout autant) de Bertrand Tavernier. Un film de 93 minutes, en réalité un montage de 108 films restaurés réalisés par Louis Lumière et ses opérateurs entre 1895 et 1905 : des célébrissimes Sortie des usines, L’Arroseur arrosé (la première fiction de l’Histoire cinéma) à des films aussi méconnus qu’étonnants, cocasses, maîtrisés avec, déjà, les prémices du langage cinématographique, du gros plan au travelling, un véritable voyage qui nous avait emmenés dans les origines du cinéma mais aussi sur d’autres continents et qui avait suscité l’hilarité générale mais aussi l’admiration unanime devant des films d’une qualité exceptionnelle démontrant à tous à quel point déjà les Lumière pratiquaient et maîtrisaient l’art de la mise en scène et qu’il s’agissait bien là de fictions et non de simples documentaires. Le tout sublimé par la musique de Camille Saint-Saëns. Un moment de rare exultation cinéphilique, en présence de nombreux « frères du cinéma » comme l’avait ce jour-là souligné Thierry Frémaux : Taviani, Coen, Dardenne mais aussi Claude Lanzmann, Claude Lelouch…, parmi un prestigieux parterre d’invités. Lumière ! L’aventure commence sortit au cinéma le 25 janvier 2017 dans 45 salles en France, totalisant plus de 135 000 entrées et plus encore dans le monde entier (le film a été vendu dans plus de 33 pays),
Le souvenir de cette déclaration d’amour au cinéma, du moment qui en est indissociable (parce que c’est cela aussi le cinéma, des souvenirs de fiction qui s’entremêlent à ceux de notre réalité) est resté gravé. J’attendais donc avec impatience de retrouver cette « vérité » envoûtante et ce « spectacle » étourdissant.
Disons-le d’emblée : l’émotion fut de nouveau au rendez-vous. Cela commence par un bateau qui fend les flots. Attachez vos ceintures, c’est le début d’un voyage d’une vertigineuse beauté.
Comme le précise le synopsis, « grâce à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma qui ne connait pas de fin. » Sorties d’usine Productions et l’Institut Lumière proposent ce nouveau « film Lumière », réalisé par Thierry Frémaux et produit par Maelle Arnaud. À nouveau, ce sont les films Lumière qui composent entièrement ce long-métrage (à l’exception de la fin signée Coppola, surtout restez jusqu’au générique, que je vous laisse découvrir). Le film est découpé en onze chapitres, précédés d’un prologue et suivis d’un épilogue. Il nous rappelle d’abord les origines historiques du cinéma. Ainsi, tandis que « Thomas Edison et les autres inventeurs réfléchissent à un format, Lumière trouve une forme, et même davantage : un langage poétique, une pratique sociale. » Et il nous emporte ensuite dans un périple palpitant, une cavalcade d’émotions et de ravissements.

Le montage est constitué de 120 films inédits et nouvellement restaurés de 50 secondes. Les Lumière ont produit plus de 1400 films (et environ 1000 supplémentaires, dits « hors catalogue »), entre 1895 et 1905. Sur les 1428 référencés dans leurs différents catalogues, 1422 ont été retrouvés et conservés. Les négatifs de ces films sont principalement détenus par l’Institut Lumière, la Cinémathèque française et la Direction du patrimoine cinématographique du CNC, et sont conservés par cette dernière, après le recensement et le rassemblement de l’œuvre Lumière initiés à l’occasion du centenaire du cinéma en 1995. Actuellement, ce sont 300 nouvelles restaurations 4K qui sont en cours, supervisées par Maelle Arnaud et Thierry Frémaux, et effectuées au laboratoire l’Immagine Ritrovata (Bologne, Italie).
La restauration est absolument époustouflante ! Ces films sont d’une beauté sidérante. D’une inventivité éblouissante, aussi. Tout y est déjà. Des chevauchées fantastiques qui préfigurent celles, magistrales, des films de John Ford, sans rien avoir à leur envier. Des plans de repas d’une famille japonaise qui nous font songer à Ozu. Des scènes burlesques qui pourraient venir d’un film de Keaton ou de Chaplin. Des scènes néo-réalistes qui pourraient être empruntées à Visconti.
L’ingéniosité des Lumière, leur curiosité, leur imagination et leur audace sautent aux yeux, et prouvent à quel point Louis Lumière fut un cinéaste génial, inventif et précurseur (Auguste réalisa un seul film, présent dans la sélection, dont la magnificence picturale nous fait regretter qu’il n’en ait pas mis en scène davantage). C’est absolument fascinant.

Le texte ne se contente pas d’être didactique, il est mélancolique, facétieux, mélodieux, poétique même parfois, suscitant des questionnements philosophiques, interrogeant le rôle et la place du cinéma mais aussi ceux du spectateur. Plus qu’une déclaration, c’est aussi une réflexion sur le cinéma, son passé, et son avenir, 130 ans après son invention.
C’est aussi un voyage sensoriel, à travers les continents, par le truchement d’images d’une étonnante modernité. La puissance du cinéma est déjà là, exacerbée par la musique issue de l’œuvre de Gabriel Fauré, qui, comme Camille Saint-Saëns précédemment pour Lumière ! L’aventure commence est contemporain de Louis et Auguste Lumière. Ce film en lui-même n’est pas une simple compilation d’images. Il est aussi démonstration de ce qui contribue à la force évocatrice et émotionnelle du cinéma : les mots (dialogue ou voix off, ici), la musique, le point de vue du cinéaste, et le montage.
Le montage est en effet absolument admirable, signifiant, réalisé par Jonathan Cayssials, Simon Gemelli avec Thierry Frémaux. Tous ces films, ainsi agencés, nous montrent à quel point Lumière et ses opérateurs questionnaient déjà la mise en scène, réfléchissaient déjà à l’endroit où devait se placer la caméra (la force de la plongée est déjà là, flagrante), possédaient un univers et un regard. Ce sont déjà des tableaux en mouvements, des plans organisés, des acteurs qui (sur)jouent…
La date de sortie du film, le 19 mars 2025, n’est pas anodine puisque ce jour-là cela fera 130 ans que, rue Saint-Victor à Lyon, Louis Lumière a posé son Cinématographe pour la première fois pour réaliser le premier film de l'Histoire du cinéma, Sortie d’Usine. 2000 « vues » suivront.
Ce film aurait pu aussi s’intituler « Éloge de la beauté et de la force du cinéma » tant il nous rappelle à quel point aller au cinéma signifie aller à la rencontre d’un univers, d’une émotion, des autres, de soi-même, à quel point cet art si jeune recèle et suscite d’émotions et de réflexions, à quel point il est aussi personnel que collectif, physique qu’émotionnel. Essentiel. Et à quel point il fut tout cela dès ses origines.
« Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d’autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout » disait Godard. Ce film est la parfaite démonstration de cela, celle d’une « fenêtre ouverte sur le monde ».
Ces restaurations extraordinaires et inédites forment un patrimoine universel unique, un trésor incomparable.

Après cette projection, tout comme en 2017 j’étais ressortie du Grand Théâtre Lumière, titubant presque, j’ai quitté le cinéma Le Balzac, ivre : ivre d’une joie de cinéma. Avec en tête, des centaines d’images qui ne se dissiperont pas dans un flux continuel d’images vaines et hypnotiques mais qui imprègneront et imprimeront ma mémoire. Des images qui ne m'ont pas capturée mais qui m'ont captivée. Comme ces plans dont la richesse et la beauté de la composition sont stupéfiantes. Comme le flux et le reflux de la mer, ce « présent éternel ». Ces bébés qui se chamaillent. Ce cheval d’une majesté à couper le souffle. Ces soldats poursuivis par la poussière. Ces enfants acrobates. Ces comédies et ces drames, reflets de nos propres joies et de nos propres peines. Et cette sortie d’usine décryptée, que nous connaissons tous mais qui recèle encore ses secrets et, plus que jamais, son pouvoir de fascination (là aussi réminiscences, souvenirs d’un festival Lumière de Lyon : chaque année un cinéaste tourne à nouveau cette scène, cette année-là ce furent Almodovar, Dolan et Sorrentino, image personnelle ci-dessous).
Le 19 mars 2025, amoureux du cinéma, partez pour la plus enthousiasmante des aventures qui dure depuis 130 ans ! Enivrez-vous d’images, de mots et de musique. Une valse émotionnelle qui vous fera chavirer de bonheur, d’émotion et d’émerveillement vous attend. En résumé : la magie du cinéma. Celle qui repousse « l’absolu de la mort ». Celle qui nous laisse les yeux écarquillés comme des enfants qui découvrent le monde, un monde (et qui, à la fin, taperaient des pieds pour en réclamer "encore, encore !"). Comme les premiers spectateurs du 28 décembre 1895. Si vous aimez le cinéma, vous ne pourrez qu’être éblouis par ce film qui montre que, dès ses origines, il était un jeu avec la vérité, une écriture en mouvement et un art à part entière. Du grand art, comme ce film passionnant qui lui rend le plus vibrant et émouvant des hommages.
À noter : 1. En 2025, le cinéma aura 130 ans. 2025 sera l’année de célébration des 130 ans du Cinématographe Lumière. Portée par l’Institut Lumière (Lyon), légataire de l’héritage d’Auguste et Louis Lumière, cette célébration sera composée de nombreux temps forts, et se déclinera dans plusieurs domaines, avec comme point d’orgue la sortie en salles du film événement Lumière, l’aventure continue. Réalisé par Thierry Frémaux, le film sortira le 19 mars, jour de tournage du premier film par Louis et Auguste Lumière, Sortie d’usine. Au printemps, un site sera lancé pour donner à voir au monde l’œuvre unique des Lumière. À l’automne, la réédition du travail de Bernard Chardère sur la famille Lumière, ainsi que l’édition d’un catalogue complet des films de la société A. Lumière et fils, compléteront cet anniversaire.
2. Pour poursuivre ma digression, Quatre nuits d'un rêveur a totalisé plus de 7000 entrées en une semaine. Il sera à l'affiche de nouveaux cinémas cette semaine. Ne le manquez pas.