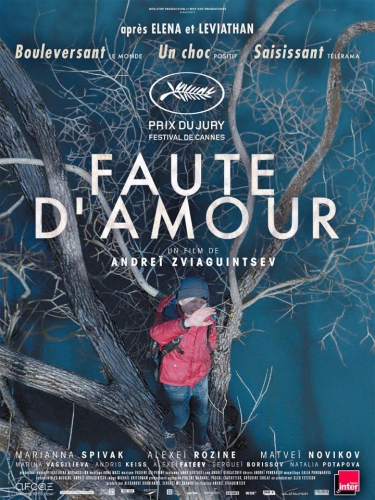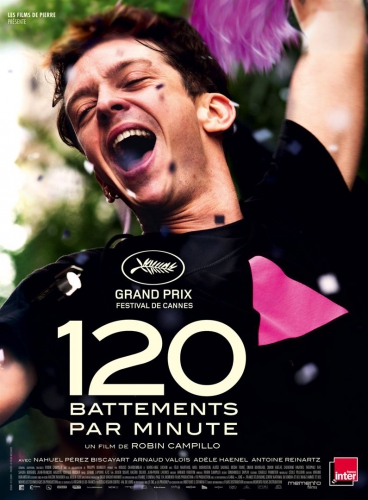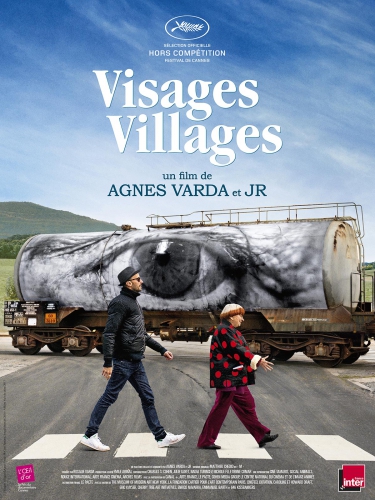Critique de AVIGNON de Johann Dionnet - Séance au Cinéma Pathé BNP Paribas à Paris

Il y a quelques semaines, ainsi vous présentais-je le dernier film de Thierry Frémaux, Lumière, l’aventure continue ! :
« Le cinéma est un mélange parfait de vérité et de spectacle. » Cette citation de François Truffaut résume parfaitement ce qu’était déjà le cinéma à ses origines, lors de la première projection publique payante qui eut lieu dans le Salon Indien du Grand Café, à Paris, le 28 décembre 1895. Dès cette première projection, il était évident que le cinéma n'était pas simplement le reflet d’une réalité, mais aussi un spectacle, une vérité légèrement mensongère, une écriture singulière. Les frères Lumière ne filmaient pas seulement le mouvement, ils l’écrivaient déjà. Ils n’étaient pas seulement des inventeurs mais aussi des cinéastes. Telle est d’ailleurs la signification du substantif Cinématographe, « écrire le mouvement ».
Sans doute est-ce pour cela que j’aime si peu regarder les films ailleurs que dans un cinéma, parce que pour moi pour que cet art se déploie pleinement, il doit être vu, dégusté même, dans une salle, sans quoi il ne serait pas totalement ce « mélange parfait de vérité et de spectacle. »

J’étais ainsi invitée à découvrir le Cinéma Pathé BNP Paribas à Paris, cinéma fraîchement rénové dans le deuxième arrondissement de Paris, qui a ouvert le 30 avril 2025, destiné à accueillir de nombreux évènements cinéma exclusifs organisés par BNP Paribas. Entièrement modernisé, le cinéma Pathé BNP Paribas, ancien Pathé Opéra Premier situé au 32 rue Louis Le Grand, accueille les spectateurs dans les meilleures conditions. Les 5 salles de 42 à 192 fauteuils pour un total de 440 places sont équipées de larges fauteuils en velours de laine rouge inclinables, de projecteurs Laser de dernière génération pour une qualité d’image exceptionnelle. Alors que certains cinémas parisiens sont vétustes et infestés d’insectes parasites, une offre d’un cinéma moderne et accueillant comme celle-ci est plus que jamais appréciable, nous rappelant aussi qu’aller au cinéma n’est jamais anodin : c’est aller au spectacle, par définition collectif, c’est lever les yeux vers l’écran, c’est profiter d’un moment unique, en l’occurrence dans des conditions idéales.

Sans avoir réellement lu le synopsis, je décidai d’aller voir la comédie qui avait remporté le Grand Prix au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2025, Avignon. En ce jour de canicule, le flambant neuf Cinéma Pathé BNP Paribas était vraiment le havre de paix, de fraîcheur et de rêves idéal pour le découvrir.

En 2022, Johann Dionnet réalisa le court-métrage Je joue Rodrigue. Trois ans plus tard, à quelques jours du début du 79ème Festival d’Avignon ( qui aura lieu du 5 au 26 juillet 2025) sort donc sur les écrans sa version longue, son premier long métrage : Avignon (coécrite par ce dernier, Benoît Graffin, et Francis Magnin).
Cela commence comme cela se termine : sur une scène de théâtre auquel le film rend un magnifique hommage. Mais aussi à ces comédiens pour qui jouer est une passion viscérale. Parmi eux, Stéphane (Baptiste Lecaplain), qui débarque avec sa troupe à Avignon pour jouer une pièce de boulevard intitulée Ma sœur s’incruste. Là, il recroise Fanny (Elisa Erka), une comédienne qui, des années auparavant, avait suivi le même stage de théâtre que lui. Seulement, alors que sa carrière à lui piétine, Fanny a récemment reçu un Molière. Stéphane est sous le charme et profite d’un quiproquo pour lui faire croire qu’il est à Avignon pour interpréter Rodrigue dans Le Cid, une pièce qu’il n’a pourtant même jamais lue, et dont il ignorait tout jusqu’alors. Il va s’enfoncer de plus en plus dans un mensonge dont il sera d’autant plus compliqué de se défaire que Fanny va commencer elle aussi à tomber sous le charme...
Avignon est d’abord un film de troupe. Celle de la pièce Ma sœur s’incruste est menée par Serge (Lyes Salem) confronté à des soucis pécuniaires qui le rendent souvent irascible. Elle comprend aussi notamment sa compagne Coralie (Alison Wheeler), actrice principale de la pièce dans laquelle joue également Patrick (Johann Dionnet). Il y a aussi Marc (Rudy Milstein), l’apprenti régisseur, aussi maladroit que surprenant.
Ce film est une douceur estivale, savoureuse, entre la comédie romantique à la Richard Curtis, la comédie à la Toledano Nakache, et la critique sociale, égratignant le mépris d’un certain théâtre, à la Jaoui/Bacri (Le Goût des autres...).
Avignon s’inspire de l’expérience de Johann Dionnet, scénariste, réalisateur mais aussi acteur (il joue d’ailleurs dans le film, un acteur de la troupe en quête d’amour, attachant). Le scénario réussit le parfait équilibre entre rire et romantisme. Contrairement à de nombreuses comédies qui oublient souvent la forme pour se concentrer sur les dialogues (le plus souvent filmés en champ /contre-champ), elle est ici particulièrement soignée, grâce au travail du chef-opérateur Thomas Rames, avec notamment un magnifique plan-séquence devant le Palais des Papes ou encore une scène de hamac lors de laquelle la caméra tourne autour des personnages dans un jeu d’ombres éclairées par la lune.
Le film se déroule au rythme qui est celui du festival, joyeux, effréné, intense, dans une atmosphère estivale suffocante, palpable, dont la chaleur semble traverser l’écran. Stéphane promène sa tendresse mélancolique dans les rues d’Avignon, ville qui est un personnage à part entière de cette comédie. Baptiste Lecaplain, avec son air un peu lunaire, de doux rêveur aux cheveux ébouriffés, un peu égaré dans ses rêves et la réalité, est l'acteur idéal pour incarner Stéphane. Face à lui Fanny évolue avec des comédiens qui pratiquent ce qu’ils considèrent comme le seul théâtre qui vaille : la tragédie classique. Ils assènent leurs avis péremptoires sur les goûts des autres (pour eux, la comédie populaire n’est qu’un sujet de moquerie et non du théâtre). À ce petit jeu cruel, l’horripilant David (Amaury de Crayencour) est absolument et odieusement irrésistible. Les personnages et intrigues secondaires sont impeccablement dessinés. Alison Wheeler est ainsi d’un naturel saisissant.
Si le film égratigne un certain snobisme, il n’en est pas moins une ode au théâtre (à toutes les formes de théâtre), à la puissance des mots et au jeu en général (illusion théâtrale, illusion amoureuse) et à la ville qui est le décor fascinant de cette échappée ludique. Les mots enchanteurs de Corneille se faufilent entre ses rues jusqu’aux cœurs : l’illusion théâtrale crée l’illusion amoureuse.
Les dialogues sont soignés. La musique originale l'est aussi, elle a été confiée à Sébastien Torregrossa qui a privilégié la guitare pour teinter le film de couleurs chaudes (comme la photographie, très solaire), comme la voix de Elisa Erka qui interprète une chanson qui envoûte Stéphane.
Le film nous fait aussi découvrir les coulisses du festival : les locations de salles à des prix exorbitants, les pantomimes diverses auxquelles doivent se plier les acteurs en arpentant la ville pour vendre leurs places, les terrasses bondées sous un soleil écrasant, le rythme trépidant, la concurrence, la joie contagieuse « d'en être », …
« L'amour est un tyran qui n'épargne personne. » , « Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse : Nos plus heureux succès sont mêlés de tristesse. » Le film illustre parfaitement ces citations du Cid dont il met en lumière la beauté et la poésie enchanteresses.
La fête du cinéma, c’est l’essence même du cinéma tel qu’inventé par les frères Lumière. Il vous reste encore deux jours pour en profiter et pour découvrir Avignon. Vous l’aurez compris, je vous recommande cette pépite tendre, émouvante, délicate, ensoleillée, qui réconcilie le théâtre populaire et le théâtre classique, qui sublime les mots, le jeu, les illusions théâtrale et amoureuse, et qui donne envie de prendre immédiatement un billet direction Avignon, pour se fondre dans ce spectacle permanent à la gaieté communicative dont on ressort les yeux brillants comme ceux d'enfants émerveillés, découvrant pour la première fois le théâtre de Boulevard...ou une tragédie classique. Je vous le promets : vous ne regretterez pas le voyage !

La fête du cinéma 2025 est ainsi un véritable succès avec 920000 spectateurs le premier jour, prouvant ainsi l’attachement du public pour ce mélange de « vérité et de spectacle » : le cinéma en salle. Vous pouvez encore en profiter jusqu’au 2 juillet au tarif de 5 euros la séance. Comme le Printemps du Cinéma, la Fête du Cinéma est organisée par le FNCF. BNP Paribas est partenaire pour la 21ème année consécutive de ce bel évènement qui célèbre cette année ses 40 ans. Et si vous en profitiez pour découvrir Avignon et le magnifique cinéma Pathé BNP Paribas ?
Cliquez ici pour réserver votre séance au Pathé BNP Paribas
A propos du Cinéma Pathé BNP Paribas : complément d’information
L’ouverture du Pathé BNP Paribas vient enrichir l’offre cinématographique du quartier de l’Opéra et de la rive droite, les spectateurs parisiens bénéficieront d’un choix plus large tant en termes de programmation de films, de confort que d’équipements innovants. En s’associant à Pathé pour la réouverture de ce cinéma emblématique, pour la première fois en France, BNP Paribas appose son nom sur ce cinéma, renforçant ainsi son engagement pour soutenir le 7ème art et permettre au public d’y avoir accès dans les meilleures conditions.
BNP Paribas fera de ce cinéma un lieu privilégié pour accueillir ses avant-premières et ses événements exclusifs autour du cinéma à Paris, notamment des événements dédiés à la communauté de fans de cinéma welovecinema.
En complément, les clients de BNP Paribas bénéficieront de tarifs préférentiels. BNP Paribas finance un film sur deux produits en France, soit plus de 150 films chaque année.
Pathé est leader de l’exploitation cinématographique en France, aux Pays-Bas et en Suisse, et est également présent en Belgique et en Afrique. Pathé exploite 128 cinémas pour un total de 1 282 écrans (76 cinémas et851 écrans en France). La stratégie de montée en gamme et de modernisation des cinémas Pathé repose sur une politique active de création, de reconstruction et de rénovation ainsi qu’une innovation permanente avec les meilleures technologies, des services inédits et adaptés pour un parcours spectateur optimisé, en salles et sur le digital. Pathé est l’un des principaux producteurs et distributeurs européens de films de cinéma.