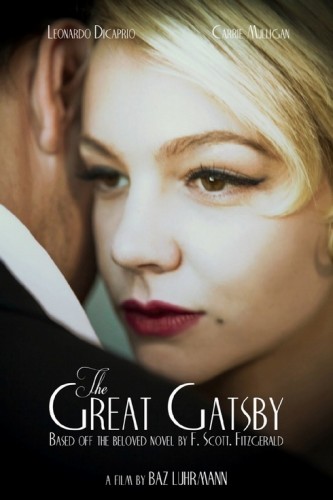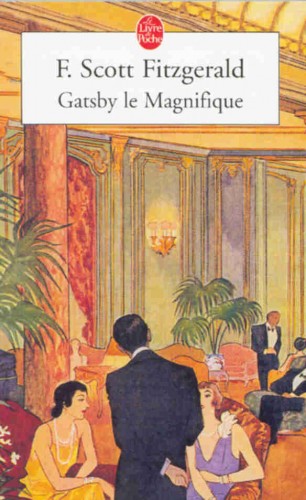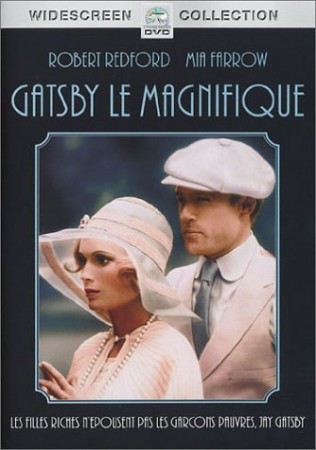ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD de Quentin Tarantino au Festival de Cannes 2019 : critique de INGLOURIOUS BASTERDS

Voilà une annonce qui complète en beauté un programme de sélection officielle déjà exceptionnel. Le très attendu Once upon a time in… Hollywood de Quentin Tarantino sera bien en compétition du 72ème Festival de Cannes, 10 ans après Inglourious Basterds (dont vous pouvez retrouver ma critique ci-dessous).
Voici la déclaration de Thierry Frémaux au sujet de cette sélection (communiqué de presse officiel du Festival de Cannes) :
« On a craint que le film, ne sortant que fin juillet, ne soit pas prêt mais Quentin Tarantino, qui n’a pas quitté sa salle de montage depuis quatre mois, est un vrai enfant de Cannes, fidèle et ponctuel ! Comme pour Inglourious Basterds, il sera bien là, vingt-cinq ans après la Palme d’or de Pulp Fiction, avec un film terminé, projeté en 35mm et en présence de sa troupe d’acteurs : Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt. Son film est une déclaration d’amour au Hollywood de son enfance, une visite rock à l’année 1969 et une ode au cinéma tout entier.C’est aussi un travail qui dépasse nos attentes et prouve la maturité de l’artiste. C’est pourquoi, en plus de Quentin et sa team pour les jours et les nuits passés au montage, le Festival remercie spécialement les équipes de Sony Pictures, qui ont rendu tout cela possible. »
Critique de INGLOURIOUS BASTERDS de Quentin Tarantino

Photos ci-dessus prises à l'occasion de la présentation en compétition du Festival de Cannes 2009.
Pitch : Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l’exécution de sa famille tombée entre les mains du colonel nazi Hans Landa ( Christoph Waltz). Shosanna (Mélanie Laurent) s’échappe de justesse et s’enfuit à Paris où elle se construit une nouvelle identité en devenant exploitante d’une salle de cinéma. Quelque part, ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine (Brad Pitt) forme un groupe de soldats juifs américains pour mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis. « Les bâtards », nom sous lequel leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à l’actrice allemande et agent secret Bridget von Hammersmark (Diane Krüger) pour tenter d’éliminer les dignitaires du troisième Reich. Leurs destins vont se jouer à l’entrer du cinéma où Shosanna est décidée à mettre à exécution une vengeance très personnelle.
De ce film, seul film américain de cette compétition officielle 2009, je n’avais pas lu le pitch, tout juste vu la bande-annonce qui me faisait craindre une grandiloquence maladroite, un humour douteux, voire indécent sur un sujet délicat. Je redoutais, je pensais même détester ce film et ne m’attendais donc pas à ce que la première séquence (le film est divisé en 5 chapitres qui correspondent aux parcours de 5 personnages) me scotche littéralement à l’écran dès la première seconde, à ne plus pouvoir m’en détacher jusqu’à la dernière ligne du générique.
L’un des premiers plans nous montre une hache dans un univers bucolique que la caméra de Tarantino caresse, effleure, esquisse et esquive : finalement ce simple plan pourrait résumer le ton de ce film, où la menace plane constamment, où le décalage est permanent, où toujours le spectateur est sur le qui-vive, la hache pouvant à chaque instant venir briser la sérénité. Cette première séquence dont nous ne savons jamais si nous devons en rire, ou en frissonner de plaisir (parce qu’elle est jubilatoire à l’image de tout ce film, une première séquence au sujet de laquelle je ne vous en dirai pas plus pour maintenir le suspense et la tension incroyables qui y règnent) ou de peur, est sans nul doute une des plus réussies qu’il m’ait été donné de voir au cinéma.
Chaque séquence au premier rang desquelles la première donc recèle d’ailleurs cette même ironie tragique et ce suspense hitchcockien, le tout avec des plans d’une beauté, d’une inventivité sidérantes, des plans qui sont ceux d’un grand cinéaste mais aussi d’un vrai cinéphile (je vous laisse notamment découvrir ce plan magnifique qui est un hommage à La Prisonnière du désert de John Ford ) et d’un amoureux transi du cinéma. Rien que la multitude de références cinématographiques mériterait une deuxième vision tant l’admiration et la surprise lors de la première empêchent de toutes les distinguer.
Oui, parce que Inglourious Basterds est aussi un western. Inglourious Basterds appartient en réalité à plusieurs genres… et à aucun : western, film de guerre, tragédie antique, fable, farce, comédie, film spaghetti aussi. (Inglourious Basterds est inspiré d’un film italien réalisé par Enzo G.Castellari). Un genre et un univers qui, en réalité, n’appartiennent qu’à Tarantino et auxquels il parvient à nous faire adhérer, quels qu’en soient les excès, même celui de réécrire l’Histoire, même celui de se proclamer chef-d’œuvre avec une audace et une effronterie incroyables. Cela commence ainsi comme un conte (« il était une fois »), se termine comme une farce.
Avec quelle facilité il semble passer d’un ton à l’autre, nous faire passer d’une émotion à une autre, comme dans cette scène entre Mélanie Laurent et Daniel Brühl, dans la cabine de projection, une scène qui, en quelques secondes, impose un souffle tragique poignant, époustouflant, d’un rouge éblouissant. Une scène digne d’une tragédie antique.
Il y a du Hitchcock dans ce film mais aussi du Chaplin pour le côté burlesque et poétique et du Sergio Leone pour la magnificence des plans, et pour cet humour ravageur, voire du Melville aussi pour la réalisation, Melville à qui un autre cinéaste (Johnnie To) de cette compétition 2009 se référait d’ailleurs. Voilà, en un endroit tenu secret, Tarantino, après les avoir fait kidnapper et fait croire à leurs disparitions au monde entier, a réuni Chaplin, Leone, et Hitchcock et même Melville et Ford et leur a fait réaliser ce film qui mêle avec brio poésie et sauvagerie, humour et tragédie.
Et puis, il y a en effet le cinéma. Le cinéma auquel ce film est un hommage permanent, une déclaration d’amour passionnée, un hymne vibrant à tel point que c’est le cinéma qui, ici, va sauver le monde, réécrire la page la plus tragique de l’Histoire, mais Tarantino peut bien se le permettre : on pardonne tout au talent lorsqu’il est aussi flagrant. Plus qu’un hommage au cinéma c’est même une leçon de cinéma, même dans les dialogues : « J’ai toujours préféré Linder à Chaplin. Si ce n’est que Linder n’a jamais fait un film aussi bon que « Le Kid ». Le grand moment de la poursuite du « Kid ». Superbe . » Le cinéma qui ravage, qui submerge, qui éblouit, qui enflamme (au propre comme au figuré, ici). Comment ne pas aimer un film dont l’art sort vainqueur, dans lequel l’art vainc la guerre, dans lequel le cinéma sauve le monde ?
Comment ne pas non plus évoquer les acteurs : Mélanie Laurent, Brad Pitt, Diane Krüger, Christoph Waltz, Daniel Brühl y sont magistraux, leur jeu trouble et troublant procure à toutes les scènes et à tous les dialogues (particulièrement réussis) un double sens, jouant en permanence avec le spectateur et son attente. Mélanie Laurent qui a ici le rôle principal excelle dans ce genre, de même que Daniel Brühl et Brad Pitt.
Que dire de la BO (signée Ennio Morricone) incroyable qui, comme toujours chez Tarantino, apporte un supplément de folie, d’âme, de poésie, de lyrisme et nous achève…
Quentin Tarantino avec ce septième long-métrage a signé un film audacieux, brillant, insolent, tragique, comique, lyrique, exaltant, décalé, fascinant, irrésistible, cynique, ludique, jubilatoire, dantesque, magistral. Une leçon et une déclaration d’amour fou et d’un fou magnifique, au cinéma. Ce n’est pas que du cinéma d’ailleurs : c’est un opéra baroque et rock. C’est une chevauchée fantastique. C’est un ouragan d’émotions. C’est une explosion visuelle et un ravissement permanent et qui font passer ces 2H40 pour une seconde !
A contrario de ses « bâtards sans gloire », Tarantino mérite indéniablement d’en être auréolé ! « Inglourious Basters » était le film le plus attendu de ce festival 2009. A juste titre.
Qu’a pensé Pedro Almodovar, également présent à la séance à laquelle j’ai vu ce film ? Sans doute que tous deux aiment passionnément le cinéma, et lui rendent un vibrant hommage (la dernière réplique du film de Tarantino fait ainsi écho à celle d’Almodovar Etreintes brisées, en compétition à Cannes la même année).