"Le Guépard", la fresque somptueuse de Luchino Visconti (1963)
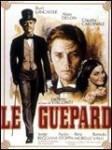
En 1860, en Sicile, tandis que Garibaldi et ses chemises rouges débarquent pour renverser la monarchie des Bourbons de Naples et l’ancien régime, le prince Don Fabrizio Salina (Burt Lancaster) ainsi que sa famille et son confesseur le Père Pirrone (Romolo Valli), quitte ses domaines pour son palais urbain de Donnafigata, tandis que son neveu Tancrède rejoint les troupes de Garibaldi. Tancrède s’éprend d’Angelica, (Claudia Cardinale), la fille du riche maire libéral de Donnafugata : Don Calogero. Le Prince Salina s’arrange pour qu’ils puissent se marier. Après l’annexion de la Sicile au royaume d’Italie, Tancrède qui s’était engagé aux côtés des Garibaldiens les abandonne pour rejoindre l’armée régulière…
Les premiers plans nous montrent une allée qui mène à une demeure, belle et triste à la fois. Les allées du pouvoir. Un pouvoir beau et triste, lui aussi. Triste car sur le déclin, celui de l’aristocratie que symbolise le Prince Salina. Beau car fascinant comme l’est le prince Salina et l’aristocratie digne qu’il représente. Ce plan fait écho à celui de la fin : le prince Salina avance seul, de dos, dans des ruelles sombres et menaçantes puis il s’y engouffre comme s’il entrait dans son propre tombeau. Ces deux plans pourraient résumer l’histoire, l’Histoire, celles d’un monde qui se meurt. Les plans suivants nous emmènent à l’intérieur du domaine, nous offrant une vision spectrale et non moins sublime de cette famille. Seuls des rideaux blancs dans lesquels le vent s’engouffre apportent une respiration, une clarté dans cet univers somptueusement sombre. Ce vent de nouveauté annonce l’arrivée de Tancrède, Tancrède qui apparaît dans le miroir dans lequel Salina se mire. Son nouveau visage. Le nouveau visage du pouvoir. Le film est à peine commencé et déjà son image est vouée à disparaître. Déjà la fin est annoncée. Le renouveau aussi.
Fidèle adaptation d’un roman écrit en 1957 par Tomasi di Lampedusa, Le Guépard témoigne d’une époque représentée par cette famille aristocrate pendant le Risorgimento, « Résurrection » qui désigne le mouvement nationaliste idéologique et politique qui aboutit à la formation de l’unité nationale entre 1859 et 1870. Le Guépard est avant tout l’histoire du déclin de l’aristocratie et de l’avènement de la bourgeoisie, sous le regard et la présence félins, impétueux, dominateurs du Guépard, le prince Salina. Face à lui, Tancrède est un être audacieux, vorace, cynique, l’image de cette nouvelle ère qui s’annonce.
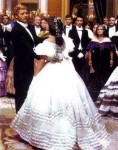
Angelica, Tancrède et Salina se retrouvent ensuite dans cette même pièce face à ce tableau morbide alors qu’à côté se fait entendre la musique joyeuse et presque insultante du bal. L’aristocratie vit ses derniers feux mais déjà la fête bat son plein. Devant les regards attristés et admiratifs de Tancrède et Angelica, Salina s’interroge sur sa propre mort. Cette scène est pour moi une des plus intenses de ce film qui en comptent pourtant tant qui pourraient rivaliser avec elle. Les regards lourds de signification qui s’échangent entre eux trois, la sueur qui perle sur les trois visages, ce mouchoir qu’ils s’échangent pour s’éponger en font une scène d’une profonde cruauté et sensualité où entre deux regards et deux silences, devant ce tableau terriblement prémonitoire de la mort d’un monde et d’un homme, illuminé par deux bougies que Salina a lui-même allumées comme s’il admirait, appelait, attendait sa propre mort, devant ces deux êtres resplendissants de jeunesse, de gaieté, de vigueur, devant Salina las mais toujours aussi majestueux, plus que jamais peut-être, rien n’est dit et tout est compris.
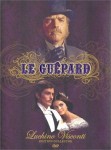
La lenteur envoûtante dont est empreinte le film métaphorise la déliquescence du monde qu’il dépeint. Certains assimileront à de l’ennui ce qui est au contraire une magistrale immersion dont on peinera ensuite à émerger hypnotisés par l’âpreté lumineuse de la campagne sicilienne, par l’écho du pesant silence, par la beauté et la splendeur stupéfiantes de chaque plan. Par cette symphonie visuelle cruelle, nostalgique et sensuelle l’admirateur de Proust qu’était Visconti nous invite à l’introspection et à la recherche du temps perdu.
La personnalité du Prince Salina devait beaucoup à celle de Visconti, lui aussi aristocrate, qui songea même à l’interpréter lui-même, lui que cette aristocratie révulsait et fascinait à la fois et qui, comme Salina, aurait pu dire : « Nous étions les Guépards, les lions, ceux qui les remplaceront seront les chacals, les hyènes, et tous, tant que nous sommes, guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre ».
Que vous fassiez partie des guépards, lion, chacals ou brebis, ce film est un éblouissement inégalé par lequel je vous engage vivement à vous laisser hypnotiser...
Je vous rappelle que "In the mood for cinema" participe au concours du Festival de la création sur internet. Si vous aimez ce blog, si vous souhaitez qu'il soit ensuite soumis au vote des professionnels, il vous suffit pour cela de vous rendre sur la page suivante http://www.festivalderomans.com/detail.php?id_part=142&cat_part=7 et de voter en deux secondes et en un clic. Pour l'instant je ne pense pas avoir le nombre suffisant de voix, la vôtre fera peut-être la différence... alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, il ne reste plus que 5 jours pour voter!
Sandra.M



 Nous venons de l'apprendre: Stephen Frears sera le président de la 60ème édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 16 au 27 Mai 2007. Il succédera ainsi à Wong Kar-Wai . "In the mood for cinema" devrait y être de nouveau pour vous en faire un compte rendu exclusif. En attendant, retrouvez mes comptes rendus sur
Nous venons de l'apprendre: Stephen Frears sera le président de la 60ème édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 16 au 27 Mai 2007. Il succédera ainsi à Wong Kar-Wai . "In the mood for cinema" devrait y être de nouveau pour vous en faire un compte rendu exclusif. En attendant, retrouvez mes comptes rendus sur 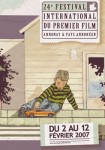 Après Deauville, Dinard, Cannes, Cognac, Cabourg, Paris, Saint-Malo, je viens d'apprendre que je serai jurée à Annonay, au Festival International du Premier Film, du 9 au 12 février 2007. Je vous imagine déjà railler ce festival en comparaison de ceux précités. Détrompez-vous ! J’en ai eu d’élogieux échos (notamment par
Après Deauville, Dinard, Cannes, Cognac, Cabourg, Paris, Saint-Malo, je viens d'apprendre que je serai jurée à Annonay, au Festival International du Premier Film, du 9 au 12 février 2007. Je vous imagine déjà railler ce festival en comparaison de ceux précités. Détrompez-vous ! J’en ai eu d’élogieux échos (notamment par  Vendredi prochain, le 1er Salon du Cinéma ouvrira ses portes à Paris. Ce rendez-vous dont on se demande d’ailleurs pourquoi il n’a pas été initié plus tôt dans la ville du septième art, ce rendez-vous donc s’adresse autant aux professionnels, aux cinéphiles qu’aux néophytes et « In the mood for cinema » ne pouvait bien entendu pas manquer d'y être.
Vendredi prochain, le 1er Salon du Cinéma ouvrira ses portes à Paris. Ce rendez-vous dont on se demande d’ailleurs pourquoi il n’a pas été initié plus tôt dans la ville du septième art, ce rendez-vous donc s’adresse autant aux professionnels, aux cinéphiles qu’aux néophytes et « In the mood for cinema » ne pouvait bien entendu pas manquer d'y être.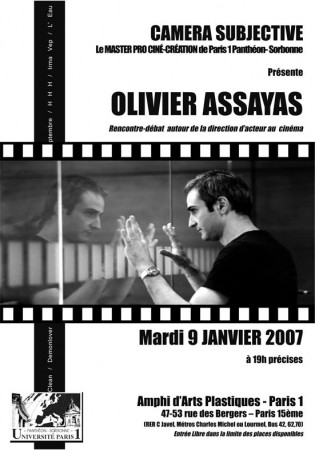
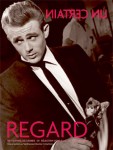 Avec 4 millions de blogs en France (plus de 50 millions dans le monde), 7 millions d’internautes
Avec 4 millions de blogs en France (plus de 50 millions dans le monde), 7 millions d’internautes qui consultent des blogs régulièrement, Internet devient un outil de communication de plus en plus incontournable (il suffit de voir, pour s’en convaincre, la place qu’il occupe déjà dans la campagne présidentielle). Il était donc logique qu’un festival le mette enfin à l’honneur. La première édition du Festival International de la Création sur Internet (
qui consultent des blogs régulièrement, Internet devient un outil de communication de plus en plus incontournable (il suffit de voir, pour s’en convaincre, la place qu’il occupe déjà dans la campagne présidentielle). Il était donc logique qu’un festival le mette enfin à l’honneur. La première édition du Festival International de la Création sur Internet ( Ce blog est né en novembre 2004 pour remplacer mes sites internet artisanaux dont l’objectif
Ce blog est né en novembre 2004 pour remplacer mes sites internet artisanaux dont l’objectif était d’abord de partager mes expériences de jurée dans des festivals de cinéma, mon regard sur leur ambiance et surtout pour partager mon enthousiasme pour des films découverts dans ces festivals. Avec la naissance des blogs, ce fut une véritable jubilation pour moi de pouvoir laisser libre cours à cet enthousiasme, et à mes deux passions : pour l’écriture et pour le cinéma.
était d’abord de partager mes expériences de jurée dans des festivals de cinéma, mon regard sur leur ambiance et surtout pour partager mon enthousiasme pour des films découverts dans ces festivals. Avec la naissance des blogs, ce fut une véritable jubilation pour moi de pouvoir laisser libre cours à cet enthousiasme, et à mes deux passions : pour l’écriture et pour le cinéma.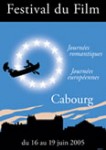 Américain de
Américain de  Deauville (ce blog est ainsi le seul figurant dans les
Deauville (ce blog est ainsi le seul figurant dans les  renseignements pratiques inédits sur les festivals, aussi. Vous donner envie de les découvrir, de partir à votre tour « In the mood for cinema ».
renseignements pratiques inédits sur les festivals, aussi. Vous donner envie de les découvrir, de partir à votre tour « In the mood for cinema ».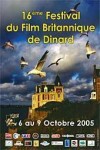 Si vous souhaitez en savoir plus sur ce blog, son nom, mes motivations, et sur le parcours de sa créatrice, vous pouvez lire les rubriques «
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce blog, son nom, mes motivations, et sur le parcours de sa créatrice, vous pouvez lire les rubriques «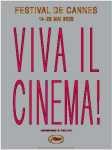 soutien de Reporters sans frontières qui animeront une table ronde sur la liberté d’expression) donc si vous souhaitez donner un plus large et nouvel écho à ce blog, n’hésitez pas à voter et à en parler autour de vous… Vous pouvez voter à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 Janvier 2007 à minuit.
soutien de Reporters sans frontières qui animeront une table ronde sur la liberté d’expression) donc si vous souhaitez donner un plus large et nouvel écho à ce blog, n’hésitez pas à voter et à en parler autour de vous… Vous pouvez voter à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 Janvier 2007 à minuit.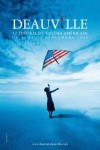 N’hésitez pas non plus à laisser vos commentaires au sujet de ce blog (Défauts, qualités, conseils…) à la suite de cet article.
N’hésitez pas non plus à laisser vos commentaires au sujet de ce blog (Défauts, qualités, conseils…) à la suite de cet article. curiosité... Et de fascination, de surprise...pour ce qui se déroule sur les grands écrans devant lesquels, encore plus en 2007, j'espère vous convaincre de vous précipiter rêver, réflèchir, oublier, frissonner, savourer la magie du septième art, "in the mood for cinema", forcément!
curiosité... Et de fascination, de surprise...pour ce qui se déroule sur les grands écrans devant lesquels, encore plus en 2007, j'espère vous convaincre de vous précipiter rêver, réflèchir, oublier, frissonner, savourer la magie du septième art, "in the mood for cinema", forcément! Sandra.M
Sandra.M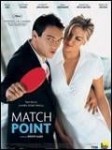 Comme l'an passé, (vous aviez alors voté pour Match point, Entre ses mains et Je ne suis pas là pour être aimé), je vous propose de voter pour un film, ce qui permettra d'établir le classement des 3 meilleurs films de l'année selon les lecteurs d'In the mood for cinema.
Comme l'an passé, (vous aviez alors voté pour Match point, Entre ses mains et Je ne suis pas là pour être aimé), je vous propose de voter pour un film, ce qui permettra d'établir le classement des 3 meilleurs films de l'année selon les lecteurs d'In the mood for cinema.