Le "vrai" cinéma est "ailleurs" au 24ème Festival International du Premier Film d’Annonay:compte-rendu
-
 Alors qu’un film monopolise la sphère médiatique, la Môme d’Olivier Dahan (mais est-ce nécessaire de le citer ?), à Annonay vient de s’achever la 24ème édition du Festival International du 1er Film où j’étais membre du jury. Probablement n’avez-vous pas entendu parler de ce festival…et c’est bien dommage. C’est bien dommage parce que sous nos yeux de cinéphiles à la curiosité et l’enthousiasme insatiables ont émergé des cinéastes, des vrais qui, contre vents et marées, se battent pour faire entendre leur voix, évidemment moins résonante, mais non moins percutante, que celle d’Edith Piaf. Là-bas, dans le silence. Loin du vacarme médiatique.
Alors qu’un film monopolise la sphère médiatique, la Môme d’Olivier Dahan (mais est-ce nécessaire de le citer ?), à Annonay vient de s’achever la 24ème édition du Festival International du 1er Film où j’étais membre du jury. Probablement n’avez-vous pas entendu parler de ce festival…et c’est bien dommage. C’est bien dommage parce que sous nos yeux de cinéphiles à la curiosité et l’enthousiasme insatiables ont émergé des cinéastes, des vrais qui, contre vents et marées, se battent pour faire entendre leur voix, évidemment moins résonante, mais non moins percutante, que celle d’Edith Piaf. Là-bas, dans le silence. Loin du vacarme médiatique. - Avant de vous conter ces 4 magnifiques journées, revenons donc en quelques mots, quelques mots seulement (tant, trop d’encre ayant déjà coulé sur ce sujet) sur ce film (presque ?) unanimement annoncé comme un chef d’œuvre. Mardi soir avait lieu la dernière avant-première de La Môme à l’UGC Ciné Cité les Halles présentée par l’équipe du film, visiblement harassée à tel point qu’Olivier Dahan n’a pas daigné adresser un seul mot au public si ce n’est pour préciser qu’il était trop fatigué pour le faire. Puis 2H20 de cris, de
larmes, de colère, d’un visage ravagé. 2H20 harassantes. Le spectateur est pris en otage : il faut qu’il pleure, qu’il compatisse. Les affres de la création et de la drogue et de l’alcool et de la maladie et de la mort de sa grande passion et de son visage attendrissant d’enfant mal aimée et un coucher de soleil mais que vient-il donc faire là celui-là ? Ah oui: cristalliser l’émotion à tout prix. Et la musique évidemment. Alors, certes, la musique d’Edith Piaf, sublime complainte mélancolique apporte force, intensité, lyrisme, flamboyance à ce biopic. Forcément. Alors, certes, les construction, déconstruction, reconstruction, traduisent les souvenirs forcément parcellaires de Piaf à la fin de sa vie. Le montage, donc très habile, vous emporte dans son tourbillon vertigineux sans vous laisser le temps de respirer et surtout de penser. Alors, certes, il y a ce sublime et déchirant plan séquence de six minutes lorsque Edith apprend la mort de Marcel. Certes Marion Cotillard imite les gestes, fait du play back à la perfection, se donne sans compter (quoique je me suis demandée si Edith Piaf avait vraiment la voix d’ET quand elle parlait?), de même que Clotilde Courau (dommage qu’elle ne tourne pas davantage). Certes, enfin, c’est une
magnifique bande annonce pour tous les produits dérivés estampillés Piaf déjà dans les rayons avant la sortie du film. Mais est-ce cela vraiment le cinéma ? Qu’on nous dicte nos choix, qu’on nous prenne par la main, qu’on nous assiste ? J’aime la liberté. D’aimer ou de ne pas aimer. De laisser mon imagination vagabonder. Là, nous n’en avons ni le temps ni l’opportunité. Aller à l’essentiel (mais ne peut-il être aussi dans le superflu ?). Pas de place pour le silence. La musique est omniprésente. Les images sont hypnotiques. La caméra nous emprisonne. Trop de larmes et d’émotions tuent l’émotion, la mienne en tout cas, pourtant toujours si prompte à se manifester. Il est rare que sur ce blog je fasse part de mon mécontentement, préférant laisser cela à d’autres et partager mon enthousiasme, mais je reste perplexe devant l’unanimisme suscité par ce film et j’aimerais comprendre... alors que tant d’autres films, eux magnifiques (La vie des autres par exemple, premier film extrêmement maîtrisé dont je vous reparle bientôt) sortent dans une quasi indifférence, je me demande si’ l’esprit critique, vraiment libre, existe encore ! Alors quoi ? La crainte de critiquer un monument comme Edith Piaf ? Mais ne pas aimer son biopic n’empêche pas de savourer sa musique et de reconnaître son incontestable talent (ce qui est mon cas) ? L’impact des chaînes de télévision ? Le consensualisme ? Une société impatiente, consumériste qui ne prend plus le temps. D’analyser. De la distance. De se laisser prendre par une émotion subreptice et non tapageuse.

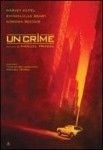
Si Annonay a chaque année un thème pour leitmotiv, cette année le road movie, le véritable temps fort de ce festival est la compétition de premiers films n’ayant pas encore de distributeur, la raison de notre présence, nous l’aurions presque oublié. Je précise que cet avis n’engage que moi et pas les autres membres du jury et ne remet aucunement en cause le palmarès et nos longues et palpitantes heures de délibération.

Gare de Genève. Une femme va à Marseille donner une conférence. Un homme court à Berlin découvrir son enfant. Une jeune femme part vivre à Naples. Et quand l’autre s’invite sur le siège d’en face, une réalité nouvelle peut surgir. Trois rencontres, trois histoires de vie qui basculent sur un quai de gare.
Qui n’a pas une anecdote dans un train ou une gare ? Quel lieu plus propice au surgissement de l’imprévu, de l’inconnu, du singulier dans une existence que celui de tous ces destins qui se frôlent, de toutes ces vies entre parenthèses, de tous ces regards qui se croisent, s’esquissent ou s’esquivent furtivement? Peu importe le lieu. Seul ce qui s’y déroule compte. Cela peut se dérouler à Annonay où neuf routes se rejoignent le temps d’un festival. Cela peut avoir lieu dans un train ou une gare. Dans tous les cas, les préjugés et les catégorisations volent en éclats. L’anecdotique aussi. L’instant est à la fois banal et crucial et la poésie parce que inattendue est sublimée par cette quotidienneté. Ces personnages sont tous entre deux moments, entre deux pays, en route vers un ailleurs redouté ou idéalisé. Ils n’ont pas de nom, pas de prénom. Leur histoire est singulière et universelle. Leurs solitudes se rencontrent et la même altérité débarque dans leurs habitudes. La vraie vie n’est pas ailleurs, même s’ils le croient, (ne le croit, craint-on pas toujours ?) mais bel et bien là sous nos yeux. Capturer ce reflet-là relève d’un talent incontestable. Grâce au regard d’une acuité sidérante du réalisateur. Grâce au jeu impeccable, aux accents de vérité époustouflants et à l’improvisation des acteurs, à l’image de ce long plan où, sur une musique italienne, la jeune femme passe de la tristesse, à la joie du retour, à la nostalgie, au regrets, à la réalité étouffante. Grâce au montage qui permet que chaque histoire se fasse subtilement écho. Grâce à l’attention portée aux gestes et aux regards qui semblent vibrer, exister, surgir sous nos yeux. Grâce à cette tension contenue où s’entrelacent rage et désir. De et contre l’autre. D’exister et contre l’existence. Grâce à cette maladresse d’inconnus si proches et si lointains, qui paraît si réelle. La brièveté renforce l’intensité de leurs relations. Ils ne maquillent plus leurs émotions. C’est la vie sans fards. Parfois quelques heures, une seconde suffisent pour faire basculer une existence, ici une nuit blanche peut permettre de l’appréhender différemment. C’est une formidable bouffée d’oxygène, un huis clos haletant, bouleversant, dont on ressort, comme après ce festival, avec l’envie de saisir chaque seconde, de ne jamais oublier que comme le dit Molière (Romain Duris) dans le film éponyme de Laurent Tirard « rien n’est impossible ». Si Laurent Tirard le fait dire, Frédéric Joffat le montre dans chaque seconde du film. Cette fiction a la force incomparable d’un documentaire sur la vraie vie et l’intensité poétique de la beauté éphémère qui surgit de l’inattendu et de l’inconnu. A l’image de ces 4 jours. C’est dans La vraie vie est ailleurs que vous trouverez les résonances de l’existence, plus présente et prégnante que jamais.
Deux autres films radicalement différents mais non moins intéressants ont émergé de cette compétition dont le niveau était d’ailleurs étonnamment élevé pour des premiers films n’ayant pas de distributeurs. C’est tout d’abord La part animale, le film français de Sébastien Jaudeau qui a obtenu le Prix spécial du jury, une adaptation du roman d’Yves Bichet. Etienne vient d’être embauché comme ouvrier dans une exploitation avicole moderne. Il est en charge de la reproduction des dindons. Peu à peu, au contact des bêtes, le regard qu’il porte sur l’humanité évolue.La part animale est une œuvre. Avec tout ce que cela peut impliquer. De radicalité. De point de vue. D’étrangeté. D’audace. Elle décontenance et malgré et à cause de cela force notre admiration. Le thème de l’animalité s’insinue dans le moindre fragment du film (jusqu’à l’excès : plans de sangliers, excès de références, notamment picturales, comme L’origine du monde de Courbet qui lui font frôler le didactisme et toujours en éviter l’écueil), se reflète dans le jeu des comédiens, dans leurs excès et leurs dérives. Tel le Rhinocéros de Ionesco, le dindon s’immisce partout. L’animalité s’empare des comportements et les travestit, déteint sur l’existence et en fait ressortir la noirceur inavouable. En filigrane, un discours intéressant sur l’aliénation du travail, sur les effets pervers de la technique qui, si on n’y adhère pas forcément, n’en demeure pas moins intelligemment mise en scène malgré sa démonstration ostentatoire et revendicatrice. Une réalisation et un montage très maîtrisés, la photographie de Pierre Cottereau, des images qui vous hantent longtemps après la dernière minute du film contribuent à faire de cette part animale un film salutairement dérangeant. Pour ceux qui ne craignent pas de ne plus jamais voir les dindons et les petits pains de la même manière et de faire surgir la part animale qui est en eux. A noter : Niels Arestrup, parfait en patron bourru et inquiétant, de même que Sava Lolov en employé effacé qui se laisse peu à peu envahir et submerger par sa part animale.

Les 5 autres films en compétition nous ont emmené aux 4 coins du monde, avec des thèmes (la paternité, la maternité, le deuil) et musiques (Alléluia) et victimes (nos « amis » les bêtes) récurrents malgré une compétition dont l’éclectisme est à souligner.
Elle nous a donc conduits au Québec avec Luc Picard, le réalisateur et acteur de L’audition. Agent de recouvrement aux méthodes musclées Louis rêve, depuis sa tendre enfance, d’être acteur. Grâce à une cousine, il est invité à passer une audition dans laquelle il jouera un père léguant un dernier message à son fils. Luc Picard est un comédien renommé au Canada qui passe ici à la réalisation. Malgré un pré générique poétique, onirique et prometteur, malgré une réflexion intéressante sur le métier de comédien et la paternité le film s’enfonce malheureusement dans des clichés qui atteignent leur paroxysme au dénouement d’une prévisibilité déconcertante, abusant des ralentis, d’Alléluia et de l’hémoglobine. Dommage, cette audition n’était pas dénuée de (trop) bonnes intentions.
Avec Look both ways de Sarah Watt, nous prenons la route de l’Australie. C’est le week-end le plus chaud de l’été et un récent tragique accident de train est dans les esprits de tous. Avec cette nouvelle en trame de fond, sept personnes tentent de gérer des évènements inattendus. Ce film choral fait s’entrecroiser les routes de personnages tous confrontés à la mort d’une manière ou d’une autre. Malgré des dialogues parfois percutants, le brassage d’un trop grand nombre de hasards et coïncidences et de thèmes (la vie, la mort, l’amour) finit par nuire à l’ensemble et le happy end sirupeux décrédibilise le propos qui n’était pourtant pas inintéressant, d’autant plus que les images d’animation permettaient d’instiller une distance avec leur sujet, et de leur donner d’autant plus de force. Dommage que l’idée n’ait finalement été qu’esquissée.
Après la chaleur de l’Australie, c’est le vent glacial de la Norvège qui nous conduit à l’étape suivante, celle de Kissed by winter, le polar intimiste de Sara Johnsen. Victoria entame une nouvelle vie comme médecin dans un village de Norvège. Elle se plonge dans son travail pour éviter que ses souvenirs viennent la hanter. Un matin d’hiver, le corps d’un jeune homme est retrouvé dans la neige. La question est presque insoluble : comment se remettre de la mort d’un enfant ? Comment, si c’est possible, résoudre son sentiment de culpabilité ? Résolu par un pardon simpliste et soudain (le syndrome Red road et Little children ?) ce thriller psychologique dans une atmosphère glaciale aurait pu être une réflexion intéressante sur la culpabilité et le deuil. Sa construction à rebours, certes sans grande originalité qui s’achève par un plan paroxystique longuement annoncé, sur la musique de Jeff Buckley (Alleluia bis), et le jeu convaincant et convaincu de Annika Hallin valent néanmoins la peine de faire le détour pour arpenter les paysages enneigées de cet hiver paralysant.
Pour se remettre de cette glaciale étape, rien de mieux que le chemin de l’Argentine avec le film de Gabriel Lichtmann, Judios en el espacio. Le jour de la fête de la Pâque Juive, Santiago retrouve Luciana sa cousine et amour d’enfance qu’il n’a pas revu depuis 15 ans. En effet, toute la famille est de nouveau réunie au chevet du grand-père qui vient de rater sa tentative du suicide. Judios en el espacio est une chronique familiale qui alterne, sans jamais vraiment savoir choisir ou l’atteindre, entre nostalgie et causticité. Si ce film attendrissant nous arrache quelques sourires, son charme ne suffit pas à nous faire passer tout ennui.
Enfin, c’est en Italie que s’est achevé le périple de la compétition, avec Il vento fa il suo giro de Giorgio Diritti. Suite à la construction d’une centrale nucléaire à côté de chez lui, Philippe, un berger français, décide de partir vivre avec sa famille dans un petit village des Alpes italiennes. Malgré un discours et des intentions louables : la dénonciation de l’esprit de communautarisme déchaîné par un nouvel arrivant, différent et donc perçu comme menaçant, et un discours sur la liberté de choix non dénué d’intérêt, le mélange de fiction et de documentaire entre lesquels le réalisateur ne se décide pas à choisir nuit finalement à ses intentions, de même qu’un excès de ralenti et le jeu approximatif de certains acteurs.

Trois jours après, que reste-t-il de ce film, le mien de 4 jours ? Comment était-il ? Enrichissant comme un film historique. Inattendu comme un thriller (ou un dindon). Virevoltant comme une comédie musicale. Fellinien comme un certain soir de clôture. Désopilant et attendrissant comme un Woody Allen. Inoubliable, intense et rare comme un chef d’œuvre. De ces films après lesquels rien n’a changé, et après lesquels, aussi, vous avez la sensation de n’être plus tout à fait pareil, de croire à tout, surtout aux rencontres magiquement improbables et à l’impossible, même aux réponses aux bouteilles à la mer ( private message ). Tout cela, grâce à eux, ci-dessous, éminente photographe y compris :
Palmarès
Grand Prix du Jury, Prix de la Ville d'Annonay
Mouth to Mouth d’Alison Murray (Royaume-Uni)
Prix Spécial du Jury
La Part Animale de Sébastien Jaudeau (France)
Prix du Public
L’Audition de Luc Picard (Québec)
Prix des Lycéens
Mouth to Mouth d’Alison Murray (Royaume-Uni)
Prix de la Meilleure Musique de film
Mouth to Mouth d’Alison Murray (Royaume-Uni)
LIENS
Le site officiel du 24ème Festival International du Premier Film d’Annonay
Pour tout savoir sur le jury de cette 24ème édition : http://www.annonaypremierfilm.org/festival/images_docs/doc_141.pdf
Le blog de la supernounou de notre jury (et auteur de toutes les photos de cet article prises lors du festival) sur lequel vous trouverez un compte-rendu vibrant et très complet du festival : Sur la route du cinéma
Le poétique blog d'une autre jurée: Carnets de nuages
Sandra.M




 J’ai toujours aimé me laisser bercer par ce murmure ensorcelant qui précède les trois coups fatidiques, ce bruissement palpitant avant le lever du rideau, mais hier soir, plus que jamais, cette émotion était au rendez-vous : parce que c’était Sur la route de Madison, dont l’adaptation cinématographique de Clint Eastwood est un indéniable chef d’œuvre et accessoirement un de mes films préférés (
J’ai toujours aimé me laisser bercer par ce murmure ensorcelant qui précède les trois coups fatidiques, ce bruissement palpitant avant le lever du rideau, mais hier soir, plus que jamais, cette émotion était au rendez-vous : parce que c’était Sur la route de Madison, dont l’adaptation cinématographique de Clint Eastwood est un indéniable chef d’œuvre et accessoirement un de mes films préférés ( Avec Robert Kincaid, c’est l’ailleurs qui fait immersion dans la vie endormie de Francesca. Il a passé sa vie à voyager au gré de ses désirs. Pour une fois, elle va laisser libre cours aux siens, enfouis, si vivaces pourtant aussi. Il faut être dans les premiers rangs pour déceler les regards esquissés et esquivés puis consumés lorsque Francesca accepte la cigarette que Robert lui offre sans oser la regarder, pour déceler le trouble irrépressible qui s’empare de Francesca. Pour effectuer nous-mêmes ce gros plan que le théâtre ne permet pas. Si les adaptateurs Didier Caron et Dominique Deschamps, et le metteur en scène, Anne Bourgeois, se sont davantage inspirés du best seller de Robert James Waller (tiré à douze millions d’exemplaires !) que du film de Clint Eastwood la mise en scène n’en demeure pas moins très cinématographique : voix off, transitions, musique… trop cinématographique peut-être. Parfois, on aurait presque aimé, une table et deux chaises, et ne pas être coupés de l’émotion finalement jamais aussi présente que lorsque la lumière est tamisée, le décor presque invisible et ces deux âmes vibrantes en tête à tête.
Avec Robert Kincaid, c’est l’ailleurs qui fait immersion dans la vie endormie de Francesca. Il a passé sa vie à voyager au gré de ses désirs. Pour une fois, elle va laisser libre cours aux siens, enfouis, si vivaces pourtant aussi. Il faut être dans les premiers rangs pour déceler les regards esquissés et esquivés puis consumés lorsque Francesca accepte la cigarette que Robert lui offre sans oser la regarder, pour déceler le trouble irrépressible qui s’empare de Francesca. Pour effectuer nous-mêmes ce gros plan que le théâtre ne permet pas. Si les adaptateurs Didier Caron et Dominique Deschamps, et le metteur en scène, Anne Bourgeois, se sont davantage inspirés du best seller de Robert James Waller (tiré à douze millions d’exemplaires !) que du film de Clint Eastwood la mise en scène n’en demeure pas moins très cinématographique : voix off, transitions, musique… trop cinématographique peut-être. Parfois, on aurait presque aimé, une table et deux chaises, et ne pas être coupés de l’émotion finalement jamais aussi présente que lorsque la lumière est tamisée, le décor presque invisible et ces deux âmes vibrantes en tête à tête. Même si je n’ai pu m’empêcher de regretter l’absence de certaines scènes du film, il est vrai difficilement traduisibles au théâtre, si je n’ai pus m’empêcher de regretter que la Francesca de Mireille Darc ait peut-être moins de fêlures apparentes, d’imperfections, d’amertume que celle de Meryl Streep, j’ai en revanche retrouvé la même poésie, la même langueur mélancolique, la même sensualité notamment lorsque la main de Francesca caresse, d'un geste faussement machinal, le col de la chemise de Robert assis, de dos, tandis qu’elle répond au téléphone; et lorsque la main de Robert, sans qu’il se retourne, se pose sur la sienne. On retrouve ce même dénouement sacrificiel d’une beauté déchirante avec la pluie maussade et inlassable, le blues évocateur, la voix tonitruante de ce mari si « correct » qui ignore que devant lui, pour sa femme, un monde s’écroule et la vie, fugace et éternelle, s’envole avec la dernière image de Robert Kincaid, dans ce lieu d’une implacable banalité (un supermarché) soudainement illuminé puis éteint. A jamais. On retrouve aussi les mêmes questionnements que dans le film et le livre : un tel amour aurait-il survécu aux remords et aux temps ? Son sacrifice en valait-il la peine ? Quatre jours peuvent-ils sublimer une vie ? On retrouve aussi cette même fulgurante évidence qui s’impose à Francesca et Robert. D’emblée. Presque trop vite. Peut-être encore la confusion entre le théâtre et la réalité. Comment imaginer que Kincaid-Delon Francesca-Darc ne tombent pas amoureux l’un de l’autre ? L’affiche même de la pièce mettant en exergue leurs deux visages ne crée-t-elle pas volontairement la confusion ? L’impression qu’ils se connaissent depuis toujours : après tout, peut-être est-ce aussi celle de Francesca et Robert.
Même si je n’ai pu m’empêcher de regretter l’absence de certaines scènes du film, il est vrai difficilement traduisibles au théâtre, si je n’ai pus m’empêcher de regretter que la Francesca de Mireille Darc ait peut-être moins de fêlures apparentes, d’imperfections, d’amertume que celle de Meryl Streep, j’ai en revanche retrouvé la même poésie, la même langueur mélancolique, la même sensualité notamment lorsque la main de Francesca caresse, d'un geste faussement machinal, le col de la chemise de Robert assis, de dos, tandis qu’elle répond au téléphone; et lorsque la main de Robert, sans qu’il se retourne, se pose sur la sienne. On retrouve ce même dénouement sacrificiel d’une beauté déchirante avec la pluie maussade et inlassable, le blues évocateur, la voix tonitruante de ce mari si « correct » qui ignore que devant lui, pour sa femme, un monde s’écroule et la vie, fugace et éternelle, s’envole avec la dernière image de Robert Kincaid, dans ce lieu d’une implacable banalité (un supermarché) soudainement illuminé puis éteint. A jamais. On retrouve aussi les mêmes questionnements que dans le film et le livre : un tel amour aurait-il survécu aux remords et aux temps ? Son sacrifice en valait-il la peine ? Quatre jours peuvent-ils sublimer une vie ? On retrouve aussi cette même fulgurante évidence qui s’impose à Francesca et Robert. D’emblée. Presque trop vite. Peut-être encore la confusion entre le théâtre et la réalité. Comment imaginer que Kincaid-Delon Francesca-Darc ne tombent pas amoureux l’un de l’autre ? L’affiche même de la pièce mettant en exergue leurs deux visages ne crée-t-elle pas volontairement la confusion ? L’impression qu’ils se connaissent depuis toujours : après tout, peut-être est-ce aussi celle de Francesca et Robert. Voici la liste complète des nommés pour les César et pour les Oscars 2007. La cérémonie des César aura lieu le 24 février 2007, et sera de nouveau présentée par Valérie Lemercier et cette fois diffusée en clair, sur Canal plus. La cérémonie des Oscars aura lieu le 25 février 2007.
Voici la liste complète des nommés pour les César et pour les Oscars 2007. La cérémonie des César aura lieu le 24 février 2007, et sera de nouveau présentée par Valérie Lemercier et cette fois diffusée en clair, sur Canal plus. La cérémonie des Oscars aura lieu le 25 février 2007. Quant aux Oscars, Dreamgirls avec 8 nominations, Babel (meilleur film de l’année selon les lecteurs de ce blog… et moi-même et également nommé comme meilleur film étranger aux César) avec 7 nominations, Les infiltrés avec 5 nominations font d’ores et déjà figure de favoris.
Quant aux Oscars, Dreamgirls avec 8 nominations, Babel (meilleur film de l’année selon les lecteurs de ce blog… et moi-même et également nommé comme meilleur film étranger aux César) avec 7 nominations, Les infiltrés avec 5 nominations font d’ores et déjà figure de favoris. JE VAIS BIEN, NE T'EN FAIS PAS de Philippe Lioret
JE VAIS BIEN, NE T'EN FAIS PAS de Philippe Lioret Meilleure actrice dans un second rôle :
Meilleure actrice dans un second rôle : Meilleur espoir féminin :
Meilleur espoir féminin :  Meilleur réalisateur :
Meilleur réalisateur : Xavier Giannoli
Xavier Giannoli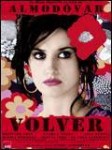 Meilleur film étranger
Meilleur film étranger Avant-première à L’UGC Odéon
Avant-première à L’UGC Odéon Un film qui nous emmène sur trois continents sans jamais que notre attention ne soit relâchée, qui nous confronte à l’égoïsme, à notre égoïsme, qui nous jette notre aveuglement et notre surdité en pleine figure, ces figures et ces visages qu’il scrute et sublime d’ailleurs, qui nous jette notre indolence en pleine figure, aussi. Un instantané troublant et désorientant de notre époque troublée et désorientée. La scène de la discothèque est ainsi une des plus significatives, qui participe de cette expérience. La jeuneJaponaise sourde et muette est aveuglée. Elle noie son désarroi dans ces lumières scintillantes, fascinantes et angoissantes. Des lumières aveuglantes: le paradoxe du monde, encore. Lumières qui nous englobent. Soudain aveuglés et sourds au monde qui nous entoure nous aussi.
Un film qui nous emmène sur trois continents sans jamais que notre attention ne soit relâchée, qui nous confronte à l’égoïsme, à notre égoïsme, qui nous jette notre aveuglement et notre surdité en pleine figure, ces figures et ces visages qu’il scrute et sublime d’ailleurs, qui nous jette notre indolence en pleine figure, aussi. Un instantané troublant et désorientant de notre époque troublée et désorientée. La scène de la discothèque est ainsi une des plus significatives, qui participe de cette expérience. La jeuneJaponaise sourde et muette est aveuglée. Elle noie son désarroi dans ces lumières scintillantes, fascinantes et angoissantes. Des lumières aveuglantes: le paradoxe du monde, encore. Lumières qui nous englobent. Soudain aveuglés et sourds au monde qui nous entoure nous aussi. C’est aussi un film de contrastes. Contrastes entre douleur et grâce, ou plutôt la grâce puis si subitement la douleur, puis la grâce à nouveau, parfois. Un coup de feu retentit et tout bascule. Le coup de feu du début ou celui en pleine liesse du mariage. Grâce si éphémère, si fragile, comme celle de l’innocence de ces enfants qu’ils soient japonais, américains, marocains, ou mexicains. Contrastes entre le rouge des vêtements de la femme mexicaine et les couleurs ocres du désert. Contrastes entres les lignes verticales de Tokyo et l’horizontalité du désert. Contrastes entre un jeu d’enfants et ses conséquences dramatiques. Contraste entre le corps dénudé et la ville habillée de lumière. Contraste entre le désert et la ville. Contrastes de la solitude dans le désert et de la foule de Tokyo. Contrastes de la foule et de la solitude dans la foule. Contrastes entre « toutes les télévisions [qui] en parlent » et ces cris qui s’évanouissent dans le désert. Contrastes d’un côté et de l’autre de la frontière. Contrastes d’un monde qui s’ouvre à la communication et se ferme à l’autre. Contrastes d’un monde surinformé mais incompréhensible, contrastes d’un monde qui voit sans regarder, qui interprète sans savoir ou comment, par le prisme du regard d’un monde apeuré, un jeu d’enfants devient l’acte terroriste de fondamentalistes ou comment ils estiment savoir de là-bas ce qu’ils ne comprennent pas ici.
C’est aussi un film de contrastes. Contrastes entre douleur et grâce, ou plutôt la grâce puis si subitement la douleur, puis la grâce à nouveau, parfois. Un coup de feu retentit et tout bascule. Le coup de feu du début ou celui en pleine liesse du mariage. Grâce si éphémère, si fragile, comme celle de l’innocence de ces enfants qu’ils soient japonais, américains, marocains, ou mexicains. Contrastes entre le rouge des vêtements de la femme mexicaine et les couleurs ocres du désert. Contrastes entres les lignes verticales de Tokyo et l’horizontalité du désert. Contrastes entre un jeu d’enfants et ses conséquences dramatiques. Contraste entre le corps dénudé et la ville habillée de lumière. Contraste entre le désert et la ville. Contrastes de la solitude dans le désert et de la foule de Tokyo. Contrastes de la foule et de la solitude dans la foule. Contrastes entre « toutes les télévisions [qui] en parlent » et ces cris qui s’évanouissent dans le désert. Contrastes d’un côté et de l’autre de la frontière. Contrastes d’un monde qui s’ouvre à la communication et se ferme à l’autre. Contrastes d’un monde surinformé mais incompréhensible, contrastes d’un monde qui voit sans regarder, qui interprète sans savoir ou comment, par le prisme du regard d’un monde apeuré, un jeu d’enfants devient l’acte terroriste de fondamentalistes ou comment ils estiment savoir de là-bas ce qu’ils ne comprennent pas ici. Mais toutes ces dissociations et ces contrastes ne sont finalement là que pour mieux rapprocher. Contrastes de ces hommes qui parlent des langues différentes mais se comprennent d’un geste, d’une photo échangée (même si un billet méprisant, méprisable les séparera, à nouveau). Contrastes de ces êtres soudainement plongés dans la solitude qui leur permet finalement de se retrouver. Mais surtout, surtout, malgré les langues : la même violence, la même solitude, la même incommunicabilité, la même fébrilité, le même rouge et la même blancheur, la même magnificence et menace de la nuit au-dessus des villes, la même innocence meurtrie, le même sentiment d’oppression dans la foule et dans le désert.
Mais toutes ces dissociations et ces contrastes ne sont finalement là que pour mieux rapprocher. Contrastes de ces hommes qui parlent des langues différentes mais se comprennent d’un geste, d’une photo échangée (même si un billet méprisant, méprisable les séparera, à nouveau). Contrastes de ces êtres soudainement plongés dans la solitude qui leur permet finalement de se retrouver. Mais surtout, surtout, malgré les langues : la même violence, la même solitude, la même incommunicabilité, la même fébrilité, le même rouge et la même blancheur, la même magnificence et menace de la nuit au-dessus des villes, la même innocence meurtrie, le même sentiment d’oppression dans la foule et dans le désert.  et qui, au moindre geste , à la moindre seconde, au moindre soupçon, peut basculer dans la violence irraisonnée, un monde qui n'a jamais communiqué aussi vite et mal, un monde que l'on prend en pleine face, fascinés et horrifiés à la fois, un monde brillamment ausculté, décrit, par des cris et des silences aussi ; un monde qui nous aveugle, nous assourdit, un monde de différences si semblables, un monde d’après 11 septembre.
et qui, au moindre geste , à la moindre seconde, au moindre soupçon, peut basculer dans la violence irraisonnée, un monde qui n'a jamais communiqué aussi vite et mal, un monde que l'on prend en pleine face, fascinés et horrifiés à la fois, un monde brillamment ausculté, décrit, par des cris et des silences aussi ; un monde qui nous aveugle, nous assourdit, un monde de différences si semblables, un monde d’après 11 septembre.  illuminé et ensoleillé le festival dont la projection deauvillaise fut même parsemée et ponctuée d’applaudissements effrénés. Toute la famille Hoover met le cap vers la Californie pour accompagner Olive, la benjamine de 7 ans, sélectionnée pour concourir à Little Miss Sunshine, un concours de beauté ubuesque et ridicule de fillettes permanentées, « collagènées » (ah, non, ça pas encore). Ils partent à bord de leur van brinquebalant et commencent un voyage tragi comique de 3 jours. La première qualité du film est que chaque personnage existe, enfin plus exactement tente d’exister. Il y a le frère suicidaire spécialiste de Proust, le fils, Dwayne qui a fait vœu de silence nietzschéen et qui a ainsi décidé de se taire jusqu’à ce qu’il entre à l’Air Force Academy, le père qui a écrit une méthode de réussite…qui ne se vend pas, le grand père cocaïnomane. On l’aura deviné en voyant la jeune Olive au physique ingrat mais non moins charmante, la fin du voyage n’est qu’un prétexte, belle parabole de l’existence et du thème du film, ode épicurien à l’opposé des principes du père qui déifie la réussite. Trois jours peuvent changer une existence, et malgré une mort et des rêves qui s’écroulent qui jalonnent leur parcours nous continuons à rire avec eux. Ces trois jours vont changer l’existence de cette famille et de ses truculents membres qui à réapprennent à vivre, vibrer, à parler, à être, à se regarder, à profiter de l’instant présent, et qui vont peu à peu laisser entrevoir leurs failles. Progressivement, l’humour, parfois délicieusement noir, laisse place à l’émotion qui s’empare du spectateur. Cette « carpe diem attitude » atteignant son paroxysme dans la jubilatoire scène du concours de miss qui a suscité les applaudissements spontanés des spectateurs deauvillais. Ce voyage initiatique d’une tendre causticité est aussi un road movie fantaisiste et poétique dans lequel l’émotion affleure constamment, vous envahit subrepticement jusqu’au bouquet final, un film dont je vous invite à prendre immédiatement la route. Une belle leçon de vie qui a insufflé un vent d’optimisme sur une sélection bien morose, des personnages attachants, un film qui surpassait de loin le reste de la sélection, une réussite d’autant plus louable lorsqu’on sait que le film a mis cinq ans à se monter, que tous les studios de Los Angeles et New York l’avaient auparavant refusé, lorsqu’on sait enfin sa réussite inattendue aux box-office américain !
illuminé et ensoleillé le festival dont la projection deauvillaise fut même parsemée et ponctuée d’applaudissements effrénés. Toute la famille Hoover met le cap vers la Californie pour accompagner Olive, la benjamine de 7 ans, sélectionnée pour concourir à Little Miss Sunshine, un concours de beauté ubuesque et ridicule de fillettes permanentées, « collagènées » (ah, non, ça pas encore). Ils partent à bord de leur van brinquebalant et commencent un voyage tragi comique de 3 jours. La première qualité du film est que chaque personnage existe, enfin plus exactement tente d’exister. Il y a le frère suicidaire spécialiste de Proust, le fils, Dwayne qui a fait vœu de silence nietzschéen et qui a ainsi décidé de se taire jusqu’à ce qu’il entre à l’Air Force Academy, le père qui a écrit une méthode de réussite…qui ne se vend pas, le grand père cocaïnomane. On l’aura deviné en voyant la jeune Olive au physique ingrat mais non moins charmante, la fin du voyage n’est qu’un prétexte, belle parabole de l’existence et du thème du film, ode épicurien à l’opposé des principes du père qui déifie la réussite. Trois jours peuvent changer une existence, et malgré une mort et des rêves qui s’écroulent qui jalonnent leur parcours nous continuons à rire avec eux. Ces trois jours vont changer l’existence de cette famille et de ses truculents membres qui à réapprennent à vivre, vibrer, à parler, à être, à se regarder, à profiter de l’instant présent, et qui vont peu à peu laisser entrevoir leurs failles. Progressivement, l’humour, parfois délicieusement noir, laisse place à l’émotion qui s’empare du spectateur. Cette « carpe diem attitude » atteignant son paroxysme dans la jubilatoire scène du concours de miss qui a suscité les applaudissements spontanés des spectateurs deauvillais. Ce voyage initiatique d’une tendre causticité est aussi un road movie fantaisiste et poétique dans lequel l’émotion affleure constamment, vous envahit subrepticement jusqu’au bouquet final, un film dont je vous invite à prendre immédiatement la route. Une belle leçon de vie qui a insufflé un vent d’optimisme sur une sélection bien morose, des personnages attachants, un film qui surpassait de loin le reste de la sélection, une réussite d’autant plus louable lorsqu’on sait que le film a mis cinq ans à se monter, que tous les studios de Los Angeles et New York l’avaient auparavant refusé, lorsqu’on sait enfin sa réussite inattendue aux box-office américain ! Bien que l’autre, la grande, l’essentielle, celle du 22 Avril me passionne, et me désole parfois aussi, ce n’est pas de celle-ci dont je viens vous parler mais de celle, beaucoup plus futile et donc nécessaire du concours de blogs du Festival de Romans. Quoi donc? Que vois-je ? Que deviné-je ? Vous n’avez pas encore voté pour « In the mood for cinema » ? Si vous voulez accomplir votre devoir
Bien que l’autre, la grande, l’essentielle, celle du 22 Avril me passionne, et me désole parfois aussi, ce n’est pas de celle-ci dont je viens vous parler mais de celle, beaucoup plus futile et donc nécessaire du concours de blogs du Festival de Romans. Quoi donc? Que vois-je ? Que deviné-je ? Vous n’avez pas encore voté pour « In the mood for cinema » ? Si vous voulez accomplir votre devoir 
 marocain procure à ce salon des allures du parc à la célèbre souris aux grandes oreilles ici en manque de moyens. Avec témérité, je poursuis néanmoins mon chemin, et déambule dans les allées encore presque vides, l’occasion d’observer de près le carrosse du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, vestige esseulé d’une autre et fastueuse époque, si banal de près, et sans grand intérêt si ce n’est peut-être de rendre hommage à la talentueuse réalisatrice qui a magnifié ce décor d’Anne Seibel. Un peu plus loin se trouve le stand du Maroc, puis celui de Bollywood, des aigles au regard menaçant en attente de spectateurs … ou de proies, un stand Virgin, le disproportionné stand de la SNCF, un stand Unifrance, un stand de coussins (si, si) un stand du Forum des Images qui nous apprend que la déjà fameuse bibliothèque n’ouvrira qu’à l’automne, quelques stands d’écoles de cinéma, et partout des stands d’une boisson alcoolisée. Pour un peu, je me serais demandée si je ne m’étais pas trompée de salon et si je ne m’étais pas retrouvée à celui de l’alcool. Un mélange incohérent dont le cinéma est vaguement le fil directeur. Tout cela ressemble plutôt à une vaste foire, à moins que ce ne soit un hommage conceptuel aux origines du septième art et au spectacle de foire qu’il était alors.
marocain procure à ce salon des allures du parc à la célèbre souris aux grandes oreilles ici en manque de moyens. Avec témérité, je poursuis néanmoins mon chemin, et déambule dans les allées encore presque vides, l’occasion d’observer de près le carrosse du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, vestige esseulé d’une autre et fastueuse époque, si banal de près, et sans grand intérêt si ce n’est peut-être de rendre hommage à la talentueuse réalisatrice qui a magnifié ce décor d’Anne Seibel. Un peu plus loin se trouve le stand du Maroc, puis celui de Bollywood, des aigles au regard menaçant en attente de spectateurs … ou de proies, un stand Virgin, le disproportionné stand de la SNCF, un stand Unifrance, un stand de coussins (si, si) un stand du Forum des Images qui nous apprend que la déjà fameuse bibliothèque n’ouvrira qu’à l’automne, quelques stands d’écoles de cinéma, et partout des stands d’une boisson alcoolisée. Pour un peu, je me serais demandée si je ne m’étais pas trompée de salon et si je ne m’étais pas retrouvée à celui de l’alcool. Un mélange incohérent dont le cinéma est vaguement le fil directeur. Tout cela ressemble plutôt à une vaste foire, à moins que ce ne soit un hommage conceptuel aux origines du septième art et au spectacle de foire qu’il était alors. Sautet. De quelques jours avec moi et du Mauvais fils. De cette influence flagrante dans chacun de ses films. De son bonheur quand une spectatrice lui dit qu’il arrête le temps. Oui, c’est ça « arrêter le temps », une de mes expressions favorites, récurrente sur ce blog. Créer une dimension parallèle, faire oublier, transcender la réalité, aussi. Il parle aussi de cette poignante chanson Lili qui a sublimé ce film. Et puis il parle de persévérance et d’audace lui aussi. Lui succède Isild Le Besco venue parler de Charlie, le film dont elle vient de terminer le montage et dans lequel son frère tient le rôle principal. Le sujet me rappelle le magnifique film d’Emmanuelle Bercot, Clément. La réalisatrice semble avoir influencé son actrice fétiche. Un peu ailleurs, voire totalement absente. Le lendemain ,c’est au tour de Danièle Thompson. De parler. Longtemps et le regard étincelant aussi. De persévérance et, paraphrasant Suzanne Flon dans Fauteuils d’orchestre, de prise de risques, aussi. Un instant je retrouve cette indécence involontaire des festivals quand un homme, fébrile, et déjà plus si jeune, lui rappelle avec orgueil qu’il a « tourné sous sa direction », je me dis que s’il avait tourné avec elle, elle s’en souviendrait, avouant qu’il était figurant (bah tiens) parlant de lui, de son fils star en devenir car quand même "premier rôle d’une série", l’oubliant elle, imperturbable d’ailleurs, ne s’arrêtant plus, spécifiant qu’il était l’ami (intime hein)d’un autre figurant, que ledit figurant la remerciait etc. Un scénariste qui aurait voulu illustrer la vanité (dans les deux sens du terme) n’aurait pas mieux fait. Touchant de pathétisme. Pendant ce temps Niels Tavernier tourne un court métrage faisant participer le public. Et des bandes annonces passent. Et une autre conférence se déroule à côté. Et des aigles impatients se font entendre. Ils ne manquent pourtant pas de proies, le salon a même dû momentanément fermer ses portes pour faire face à l’affluence. Et des courts métrages en sélection pour les César. J’en aperçois un : Les Volets. Cruel. Intéressant. Je n’aime pas apercevoir un film. J’aime le savourer. J’aurais plutôt dû venir au salon du chocolat. Et des démonstrations de kung fu et d’effets spéciaux. Et tout cela ne ressemble plus à rien. Si : à ce à quoi on veut assimiler le cinéma : une marchandise comme les autres. On incite à zapper, à passer d’un stand à un autre, d’un film à l’autre, à regarder sans voir, à entendre sans écouter. Plus loin, un scénariste raconte : pour écrire un film par exemple sur un chauffeur de taxi il faut forcément avoir été taxi au moins quelques temps soi-même, assène-t-il fièrement devant un public admiratif et conquis. Et pour écrire un film de truands il faut avoir braquer combien de banques ? Je me dis que, dans ce cas, Schoendoerffer ne doit alors pas être très fréquentable. Je me dis que décidément on entend n’importe quoi. Alors je repars, me souvenant néanmoins de la petite étincelle, faisant écho à la mienne, à ma persévérance, à mon envie insatiable d’écriture et d’arrêter le temps, encore et encore. Je repars laissant un public déchaîné écouter Michaël Youn (mon sens du sacrifice pour vous a ses limites) me promettant de relire sa « filmographie » certaine d’avoir raté un chef d’oeuvre du septième art au regard de sa fierté, je n’ose dire prétention. Bon, si, je le dis.
Sautet. De quelques jours avec moi et du Mauvais fils. De cette influence flagrante dans chacun de ses films. De son bonheur quand une spectatrice lui dit qu’il arrête le temps. Oui, c’est ça « arrêter le temps », une de mes expressions favorites, récurrente sur ce blog. Créer une dimension parallèle, faire oublier, transcender la réalité, aussi. Il parle aussi de cette poignante chanson Lili qui a sublimé ce film. Et puis il parle de persévérance et d’audace lui aussi. Lui succède Isild Le Besco venue parler de Charlie, le film dont elle vient de terminer le montage et dans lequel son frère tient le rôle principal. Le sujet me rappelle le magnifique film d’Emmanuelle Bercot, Clément. La réalisatrice semble avoir influencé son actrice fétiche. Un peu ailleurs, voire totalement absente. Le lendemain ,c’est au tour de Danièle Thompson. De parler. Longtemps et le regard étincelant aussi. De persévérance et, paraphrasant Suzanne Flon dans Fauteuils d’orchestre, de prise de risques, aussi. Un instant je retrouve cette indécence involontaire des festivals quand un homme, fébrile, et déjà plus si jeune, lui rappelle avec orgueil qu’il a « tourné sous sa direction », je me dis que s’il avait tourné avec elle, elle s’en souviendrait, avouant qu’il était figurant (bah tiens) parlant de lui, de son fils star en devenir car quand même "premier rôle d’une série", l’oubliant elle, imperturbable d’ailleurs, ne s’arrêtant plus, spécifiant qu’il était l’ami (intime hein)d’un autre figurant, que ledit figurant la remerciait etc. Un scénariste qui aurait voulu illustrer la vanité (dans les deux sens du terme) n’aurait pas mieux fait. Touchant de pathétisme. Pendant ce temps Niels Tavernier tourne un court métrage faisant participer le public. Et des bandes annonces passent. Et une autre conférence se déroule à côté. Et des aigles impatients se font entendre. Ils ne manquent pourtant pas de proies, le salon a même dû momentanément fermer ses portes pour faire face à l’affluence. Et des courts métrages en sélection pour les César. J’en aperçois un : Les Volets. Cruel. Intéressant. Je n’aime pas apercevoir un film. J’aime le savourer. J’aurais plutôt dû venir au salon du chocolat. Et des démonstrations de kung fu et d’effets spéciaux. Et tout cela ne ressemble plus à rien. Si : à ce à quoi on veut assimiler le cinéma : une marchandise comme les autres. On incite à zapper, à passer d’un stand à un autre, d’un film à l’autre, à regarder sans voir, à entendre sans écouter. Plus loin, un scénariste raconte : pour écrire un film par exemple sur un chauffeur de taxi il faut forcément avoir été taxi au moins quelques temps soi-même, assène-t-il fièrement devant un public admiratif et conquis. Et pour écrire un film de truands il faut avoir braquer combien de banques ? Je me dis que, dans ce cas, Schoendoerffer ne doit alors pas être très fréquentable. Je me dis que décidément on entend n’importe quoi. Alors je repars, me souvenant néanmoins de la petite étincelle, faisant écho à la mienne, à ma persévérance, à mon envie insatiable d’écriture et d’arrêter le temps, encore et encore. Je repars laissant un public déchaîné écouter Michaël Youn (mon sens du sacrifice pour vous a ses limites) me promettant de relire sa « filmographie » certaine d’avoir raté un chef d’oeuvre du septième art au regard de sa fierté, je n’ose dire prétention. Bon, si, je le dis.
 festivals de cinéma.
festivals de cinéma.