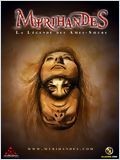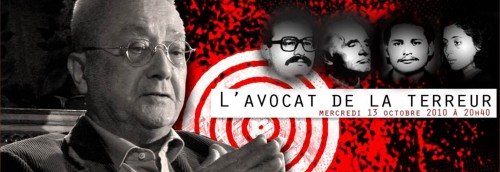"Les petits mouchoirs" de Guillaume Canet: extraits et critique
Je vous ai déjà parlé du dernier film de Guillaume Canet "Les petits mouchoirs" (dont vous pouvez retrouver ma critique en bas de cet article). Je vous propose aujourd'hui d'en découvrir 5 nouveaux extraits... même si je vous conseillerais plutôt d'attendre pour les visionner et de garder le plaisir de la découverte pour sa projection en salles...
Critique du film:
Après les succès de « Mon idole » (dont j’avais aimé la causticité) et « Ne le dis à personne » (par lequel je n’avais pas été convaincue, voir ici) Guillaume Canet, comme beaucoup de réalisateurs, aurait pu se contenter d’adapter un best-seller avec une part de risque minimale. Il a au contraire choisi un sujet très personnel (pour lequel il a même refusé de travailler pour Scorsese) et c’est à la fois la grande force et la faiblesse du film.
Direction le Cap-Ferret, une maison en bord de mer appartenant à Max (François Cluzet), une maison où chaque été se réunit une bande d’amis. Seulement cet été-là, tout est comme d’habitude et à la fois différent car l’un d’entre eux, Ludo (Jean Dujardin) manque à l’appel, retenu sur un lit d’hôpital. Chacun va mettre un « petit mouchoir » sur la vérité. Le petit mouchoir c’est le voile du mensonge, le masque que chacun arbore pour ne pas dévoiler ses doutes, ses failles et ses angoisses. Les petits mouchoirs, ce sont les mensonges faits aux autres mais surtout à soi-même.
Cela commence au Baron, célèbre boîte de nuit du 8ème arrondissement. Un habile plan-séquence qui nous plonge dans cette frénésie et en capture la gravité masquée de bonne humeur excessive : la gaieté feinte et les rires factices et exubérants suscités par l’alcool, la drogue, la tristesse dissimulée. Puis c’est le fracas de la réalité. Et le retour à la vie normale comme si de rien n’était… ou presque.
Guillaume Canet nous immerge alors dans la vie de ces amis au Cap-Ferret avec la volonté délibérée de faire « un film de potes » comme il le dit lui-même. S’il évoque notamment « Mes meilleurs copains » de Jean-Marie Poiré, en inconditionnelle du cinéma de Claude Sautet, j’ai évidemment plutôt pensé à « Vincent, François, Paul et les autres ». D’ailleurs, Benoît Magimel s’appelle Vincent ; François Cluzet s’appelle ici Max (comme Michel Piccoli dans « Max et les ferrailleurs ») et il m’a rappelé ce dernier dans la fameuse scène de colère de « Vincent, François, Paul et les autres ». Gabin aussi, si célèbre pour ses scènes de colère. Et la maison du Cap-Ferret m’a fait penser à celle de « César et Rosalie ».
Même si Guillaume Canet/réalisateur n’atteint pas cette note parfaite, cette virtuosité à laquelle accédait Claude Sautet, mélomane averti, il y a dans ce film cette même quête de raconter la complexité derrière « une histoire simple », de quérir les frémissements de vie, les fléchissements en chacun, de dévoiler une part du mystère dans lequel chacun se drape.
Plus qu’à Claude Sautet, il m’a d’ailleurs fait penser à Lelouch (même s’il reniera peut-être cette comparaison, lui qui lorgne davantage du côté du cinéma américain et cite plus volontiers Cassavetes) dans sa quête de « fragment de vérité », dans sa sincérité, dans sa façon de filmer au plus près des visages, d’effleurer presque amoureusement ses personnages, et de constamment chercher à tirer le meilleur de ses acteurs. Les virtuoses ce sont eux et c’est la raison pour laquelle il n’a pas voulu faire de l’esbroufe dans sa réalisation. Sa mise en scène se fait donc ainsi discrète. Le cadre à la fois étouffe et caresse les personnages et les enserre, comme ils le sont dans leurs apparences et leurs mensonges.
A l’exception de Laurent Lafitte (dont les rires et les larmes m’ont semblé parfois forcés), le casting est irréprochable. Chaque apparition de François Cluzet est un pur bonheur, à la fois irascible et touchant, volubile et secret. Benoît Magimel dégage un charme mélancolique irrésistible. Marion Cotillard n’a jamais été filmée aussi amoureusement, à la fois frontalement et délicatement. Valérie Bonneton est férocement drôle et Gilles Lellouche incarne avec beaucoup de nuances son personnage qui accepte enfin et trop tard de grandir. Quant à Joel Dupuch, il est plus qu’il ne joue et le film y gagne en émotion et gravité.
La comparaison avec Lelouch s’arrête là, si ce n’est qu’elle explique sans doute aussi la virulence de certaines réactions suite à l’avant-première. Elle s’arrête là parce que Canet impose son propre rythme et son propre style et de films en films construit son propre univers.
« Les petits mouchoirs » dure 2H25, beaucoup trop semble-t-il pour certains. Or, justement, c’est cette durée qui nous permet de créer la proximité avec les personnages, c’est une durée qui coïncide judicieusement avec le fond du film. Une durée nécessaire pour donner du temps au temps, pour laisser tomber les masques, pour prendre le temps de vivre, d’accepter la qualité des silences, du temps qui passe et en saisir la beauté et la violence fugaces. Il n’est pas dans le spectaculaire mais dans l’intime. Il ne cherche pas à nous en mettre plein la vue mais à ouvrir notre regard, lui laisser le temps de se poser, de regarder la vie qui passe et qu’il tente de capter. Certaines scènes peut-être auraient pu être écourtées voire supprimées –même si beaucoup l’ont déjà été puisque le montage initial faisait près de 4H-(et c’est là sans doute que le film est « trop » personnel, en totale empathie pour son sujet, ses personnages et ses acteurs, Guillaume Canet nous oublie un peu) mais il a en tout cas beaucoup de tendresse communicative pour ses personnages et ses acteurs et nous donne envie , malgré et à cause de leurs failles, de se joindre à eux.
A l’issue de la projection, Guillaume Canet a demandé que nous n’évoquions ni la fin ni le début, tétanisé visiblement à l’idée qu’ils puissent être dévoilés, pourtant ce n’est pas là que réside le principal intérêt de son film. La fin est d’ailleurs attendue mais non moins bouleversante faisant surgir l’émotion contenue qui explose et avec elle les masques de chacun, faisant voler en éclats les petits mouchoirs posés sur la vérité. Le rire n’a jamais si bien illustré sa définition de « politesse du désespoir », tout son film étant jalonné de moments drôles et savoureux mais qui sont aussi touchants parce que le masque de la culpabilité et/ou de la tristesse qui affleurent dans un regard soudainement assombri. Son film souffre donc (un peu) mais s’enrichit (surtout) d’être très personnel. Pour moi, Guillaume Canet/réalisateur est donc indéniablement meilleur quand il signe un sujet personnel que quand il adapte Harlan Coben. J’en attends beaucoup de son futur projet avec James Gray.
Un film choral qui ne cherche pas à révolutionner le cinéma (et dont je n’ai d’ailleurs cessé de me dire pendant toute la projection qu’il ferait une excellente pièce de théâtre) mais qui vous donne envie de prendre le temps de vivre, de laisser choir le voile du mensonge, de regarder et voir, d’écouter et d’entendre. Et c’est finalement là sans doute la plus discrète des audaces et sa vraie réussite. . Malgré quelques longueurs vous ne verrez pas passer les 2H25 de ce troisième long-métrage de Guillaume Canet qui enlace ses personnages avec une tendre lucidité et embrasse la vie et sa cruauté poignante et involontaire avec tendresse et qui, à son image, complexe et paradoxale, s’achève sur une touchante note de tristesse et d’espoir.
BONUS: Mes vidéos du débat à l'issue de la projection en avant-première avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche