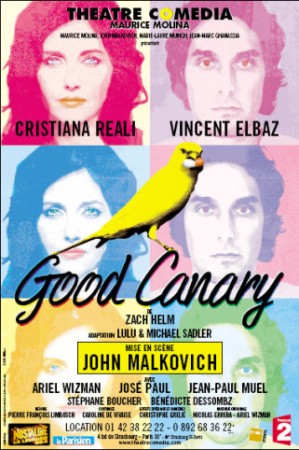80ème cérémonie des Oscars: le cinéma français à l'honneur
 Oui, je l’avoue de nouveau: je n’ai pas été emballée par « La Môme » (voir ici)d’Olivier Dahan, et j’aurais préféré que le cinéma français soit à l’honneur pour un autre film, mais je ne peux néanmoins m’empêcher de me réjouir que notre cinéma, celui qui a le devoir de faire le meilleur cinéma au monde pour reprendre les propos de Roberto Benigni aux César, soit ainsi le "héros" de cette 80ème cérémonie des Oscars, que Marion Cotillard ait reçu l’Oscar de la meilleure actrice (après un César, un Golden Globe et un Bafta pour ce même rôle d'Edith Piaf! Elle devient ainsi la troisième française oscarisée après Simone Signoret pour "Les chemins de la haute ville" en 1960 et après Juliette Binoche-alors Oscar du meilleur second rôle- pour "Le Patient Anglais" en 1997) pour un film français, mais aussi et peut-être surtout, que l’Oscar du meilleur court-métrage soit également attribué à un film français qui avait d’ailleurs déjà reçu le César du meilleur court deux jours auparavant : « Le Mozart des Pickpockets » de Philippe Pollet-Villard . Deux Oscars qui témoignent de la diversité de notre cinéma.
Oui, je l’avoue de nouveau: je n’ai pas été emballée par « La Môme » (voir ici)d’Olivier Dahan, et j’aurais préféré que le cinéma français soit à l’honneur pour un autre film, mais je ne peux néanmoins m’empêcher de me réjouir que notre cinéma, celui qui a le devoir de faire le meilleur cinéma au monde pour reprendre les propos de Roberto Benigni aux César, soit ainsi le "héros" de cette 80ème cérémonie des Oscars, que Marion Cotillard ait reçu l’Oscar de la meilleure actrice (après un César, un Golden Globe et un Bafta pour ce même rôle d'Edith Piaf! Elle devient ainsi la troisième française oscarisée après Simone Signoret pour "Les chemins de la haute ville" en 1960 et après Juliette Binoche-alors Oscar du meilleur second rôle- pour "Le Patient Anglais" en 1997) pour un film français, mais aussi et peut-être surtout, que l’Oscar du meilleur court-métrage soit également attribué à un film français qui avait d’ailleurs déjà reçu le César du meilleur court deux jours auparavant : « Le Mozart des Pickpockets » de Philippe Pollet-Villard . Deux Oscars qui témoignent de la diversité de notre cinéma.
« La Môme » sous son titre pour le cinéma américain « La vie en rose » a également reçu le prix du meilleur maquillage. Si je voulais être sarcastique (non, non, ce n’est pas mon genre), je ferais un commentaire et un parallèle mais je m’abstiendrai. Le talent de Marion Cotillard est incontestable, malgré toutes les outrances du film précité.
Sur ses 10 nominations ( dont 4 pour « le Scaphandre et le papillon » de Julian Schnabel qui n’a malheureusement récolté aucun Oscar ) le cinéma français est donc reparti avec 3 Oscars.
Je me réjouis également pour « Once » dont la chanson a été récompensée, un film qui était en compétition au dernier Festival du Film Britannique de Dinard, et dont le concert en direct avait charmé tous les festivaliers (promis, la vidéo un de ces jours, sur le blog...)
« No country for old men » est reparti grand vainqueur avec 4 Oscars dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour les frères Coen.

« La vengeance dans la peau » dont le rythme trépidant tient beaucoup de sa mise en scène mais aussi de son montage a reçu trois trophées techniques. (meilleur montage son, meilleur mixage son, meilleur montage)
L’Oscar du meilleur film en langue étrangère est revenu à l’Autrichien « Stefan Ruzowitzky » pour « Les Faussaires ».
Je suis évidemment déçue que « L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford » d'Andrew Dominik qui reste pour moi le meilleur film américain de l’année 2007 (en précisant néanmoins que je n’ai pas encore vu « There will be blood")et que je continue à défendre quoiqu’ « on » en dise, n'ait rien obtenu et que Casey Affleck n'ait pas obtenu l'Oscar du meilleur second rôle, et que la photographie qui y est absolument exceptionnelle n'ait pas non plus été récompensée…
Pour le reste je vous laisse découvrir l'intégralité du palmarès ci-dessous:
Intégralité du Palmarès de la 80ème cérémonie des Oscars:
Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood
Meilleur acteur, second rôle
Javier Bardem - No Country for Old Men
Meilleure actrice
Marion Cotillard - La Vie en Rose
Meilleure actrice, second rôle
Tilda Swinton - Michael Clayton
Meilleur film d'animation
Ratatouille
Meilleure direction artistique
Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street
Meilleur direction photo
No Country for Old Men
Meilleurs costumes
Elizabeth: The Golden Age
Meilleur réalisateur
Joel et Ethan Coen, No Country for Old Men
Meilleur documentaire
Taxi to the Dark Side
Meilleur documentaire, court-métrage
Freeheld
Meilleur montage
The Bourne Ultimatum
Meilleur film étranger
The Counterfeiters (Les Faussaires) Austria
Meilleur maquillage
La Vie en Rose
Meilleur musique de film
Dario Marianelli, Atonement
Meilleure chanson originale pour un film
Falling Slowly dans le film Once; Glen Hansard et Marketa Irglova
Meilleur film
No Country for Old Men
Meilleur film d'animation, court-métrage
Peter & the Wolf
Meilleur court-métrage
Le Mozart des Pickpockets
Meilleur montage sonore
The Bourne Ultimatum
Meilleure sonorisation
The Bourne Ultimatum
Meilleurs effets visuels
The Golden Compass
Meilleure adaptation de scénario
No Country for Old Men
Meilleur scénario original
Juno








 Dans son Paris à lui se trouvent des personnages dont les définitions ressemblent parfois à des pléonasmes : il y a des maraîchers amoureux (Albert Dupontel, Julie Ferrier, Gilles Lellouche, Zinedine Soualem), une boulangère dont le sourire commercial dissimule à peine ses lieux communs et préjugés (Karin Viard), une assistante sociale en mal d’amour(Juliette Binoche), un architecte « trop normal » (François Cluzet), un SDF malmené, un prof de fac en pleine crise existentielle (Fabrice Luchini) amoureux d’une étudiante (Mélanie Laurent), une mannequin superficielle (Audrey Marnay), un clandestin camerounais qui rêve de l’image d’Epinal de Paris, là-bas, si loin… Rien ne les rassemble a priori si ce n’est cette ville, les ramifications du destin, telles des lignes de métro qui de toute façon finissent en un même point : le cœur. Tous les chemins mènent au cœur de Paris. Le cœur, justement, celui qui menace de lâcher à tout instant, cœur de Pierre. L’éphémère face à l’éternel. L’insignifiant face à l’essentiel. La vie face à la mort. La ville vue par le prisme d’un condamné à mort : une ville dont le cœur bat, insouciante, une ville qui vibre, qui danse, une ville de tous les possibles, une ville et une vie où rien n’empêche personne de « donner une chance au hasard », de faire valser les fils du destin comme il le fait du haut de son balcon.
Dans son Paris à lui se trouvent des personnages dont les définitions ressemblent parfois à des pléonasmes : il y a des maraîchers amoureux (Albert Dupontel, Julie Ferrier, Gilles Lellouche, Zinedine Soualem), une boulangère dont le sourire commercial dissimule à peine ses lieux communs et préjugés (Karin Viard), une assistante sociale en mal d’amour(Juliette Binoche), un architecte « trop normal » (François Cluzet), un SDF malmené, un prof de fac en pleine crise existentielle (Fabrice Luchini) amoureux d’une étudiante (Mélanie Laurent), une mannequin superficielle (Audrey Marnay), un clandestin camerounais qui rêve de l’image d’Epinal de Paris, là-bas, si loin… Rien ne les rassemble a priori si ce n’est cette ville, les ramifications du destin, telles des lignes de métro qui de toute façon finissent en un même point : le cœur. Tous les chemins mènent au cœur de Paris. Le cœur, justement, celui qui menace de lâcher à tout instant, cœur de Pierre. L’éphémère face à l’éternel. L’insignifiant face à l’essentiel. La vie face à la mort. La ville vue par le prisme d’un condamné à mort : une ville dont le cœur bat, insouciante, une ville qui vibre, qui danse, une ville de tous les possibles, une ville et une vie où rien n’empêche personne de « donner une chance au hasard », de faire valser les fils du destin comme il le fait du haut de son balcon. Karin Viard est parfaite dans le rôle de la boulangère en veste pied-de-poule et col roulé, avec ses bijoux et ses réflexions d’un autre âge, Fabrice Luchini aussi en historien amoureux égaré, Julie Ferrier aussi en maraîchère éprise de liberté, en fait il faudrait citer toute la distribution : François Cluzet, Albert Dupontel, Zinedine Soualem, Mélanie Laurent, Juliette Binoche évidemment. Un casting impeccable, en tout cas une direction d’acteurs irréprochable.
Karin Viard est parfaite dans le rôle de la boulangère en veste pied-de-poule et col roulé, avec ses bijoux et ses réflexions d’un autre âge, Fabrice Luchini aussi en historien amoureux égaré, Julie Ferrier aussi en maraîchère éprise de liberté, en fait il faudrait citer toute la distribution : François Cluzet, Albert Dupontel, Zinedine Soualem, Mélanie Laurent, Juliette Binoche évidemment. Un casting impeccable, en tout cas une direction d’acteurs irréprochable.

 sur laquelle Jeanne Moreau a d’ailleurs insisté (remettant ainsi comme un flambeau le César d’honneur que son partenaire du « Temps qui reste » de François Ozon, Melvil Poupaud, lui a remis, à Céline Sciamma, réalisatrice de « Naissance des pieuvres » lui donnant pour mission de le transmettre l’année suivante à un autre réalisateur d’un premier film), récompensant ainsi autant le cinéma plutôt dit d’auteur avec
sur laquelle Jeanne Moreau a d’ailleurs insisté (remettant ainsi comme un flambeau le César d’honneur que son partenaire du « Temps qui reste » de François Ozon, Melvil Poupaud, lui a remis, à Céline Sciamma, réalisatrice de « Naissance des pieuvres » lui donnant pour mission de le transmettre l’année suivante à un autre réalisateur d’un premier film), récompensant ainsi autant le cinéma plutôt dit d’auteur avec  Sans surprise, Mathieu Amalric a reçu le César d’interprétation masculine face à des acteurs de nombreuses fois nommés et toujours repartis bredouille : Vincent Lindon, Jean-Pierre Marielle notamment.
Sans surprise, Mathieu Amalric a reçu le César d’interprétation masculine face à des acteurs de nombreuses fois nommés et toujours repartis bredouille : Vincent Lindon, Jean-Pierre Marielle notamment. 
 Dans un français impeccable, Florian Henckel Von Donnersmarck a remercié l’Académie pour son César du meilleur film étranger pour
Dans un français impeccable, Florian Henckel Von Donnersmarck a remercié l’Académie pour son César du meilleur film étranger pour  musique aux « Chansons d’amour », seul César obtenu par le film de Christophe Honoré.
musique aux « Chansons d’amour », seul César obtenu par le film de Christophe Honoré. Les César dévoileront leur palmarès ce soir, à 21H, en clair, sur Canal plus, lors d’une cérémonie présidée par Jean Rochefort, présentée par Antoine de Caunes.
Les César dévoileront leur palmarès ce soir, à 21H, en clair, sur Canal plus, lors d’une cérémonie présidée par Jean Rochefort, présentée par Antoine de Caunes.





 La semaine dernière, à la SACD, avait également lieu une rencontre sur l’adaptation
La semaine dernière, à la SACD, avait également lieu une rencontre sur l’adaptation  cinématographique. ( 4 conférences annuelles destinées aux auteurs sont organisées par le CNC et la SACD, la salle est très petite, il est donc recommandé de s’inscrire très tôt ; la prochaine rencontre aura pour thème « Quels tremplins pour la télévision pour les auteurs débutants », le 1er Avril, à 14H, au CNC). Lors de cette conférence Claude Miller et Philippe Grimbert ont évoqué leurs visions respectives de l’adaptation, Philippe Grimbert a souligné à quel point Claude Miller a « bien trahi » son œuvre pour l’adaptation d’
cinématographique. ( 4 conférences annuelles destinées aux auteurs sont organisées par le CNC et la SACD, la salle est très petite, il est donc recommandé de s’inscrire très tôt ; la prochaine rencontre aura pour thème « Quels tremplins pour la télévision pour les auteurs débutants », le 1er Avril, à 14H, au CNC). Lors de cette conférence Claude Miller et Philippe Grimbert ont évoqué leurs visions respectives de l’adaptation, Philippe Grimbert a souligné à quel point Claude Miller a « bien trahi » son œuvre pour l’adaptation d’



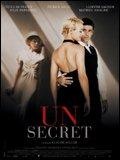

 Venant d’obtenir la confirmation de mon accréditation du Festival de Cannes 2008, je vous annonce d’ores et déjà que vous pourrez lire mon compte-rendu en direct du Festival dès l’ouverture sur mon autre blog « In the mood for Cannes » (
Venant d’obtenir la confirmation de mon accréditation du Festival de Cannes 2008, je vous annonce d’ores et déjà que vous pourrez lire mon compte-rendu en direct du Festival dès l’ouverture sur mon autre blog « In the mood for Cannes » ( Patrice Chéreau présidera le jury du Festival du Film Asiatique de Deauville 2008 et Jan kounen présidera le jury Action Asia. Le Festival aura lieu du 12 au 16 Mars 2008. Pour en savoir plus sur ce festival, rendez-vous sur mon blog consacré aux festivals de Deauville "In the mood for Deauville" (
Patrice Chéreau présidera le jury du Festival du Film Asiatique de Deauville 2008 et Jan kounen présidera le jury Action Asia. Le Festival aura lieu du 12 au 16 Mars 2008. Pour en savoir plus sur ce festival, rendez-vous sur mon blog consacré aux festivals de Deauville "In the mood for Deauville" (