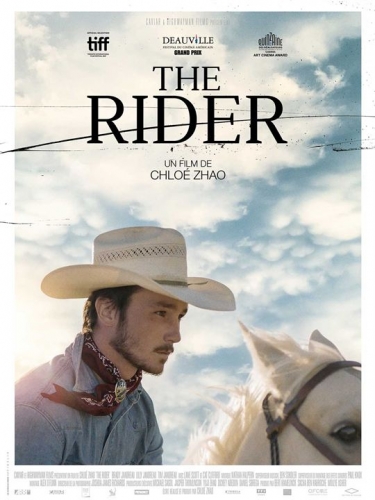Critique de PLACE PUBLIQUE d’Agnès Jaoui

Cela aurait pu se passer en Sologne, au domaine de la Colinière où se croiseraient aristocrates, bourgeois et employés de maison qui y seraient revenus des décennies plus tard. Nous ne sommes pourtant plus à la fin des années 1930 mais en 2017. Les aristocrates et bourgeois sont devenus des gens de télévision. Et la "règle du jeu" n’a pas changé tant que cela. Là aussi, comme dans le film éponyme de Renoir, chacun porte un masque. Là aussi, surtout, la menace plane, comme l’annonce d’emblée un coup de feu qui ouvre le flashback et nous fait remonter le temps avant l’orage, avant que la place publique ne se vide.
C’est dans une grande maison proche de Paris que tout va en effet se jouer, que tout un joyeux petit monde se retrouve pour une pendaison de crémaillère. Il y a là Castro -dont le patronyme n'est d'ailleurs certainement pas innocent- (Jean-Pierre Bacri), autrefois star du petit écran, à présent animateur sur le déclin. C’est son chauffeur, Manu (Kevin Azaïs) qui le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie (Léa Drucker), qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène (Agnès Jaoui), sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina (Nina Meurisse), qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...
Sur le chemin qui les mène à la crémaillère, Castro et son chauffeur s’arrêtent en pleine campagne. Costumes noirs, voiture noire sur fond de nature verdoyante. Le contraste saute immédiatement aux yeux. Le choc des univers, à commencer par ceux de la campagne et de la ville, est annoncé. Ils écoutent une interview à laquelle a récemment répondu Castro qui clame que vieillir c’est « atteindre une sorte de sérénité ». La suite démontrera tout le contraire. Comme dans un film de Woody Allen, le roi des scènes d’exposition, en quelques répliques et quelques plans, le ton est donné, et notre attention captivée.
Comme ne le cessera de le répéter Nathalie (la productrice de Castro) tout au long de la soirée, semblant découvrir avec ébahissement qu’une vie est possible une fois le périphérique parisien franchi, cette maison est à « seulement 35 minutes de Paris ». La condescendance parisianiste n’est pas épargnée, et c’est réjouissant. Chaque personnage incarne d’ailleurs un stéréotype de notre époque. De leur confrontation nait la comédie et/ou la mélancolie. Le jardin devient la place publique où se croisent ceux qui ailleurs se méprisent, se dédaignent ou, pire, s’ignorent. Les uns sont obsédés par les selfies quand d’autres (Nathalie et son sourire carnassier) ont le portable constamment vissé à l’oreille. Et tout ce petit monde se côtoie et utilise beaucoup les moyens de communications sans vraiment se comprendre, sans vraiment se rencontrer. Du moins dans un premier temps…
L’écriture de Jaoui et Bacri s’attache à faire exister autant les premiers que les « seconds » rôles comme l’assistant naïf et grégaire, le youtubeur qui se croit le centre du monde et qui estime que sa gloire, sans doute éphémère (l’opportunisme et la versatilité médiatiques ne sont pas épargnés non plus), lui permet tout, de tout avoir et de tout jeter aussi vite, la compagne de Castro (Héléna Noguerra), le compagnon russe de Nathalie qui trouve qu’il y a trop d’immigrés alors que lui-même est immigré russe, la fille (Nina Meurisse) qui écrit une autofiction…
Les liens se font et se défont au cours de la soirée. La réalisation, particulièrement inspirée, le souligne discrètement et admirablement : division des espaces avec un savant jeu d’oppositions, profondeur de champ, importance du second plan (où ce qui s’y joue est parfois aussi important que ce qui est au premier), caméra qui virevolte, indiscrète, intrusive au milieu de ce petit monde. Malgré l’unité de lieu et de temps, nous sommes bien au cinéma et non au théâtre. Jaoui et Bacri sont des dialoguistes indéniablement doués et, films après films, Agnès Jaoui prouve aussi un peu plus ses talents de réalisatrice (Le goût des autres, Comme une image, Parlez-moi de la pluie, Au bout du conte). La photographie d’Yves Angelo nimbe ce jardin, cette nature qui bruisse, et cette maison bourgeoise, d’une chaleureuse lumière qui procure la sensation d’une renaissance et que là, à cet instant, avec ce public bigarré, tout est possible et il nous semble presque en humer le parfum printanier. C’est ce qu’éprouve d’ailleurs Agnès Jaoui qui y retrouve son amour de jeunesse. Et en quelques mots, quelques regards échangés, quelques plans, nous éprouvons ce doux et exaltant sentiment de renaissance avec elle.
Il est difficile de ne pas établir de comparaison avec Le sens de la fête de Toledano, Nakache, sorti l’an passé. Là aussi unité de temps et de lieu, présence de Jean-Pierre Bacri, fête qui est prétexte au brassage social, et surtout dans l’un comme dans l’autre, finalement, derrière le groupe et la joie, l’atmosphère apparemment festive, affleure la solitude de chacun. Jaoui et Bacri n’ont pas leur pareil pour décrire la météo lunatique des âmes et ce nouveau film qu’ils ont coécrit ne déroge pas à la règle. Ils semblent plus pessimistes peut-être : l’une incarne celle qui n’a rien perdu de ses idéaux de jeunesse certes mais dont la générosité a visiblement oublié ses proches, l’autre (contrairement à son personnage du Goût des autres qui s’ouvrait aux autres et au monde, qui laissait tomber ses préjugés) reste enfermé dans ses préjugés et ses certitudes. Et au milieu de tout cela, attendant sagement sur sa chaise que la fête se termine, le chauffeur (charismatique Kevin Azaïs) observe avec bienveillance et semble incarner le propre regard des coscénaristes tout comme le compagnon d’Hélène (Eric Viellard) qui ne veut surtout jamais heurter personne, moins naïf qu’il n'y parait.
C’est finalement un film en forme de trompe-l’œil comme On connaît la chanson de Resnais (dont Jaoui et Bacri avaient aussi signé le scénario) qui commençait ainsi : ouverture sur une croix gammée, dans le bureau de Von Choltitz au téléphone avec Hitler qui lui ordonne de détruire Paris. Mais Paris ne disparaîtra pas et sera bien heureusement le terrain des chassés croisés des personnages, cette épisode était juste une manière de planter le décor, de nous faire regarder justement au-delà du décor. D’ailleurs, la dernière scène d’On connaît la chanson rappelle aussi celle de Place publique. Chacun y laisse tomber son masque, de fierté ou de gaieté feinte, dans le dernier acte où tous sont réunis, dans le cadre d’une fête qui, une fois les apparences dévoilées (même les choses comme l’appartement n’y échappent pas, même celui-ci se révèlera ne pas être ce qu’il semblait), ne laissera plus qu’un sol jonché de bouteilles et d’assiettes vides, débarrassé du souci des apparences, et du rangement (de tout et chacun dans une case). Ici aussi les masquent tombent au fur et à mesure de la soirée. Si pour certains la soirée sera celle des désillusions, pour d’autres des illusions vont éclore, malgré tout.
Comme la Règle du jeu évoqué en introduction, Place publique est un « drame gai », une « fantaisie dramatique ». Une comédie mélancolique, aussi. Comme Renoir, Jaoui et Bacri portent un regard incisif mais humaniste sur leurs contemporains, un regard inquiet aussi. Ils regardent leurs personnages, même les plus cyniques, même pétris de préjugés sociaux et/ou sexistes (les femmes dans le regard des hommes y sont souvent réduites à leur âge, leur apparence, ou leur condition sociale), avec bienveillance, avec le goût des autres. Dans les deux films le coup de feu est un présage, celui d’un horizon qui s’assombrit, de préjugés qui ternissent l’apparente quiétude. Et puis il y a tous ces petits moments de magie qui nous donnent envie de les rejoindre sur cette place publique. Ces moments ne sont d’ailleurs pas des scènes vaines mais à chaque fois des passages qui en disent long sur leurs personnages : quand le compagnon d’Hélène chante La tendresse et qu’elle ne semble pas voir ce qu’il lui crie, là et ailleurs, quand Castro persiste à chanter Les feuilles mortes en imitant Montand, pathétique et touchant, et que personne n’ose l’en empêcher. A chaque fois notre cœur se serre et l’émotion jaillit. Il y a enfin cette musique irrésistible jouée par un groupe sud-américain qui accompagne toute la soirée qui en donne le ton ou au contraire contraste avec celui-ci. Comme dans le film de Resnais, cela se termine en chanson et c’est cette petite musique qui nous accompagne bien après le générique de fin. Celle d’un film choral dans tous les sens du terme. Un film qui, sans atteindre la perfection du Goût des autres, exhale un charme fou, celui du printemps qui chante, du possible d’une rencontre ou d’une renaissance…