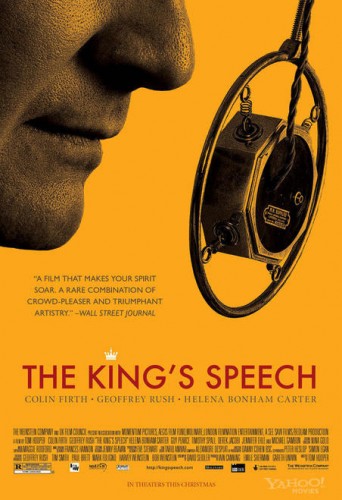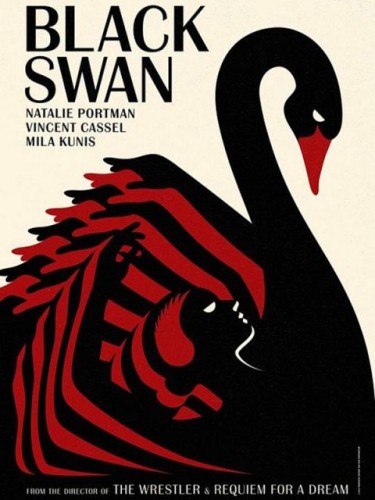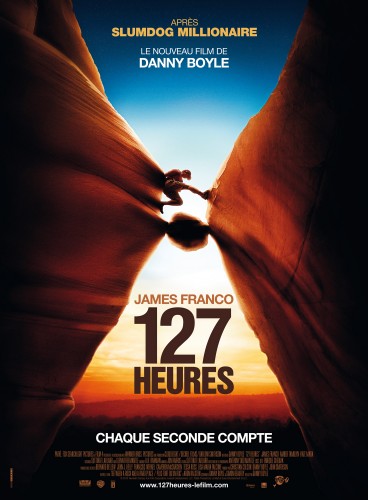Avant-première – Critique de « Fighter » de David O.Russell avec Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams
Il est curieux (ou significatif) de constater à quel point les thématiques des films en lice cette année pour les Oscars se ressemblent en ce qu’ils mettent en scène le combat d’un homme (ou d’une femme) face à lui-même ou elle-même ( « 127 heures », « Black swan », « Le discours d’un roi » et « Fighter ») voire pour lui-même (« The social network »). Alors que de nombreux citoyens, dans le monde arabe, se battent aujourd’hui pour la démocratie et la liberté, assisterons-nous à une recrudescence des films politiques après cet afflux de films « égocentrés » ? A suivre…
Micky Ward (Mark Wahlberg) est un jeune boxeur dont la carrière stagne et dont le demi-frère, Dicky Elund, (Cristian Bale) est une ancienne gloire du ring avant qu’il ne sombre dans la drogue et ne fasse de la prison. Désormais, il n’est plus que l’ombre de lui-même. De son côté, Micky rencontre Charlene (Amy Adams), une jeune femme au caractère bien affirmé qui travaille comme barmaid dans le café de la petite ville de Lowell (Massachussetts). Elle va l’aider à relancer sa carrière et à s’émanciper de sa famille envahissante. Mais les chemins de Micky et Dicky semblent inextricablement liés…
Les films sur la boxe sont tellement nombreux (parmi lesquels de nombreux grands films : « Million dollar baby », « Raging bull », « Rocco et ses frères » -dans une moindre mesure, la boxe n’étant pas le sujet central-, « Girlfight », « The Wrestler »…) que c’est presque un genre à part entière, il est donc périlleux et présomptueux de vouloir apporter sa pierre à l’édifice.
Le film est quasiment une parabole du projet en lui-même puisque Mark Wahlberg s’est réellement battu (tout de même uniquement au sens figuré) pour qu’il se fasse, à la fois en étant producteur exécutif et en s’entraînant plusieurs années pour incarner Micky Ward.
Toute l’intelligence du projet réside dans le point de vue et l’angle choisi puisqu’il s’agit d’abord de nous monter la cellule familiale (au propre comme au figuré) et les enjeux pour celle-ci que représente la carrière de Micky. Toute la famille semble être derrière lui et surtout vivre à travers lui qui est, jusqu’à se rencontre avec Charlene, plutôt velléitaire. Et quelle famille ! Pour le moins truculente, que ce soit la mère incarnée par une Melissa Leo méconnaissable ou les sept sœurs dont il est dommage qu’elles ne soient identifiables que comme une masse indifférenciée, grégaire, hostile, quasiment analphabète. J’aurais ajouté que ce n’était pas « crédible » si je n’avais lu depuis que certaines incarnent leurs propres rôles… La petite ville de Lowell est par ailleurs un personnage à part entière : ancienne ville industrielle en plein déclin au charme désenchanté où ont par ailleurs réellement vécu Micky et Dicky Ward.
« Fighter » est en effet inspiré d’une histoire vraie, celle du boxeur Micky Ward qui, après une spectaculaire série de victoires à la fin des années 80, connaît une véritable traversée du désert de trois ans avant de faire un exceptionnel retour en 1994.
L’homme à terre qui fait face à l’adversité, surmonte les difficultés et trouve la voie de la rédemption ( ce qui est d’ailleurs valable pour les deux frères) : des thèmes évidemment universels que la boxe, d’abord en arrière plan, permet d’illustrer métaphoriquement jusqu’à la scène finale, terriblement efficace, qui fait exploser l’émotion et la rage contenues pendant tout le film.
La réalisation du film devait initialement être confiée à Darren Aronofsky qui est finalement resté attaché au projet en tant que producteur exécutif. Peut-être aurait-il apporté au film ce lyrisme qui lui fait défaut –ce qui pour certains sera d’ailleurs une qualité- témoignant de la sobriété avec laquelle le sujet est traité, et un refus plutôt judicieux de l’aspect larmoyant dans lequel il aurait été aisé de tomber.
L’autre bonne idée (avec le point de vue sur le sujet) c’est le choix des acteurs Mark Wahlberg et Christian Bale (Matt Damon et Brad Pitt ont tous les deux été initialement pressentis pour incarner Dick Ecklund, avant que le rôle ne soit finalement confié à Christian Bale.) Le premier, velléitaire puis déterminé et combattif, le second méconnaissable, avec son visage émacié, son allure fantomatique, ancienne gloire dont on ne sait s’il doit son titre au talent ou à la chance.
Malgré quelques baisses de rythme, et un univers, celui de la boxe, maintes fois abordé au cinéma, Daid O.Russell a su en exploiter tout le potentiel cinématographique et spectaculaire et se différencier des précédents films sur le sujet grâce à un angle de vue original et des acteurs habités par leurs personnages. Beaucoup plus que l’histoire vraie à laquelle on tenterait de le réduire : « Fighter » est un film universel sur la combattivité et l’amour fraternel.
Un film à ne pas manquer et à suivre de près dimanche lors de la cérémonie des Oscars. Fighter a ainsi reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle, et celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Il a également obtenu 7 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur, des Oscars dont je vous reparle d’ailleurs très bientôt.
Sortie en salles : le 9 mars