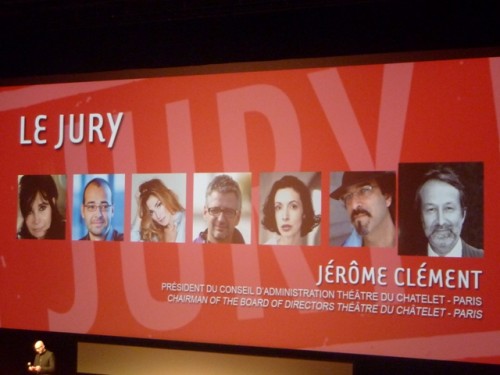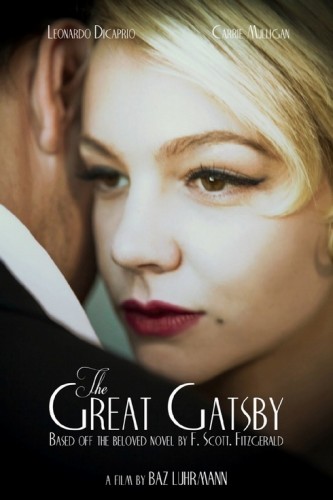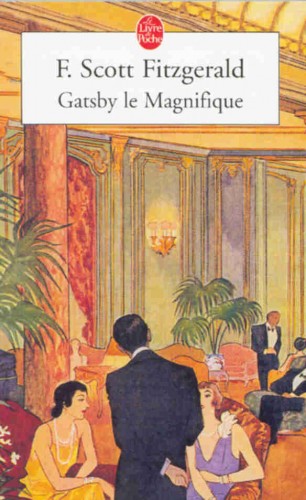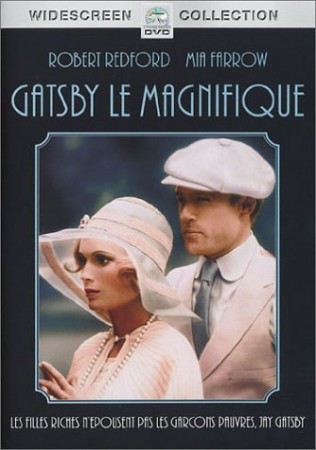15ème Festival du Film Asiatique de Deauville : bilan et palmarès









Alors que, depuis la fin de ce 15ème Festival du Film Asiatique, la ville de Deauville a été recouverte d’un hypnotique manteau blanc, il y a quelques jours encore un soleil, lui aussi hypnotique (certes entrecoupé de quelques averses), irradiait les planches tandis que, au CID, les spectateurs effectuaient une plongée dans la noirceur d’une société asiatique souvent oppressée par une crise décidément bel et bien mondiale, du moins pour ce qui en est des films en compétition qui ne furent pas moins passionnants justement parce qu’ils mettent en lumière cette face sombre et souvent ignorée ou en tout cas masquée par d’autres (ir)réalités.
9 films en compétition et autant de regards, d’univers différents que de nationalités malgré cette noirceur commune et un instructif voyage dans la société, la culture et le cinéma asiatiques. Seuls, égarés, broyés par la crise, la solitude, oppressés, perdus dans la multitude, les personnages des films de cette compétition étaient tous en errance sous ou en quête d’ une identité et d’un ailleurs souvent inacessible.
Petite parenthèse, avant de commenter le palmarès, pour vous annoncer que c’est à Deauville qui, décidément, me porte bonheur, que j’ai appris il y a quelques jours que Numériklivres publiera un autre de mes romans (probablement en mai 2013) dont je vous parle ici pour la bonne et simple raison qu’il se déroule entièrement dans le cadre du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Je vous en dirai prochainement plus sur mes différents blogs. Je peux vous dire qu’il sera très différent du premier également publié par Numériklivres, qu'il sera plus dense et sombre, et que j’y partage aussi autant ma passion pour le cinéma, ce festival que pour Deauville. En attendant retrouvez, ici, mon interview pour Numériklivres pour le précèdent roman publié.


Fin de la parenthèse pour replonger dans mes souvenirs de ce Festival du Film Asiatique de Deauville qui, cette année, célèbrait sa 15ème édition et qui, une fois de plus, non seulement a révélé des cinéastes en devenir mais aussi a rendu hommage à deux grands cinéastes asiatiques : Sono Sion (qui avait été récompensée pour « Himizu » l’an passé) et Wong Kar Wai.

Le second, avec « The Grandmaster » (dont je vous reparlerai ultérieurement), nous a offert un film d’une beauté envoûtante, sensuelle, fascinante qui parvient à faire oublier les lacunes scénaristiques tant la mise en scène y est un langage hypnotique qui nous immerge dans son univers si singulier et éblouissant. Oui, un film éblouissant dans tous les sens du terme.
Quant au premier, il nous a offert, en plus de sa masterclass (au cours de laquelle il a notamment parlé des cinéastes français qu’il aimait : René Clément, François Truffaut, Julien Duvivier et des poèmes qu’il écrivait dès l’âge de 22 ans, rien d’étonnant au regard de son univers, certes unique mais aussi celui d’un cinéphile poétique), le meilleur film de ce festival dont la beauté mélancolique et poétique faisait écho à celle de Deauville qui ne cessera jamais de me surprendre et ravir.
L’an passé, en compétition, le festival avait ainsi projeté « Himizu » du même Sono Sion, film que je qualifiais alors d’une rageuse, fascinante, exaspérante et terrifiante beauté. Les premiers plans, effroyables, nous plongeaient dans le décor apocalyptique de l’après tsunami exploré par de longs travellings, mais le chaos n’était alors pas seulement visuel, c’était surtout celui qui rongeait, détruisait, étouffait les êtres ayant perdu leur identité et tout espoir.

Ce nouveau long-métrage de Sono Sion intitulé "The land of hope" commence de manière plutôt inattendu : d’abord par son classicisme (relatif, mais du moins pour Sono Sion, moins dans la folie et l’explosion visuelles, ici) et ensuite parce qu’il met en scène un cadre bucolique, des couleurs chatoyantes et des personnages heureux. Evidemment, cela ne va pas durer et la réalité, tragique, terrible, celle du Japon que Sono Sion, films après films, dissèque et dénonce, va ressurgir avec un tremblement de terre qui frappe alors le Japon. Il entraîne l’explosion d’une centrale nucléaire. Sans vraiment en donner la raison, le gouvernement fait évacuer les habitants à proximité de la catastrophe. La famille Ono dont la ferme est située à cheval entre la zone de danger et le périmètre de sécurité, doit choisir entre fuir et rester. Sono sion va alors suivre trois couples : un couple de vieux paysans dont la femme est malade, vraisemblablement atteinte d’Alzheimer, un jeune couple qui s’apprête à avoir un enfant et un autre couple en quête des parents de la jeune femme mais aussi d’un avenir.
Aux scènes joyeuses du début succède un bref et effroyable vacarme puis un silence retentissant avant que la vie et l’image ne deviennent grisâtres puis avant que les couleurs « normales » ne reviennent, plus terrifiantes encore que ces couleurs grisâtres qui les ont précédées car si tout semble banal et quotidien, la menace et le danger sont là, constants, une guerre invisible. Les « autorités » (ici traitées au début comme une dictature par définition inique et intolérante) qui ne se contentent d’être que cela ne sont d’abord que des sortes de combinaisons inhumaines et sans identité. Tout est à la fois banal et singulier, paisible et agité. Comme le titre résonne (déraisonne aussi) alors comme une ironie tragique.
Dans la beauté éclatante de chaque plan (qui n’en est alors que plus redoutablement tragique puisqu’elle n’est que le masque de cet ennemi invisible), dans son humour désenchanté (l’absurdité de cette ligne qui sépare un jardin que Tati n’aurait osé inventer et pourtant terriblement réaliste ou de ces combinaisons de protection et la paranoïa qui seraient risibles si leur existence n’était malheureusement fondée), dans sa poésie d’une beauté et d’une tristesse ravageuses, Sono Sion nous livre son cri de révolte, d’une mélancolie déchirante : révolte contre les autorités (qu’il ne cesse de dénoncer tout au long du film), révolte contre cette centrale qu’« ils » ont malgré tout construite, une telle absurdité là aussi que c’est finalement celle qui a perdu la raison qui ne cesse de la souligner.
Sans doute Sono sion décontenancera-t-il ici ses admirateurs avec ce film plus classique que ses précédents mais, comme ses autres films, d’une beauté désenchantée, d’un romantisme désespéré (cette scène où le couple de vieux paysans danse au milieu du chaos est à la fois terriblement douce et violente, sublime et horrible, en tout cas bouleversante), d’un lyrisme et d’une poésie tragiques avec des paraboles magnifiquement dramatiques comme cet arbre -et donc la vie- qui s'embrasent mais aussi un travail sur le son d’une précision et efficacité redoutables.
Un film porté par un cri de révolte et l’énergie du désespoir, plus efficace que n’importe quelle campagne anti-nucléaire et surtout l’œuvre d’un poète, un nouveau cri d’espoir vibrant et déchirant qui s’achève sur un seul espoir, l’amour entre deux êtres, et une lancinante litanie d’un pas, qui, comme l’Histoire, les erreurs et la détermination de l’Homme, se répètent, inlassablement. Et à nouveau, pourtant, la possibilité d’un lendemain. Malgré tout, malgré l’horreur encore là et invisible. Et Fukushima délaissée par les médias, autre fatalité qui se répète, peut-être plus terrible encore : l’oubli.
PALMARES COMMENTE
Remis pour la première fois cette année (au passage, une excellente initiative) LE PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUVILLE a été décerné au film philippin « APPARITION » de Vincent SANDOVAL


Synopsis. 1971. Les sœurs du Monastère de l’Adoration mènent une existence paisible et isolée, loin de la ville de Manille. La mère supérieure Ruth dirige le lieu et accompagne ses consœurs dans leurs prières et leurs rituels quotidiens, fière de les protéger des vicissitudes du monde extérieur. La jeune Lourdes, ordonnée depuis peu, a rejoint le monastère et découvre la vie recluse. Peu de temps après son arrivée, Remy, une nonne externe, reçoit la visite inattendue de sa mère qui lui annonce la disparition de son frère activiste. En toute discrétion, Remy décide alors d’assister à des réunions de familles dont les proches ont disparus…
Le film se situe au début de la dictature de Marcos et toute l’intelligence du récit et de la mise en scène consiste à nous la faire vivre dans un huis-clos, celui du couvent. La guerre civile est à la fois extérieure et omniprésente d’abord par des propos à travers la grille, puis par la radio et ensuite par la peur puis l’horreur qui vont s’immiscer peu à peu et finalement envahir ce havre de tranquillité trompeur pour en souiller la blancheur. Essentiellement hors-champ, la violence qui bouillonne dans ce silence n’en est que plus oppressante à l’image de celle, invisible et tacite, que sœur Lourdes subit de ses supérieures. Evidemment, tout cela nous fait songer à « Des Hommes et des Dieux » mais là où le film de Xavier Beauvois établissait le portrait magnifique de 8 hommes avec leurs doutes et leurs convictions, qui donnaient tout, y compris leur vie, pour les autres, si le film de Vincent Sandoval nous montre aussi les doutes, le portrait est beaucoup moins idyllique. Le réalisateur traque la peur, les doutes, la lâcheté par le biais d’impitoyables et saisissants gros plans. Il met la foi, le courage, l’autorité à rude épreuve et fait de ce film dans un lieu en apparence hors du temps un récit tragiquement universel sur la barbarie, la lâcheté, l’oppression. Un cri dans le silence, vibrant, notamment grâce à des interprètes exceptionnelles et une réalisation maîtrisée qui joue habilement du clair obscur, de la blancheur et de la noirceur, un défi relevé en 8 jours seulement. Un prix du public largement mérité.
Le jury présidé par Jérôme Clément, entouré de Djamel Bensalah, Evelyne Bouix, Julie Gayet, Michel Leclerc, Géraldine Maillet et Atiq Rahimi a décerné les prix suivants qui, je trouve, reflètent parfaitement la diversité de ce festival et récompensent des films très différents mais qui, tous, méritaient de figurer au palmarès. Je ne suis pas mécontente de l’absence de « The Weight » au palmarès qui fait partie de ces films qui, sous prétexte d’une forme (certes et incontestablement) originale se permettent un fond glauque et sordide, finalement vain, une belle imposture.
LE LOTUS DU MEILLEUR FILM - Grand Prix a été attribué à I.D. de Kamal K.M. (Inde)
Après le film iranien de Morteza Farshbaf, "Querelles", l’an passé, c’est donc l’Inde qui est à l’honneur cette année pour un film loin de Bollywood auquel nous aurions tort de réduire le prolifique cinéma indien.
Synopsis
Charu et ses amies partagent un appartement dans l’une des tours de Mumbai. Toutes âgées d’une vingtaine d’années, elles sont venues des quatre coins du pays pour vivre dans la métropole. Un jour, un ouvrier se présente pour faire des travaux de peinture. Agacée de ne pas avoir été prévenue par ses colocataires, Charu presse le peintre d’en finir rapidement mais le retrouve quelques minutes plus tard allongé sur le sol, inconscient. Paniquée mais animée par la volonté de bien faire, elle part sillonner la ville de long en large à la recherche de la moindre information qui puisse la renseigner sur l’identité de cet homme….
Dans une société où la multiplicité des moyens de communication, au lieu de faciliter cette dernière la complexifie voire l’annihile bien souvent, dans une société mondialisée et des réseaux sociaux où chacun veut proclamer, vulgariser son identité se pose la passionnante question de ceux qui n’en ont pas. Au lieu de nous ouvrir au monde, ces moyens de communication, souvent, enferment dans un autre et c’est justement la recherche de l’identité de cet homme mort qui va finalement conduire Charu à perdre la sienne puis, peut-être, à la (se) trouver. Entre le documentaire et la quête initiatique, la recherche de la jeune femme nous fait découvrir les différents et contrastés visages de Mumbai du centre à la périphérie jusqu’aux bidonvilles, une plongée terrifiante (avec des petites touches empruntées au cinéma d’horreur ou en tout cas à suspense) dans un monde qui grouille d’anonymes, d’inconnus, de « sans identités ». Charu se retrouve confrontée à un monde absurde, s’éloigne de plus en plus des siens pour se retrouver égarée au milieu d’une marée de visages pire qu’hostiles, inconnus, sans identités et ignorant tout de la sienne. Une plongée dans l’envers du décor de Bollywood et de l’Inde mais surtout le reflet pertinent d’une société mondialisée (et car mondialisée) individualiste. Plus encore que sa réalisation, un message tristement universel qui faisait de ce prix pour ce film intelligent une évidence pour le jury qui l’a primé à l’unanimité.
LE LOTUS DU JURY - Le Prix du Jury ex-aequo a d’abord été attribué à FOUR STATIONS de Boonsong NAKPHOO (Thaïlande)

Synopsis - Des personnes en bas de l’échelle sociale vivent le long de la voie ferrée dans quatre régions différentes de la Thaïlande et se battent pour survivre. Au Nord, Tu Pu, un vieux moine, essaye tant bien que mal d’enseigner la sagesse et la maîtrise de soi aux jeunes novices. Au Centre, Too, un travailleur venu de Birmanie doit quitter son travail dans une ferme afin de retrouver sa femme et empêcher son retour prématuré dans leur pays d’origine. Au Nord-Est, Boonkong, un orphelin, fait de son mieux pour gagner la confiance de sa tante et de son mari. Au Sud, Chuan et Klaew qui vivaient en bon voisinage depuis des années ne peuvent plus se supporter...
Dans le calme et la beauté de la nature que chaque plan exhale et exalte par le biais de plans d’une beauté et d’une tristesse mêlées époustouflantes, le temps semble suspendu mais derrière cette trompeuse sérénité (qui, finalement rappelle celle qui l’est tout autant du couvent d’ « Apparition ») se trouve un monde qui se délite, un monde en crise. Si cette sérénité contraste avec la vie qui grouille dans « ID » la détresse et la solitude sont finalement similaires. Après « Eternity » de Sivaroj Kongsakul (Grand Prix du festival en 2011), le cinéma thaïlandais prouve une nouvelle fois sa richesse mais aussi une lenteur, une vision du temps, une capacité à embrasser l’écoulement du temps et la beauté simple de la nature qui lui sont propres.
L’autre prix du jury a été attribué à MAI RATIMA de YOO Ji-tae (Corée du Sud)


Le Coréen Yoo Ji-Tae venu présenter son film à Deauville comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous est loin d’être inconnu du grand public puisqu'il interprétait le rôle mémorable du tyrannique Lee Woo-jin dans "Old boy" de Park Chan-wook.
"Mai Ratima" est donc son premier long-métrage. Le titre désigne une jeune femme d'origine thaïlandaise venue en Corée pour un mariage arrangé où elle est devenue le souffre-douleur de sa famille d'accueil. Alors que son beau-frère la frappe en pleine rue, un jeune homme, tout aussi perdu qu'elle, Soo-young, lui vient en aide. Ils s'enfuient ensemble et se réfugient à Séoul. Ils tombent amoureux l'un de l'autre mais la réalité va rapidement les séparer.
Surprenant et courageux choix pour un acteur dont la vie est fort probablement à 100000 mieux de celle de ses protagonistes que de traiter cette histoire dramatiquement universelle tout comme la crise économique implicitement évoquée comme la cause de cette descente aux enfers. Ce film est à l'image de ses personnages principaux: plein de défauts et néanmoins attachant. Plein de défauts parce que Yoo Ji-tae s'amuse avec des mouvements de caméra parfois inutiles ou surlignés pour mettre en exergue l'égarement, la suffocation de Mai Ratima qu'il enferme aussi souvent dans son cadre comme elle l'est dans sa réalité sans issue, sans espoir. Plein de défauts parce que le jeu des comédiens dans les premières scènes est exagéré quand il devient plus subtil quand il se concentre sur Mai Ratima et Soo-young pour lesquels le réalisateur semble vouloir nous faire partager son empathie, et il y parvient d'ailleurs la plupart du temps. Plein de défauts encore parce qu'il ne semble pas assumer la fin (pourtant réussie) pour nous livrer un générique qui offre un dénouement alternatif mais fait finalement perdre toute sa force, redoutable, à celle qui précède. Malgré cela (et finalement à cause de tout cela), Yoo Ji-Tae parvient à nous intéresser à ses deux personnages égarés qui s'accrochent l'un à l'autre, à leur dérive désespérée, à leur déchirante séparation puis descente aux enfers. Si le titre porte le nom du personnage féminin principal, ce cas particulier n'en est pas moins universel. Tragiquement. Et c'es là toute la force de ce premier film, imparfait mais dont l'universalité peut difficilement laisser indifférent.
Le jury de la critique composé de cinq journalistes a LE LOTUS AIR FRANCE - Prix de la Critique à TABOOR de Vahid VAKILIFAR (Iran)

Synopsis - Hypersensible aux ondes électromagnétiques qui l’entourent, un homme voit la température de son corps augmenter de jour en jour. Afin de se protéger, il s’est confectionné une combinaison en aluminium qu’il porte sous d’amples vêtements. Malgré son état physique, l’homme enfourche sa moto à la tombée de la nuit et rend visite à ses clients. Sa mission : désinsectiser les habitations. L’homme plonge chaque soir au coeur de la nuit, parcourant tous les recoins de cette mégapole où le temps semble arrêté, où nulle trace du tumulte de la journée ne demeure. Tout en guettant l’aube, il est confronté aux intrigues de la nuit.
Taboor (avec le film de clôture, « Piéta » de Kim Ki Duk, dont je vous parlerai également ultérieurement, Ours d’or au dernier Festival de Berlin) est sans doute le film qui a le plus décontenancé les spectateurs qui ont quitté la salle par vagues quand « The Weight », aussi sordide soit-il, curieusement n’a pas eu le même effet. Etrange société (cf ID…) dans laquelle la lenteur, l’opacité, l’hermétisme, la singularité effraient, décontenancent, découragent et suscitent plus le rejet qu’une atmosphère et des images glauques. Le premier (long) plan est d’une beauté et d’une singularité étranges et marquantes : un homme revêt une combinaison métallique dans une roulotte tapissée d’aluminium. La scène s’étire en longueur et nous laisse le temps d’appréhender la composition de l’image, d’une fascinante étrangeté, une fascinante étrangeté qui ne cessera ensuite de croître. Tout semble rare, dans ce film : les dialogues, les personnages…et même le scénario. Malgré tout, la fascination opère pour cet univers et ce personnage entre la science-fiction et une réalité métaphorique bien sûr impossible à traiter frontalement dans un pays soumis à la censure, la surveillance et l’oppression. Tout est à la fois banal et étrange, quotidien et irréel comme cette viande qui cuit longuement filmée (et qui aura fait fuir plus d’un spectateur) qui prend soudain un tout autre sens. Un film radical et « absurde » dans un pays dont l’Etat l’est lui-même au point sans doute de ne pas se reconnaître dans cet univers carcéral, répétitif, cloisonné, oppressant, dans cette société qui étouffe, déshumanise, condamne à l’isolement, au silence, à se protéger des « radiations », d’un ennemi invisible mais bel et bien là. Le temps s’étire (longs couloirs, tunnels, longs plans fixes) quand il est dicté par une force supérieure qui « irradie », invisible et redoutable, et réduit l’être humain à être cette machine silencieuse et désincarnée. Un film qui s’achève par un plan splendide d’un homme dans la lumière qui se détache de la ville et la surplombe loin de « la violence du monde extérieure » rappelant ainsi le beau discours du réalisateur avant la projection qui avait dédié le film à son père « qui a toujours su préserver sa belle nature de la violence du monde extérieur ». Un film qui ne peut laisser indifférent, une qualité en soi. Un prix de la critique prévisible pour le film visuellement le plus inventif, opaque et radical, et malin.
Prochains festivals à suivre sur mes blogs :
-Le Festival du Film Policier de Beaune (je vous en dirai prochainement davantage)
-Le Festival de Cannes
-Le Champs-Elysées Film Festival dont Inthemoodforfilmfestivals.com sera partenaire
-et…évidemment le Festival du Cinéma Américain de Deauville
Retrouvez toute l'actualité sur les 7 blogs/sites inthemood:
http://inthemoodforfilmfestivals.com , http://inthemoodlemag.com , http://inthemoodforcinema.com , http://inthemoodforcannes.com , http://inthemoodfordeauville.com , http://inthemodoforluxe.com, http://inthemoodforhotelsdeluxe.com
Pour toutes les informations sur le Festival du Film Asiatique de Deauville, retrouvez le site officiel du festival: http://deauvilleasia.com