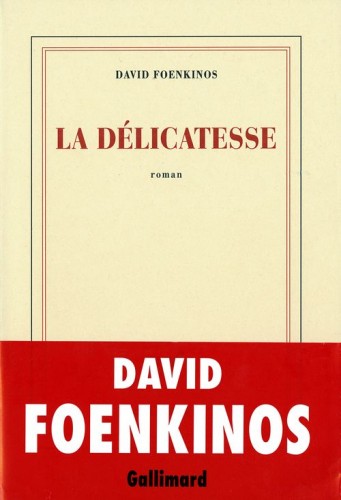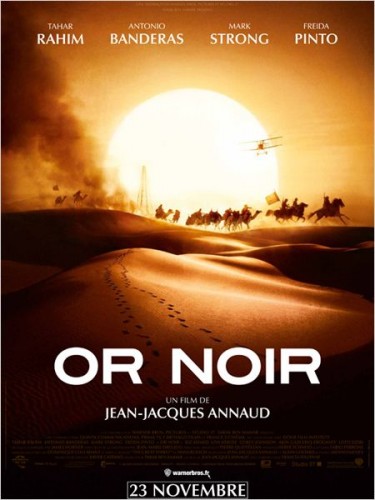Avant-première - Critique de « J.Edgar » de Clint Eastwood avec Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Judi Dench, Armie Hammer…
Clint Eastwood fait partie de ces réalisateurs dont j’essaie de ne manquer aucun film (il faut dire que, depuis 2005, il est particulièrement prolifique), en particulier depuis « Sur la route de Madison », sans aucun doute un des plus beaux films d’amour de l’histoire du cinéma (auquel je suis beaucoup plus sensible qu’à « Million dollar baby », trop larmoyant à mon goût). En 2010, avec « Au-delà » il avait déçu beaucoup de spectateurs (une déception que je ne partageais pas) alors que, pourtant, ce film était aussi, à l’image de « Sur la route de Madison », un hymne à ces instants fugaces et intenses qui modifient le cours du destin, mais aussi le message d’un homme hanté par la mort comme en témoignait aussi déjà « Gran Torino ».
«Au-delà » n’est certes certainement pas le film trépidant que certains attendaient mais au contraire un film à hauteur d’hommes qui tisse peu à peu sa toile d’émotions en même temps que les destins de ses personnages et qui laisse une trace d’autant plus profonde et aboutit à un final d’autant plus bouleversant que le cheminement pour l’atteindre a été subtil et délicat et que tout le justifiait. Une réflexion sur la mort mais surtout un hymne à la vie (au-delà de la douleur, au-delà de la perte), à l’espoir retrouvé (qui n’est pas dans l’au-delà mais dans le dépassement de son appréhension et donc bel et bien là), à la beauté troublante et surprenante du destin.
D’une certaine manière, dans « J.Edgar », Clint Eastwood réunit les thématiques des trois films évoqués ci-dessus : Gran Torino (la hantise de la mort et de la trace laissée après celle-ci), « Sur la route de Madison » (une histoire d’amour condamnée à l’ombre) et « Au-delà » (les rouages du destin).
« J.Edgar » (Leonardo DiCaprio), c’est Hoover, cet homme complexe qui fut directeur du FBI de 1924 à sa mort, en 1972, soit pendant 48 ans. 48 années pendant lesquelles il a vu se succéder pas moins de 8 présidents. L’action du film débute ainsi dans les années 70. Pour préserver son héritage. Hoover dicte alors ses mémoires et se replonge dans ses souvenirs qui le ramènent en 1919. Il n’avait alors que 20 ans, était déjà ambitieux, orgueilleux et autoritaire et on ne le nommait pas encore J.Edgar.
Dès les premiers plans, trois éléments qui ne se démentiront pas tout au long du film, sautent aux yeux du spectateur (aux miens, du moins) : la beauté sombre de la photographie de Tom Stern (fidèle chef opérateur de Clint Eastwood), l’art avec lequel Clint Eastwood s’empare du scénario de Dustin Lance Black pour entremêler passer et présent, et pour nous raconter brillamment une histoire et enfin le jeu stupéfiant et remarquable de Leonardo Di Caprio qui, bien au-delà du maquillage, devient Hoover. Au moins trois éléments qui font de ce film un bonheur cinématographique…même s’il n’est pas exempt de défauts comme certaines longueurs ou certaines scènes trop appuyées et mélodramatiques.
Derrière ce que certains nommeront peut-être classicisme, Clint Eastwood démontre une nouvelle fois son habileté à tisser la toile du récit pour dresser le portrait complexe d’un homme dont la vie était basée sur le secret (ceux qu’il dissimulait et ceux des autres qu’il utilisait notamment ceux qu’il détenait sur les hommes du pouvoir qu’il manipulait sans scrupules, ce qui explique ici sa longévité à la tête du FBI) qui aspirait à être dans la lumière mais dont l’existence était une zone d’ombre, deux contrastes que la photographie de Tom Stern reflète magnifiquement. En un plan de Hoover sur son balcon, regardant les cortèges d’investiture de Roosevelt puis de Nixon, à plusieurs années de distance, il nous montre un homme dans l’ombre qui semble n’aspirer qu’au feu des projecteurs mais qui, aussi, de son piédestal, semble néanmoins être le démiurge de la scène qui se déroule en contrebas. Tout un symbole. Celui de ses contradictions.
Si les agents du FBI aimaient se présenter comme les « gentils », la personnalité de Hoover était beaucoup plus complexe que l’image qu’il souhaitait donner de l’organisation qu’il dirigeait et de lui-même : avide de notoriété, recherchant l’admiration et l’amour de sa mère, dissimulant son homosexualité, manipulant les politiques. Pour lui « l’information, c’est le pouvoir ».
Cette personnalité complexe (et ce qui conduisit Hoover à devenir J.Edgar) nous est expliquée à travers ses relations avec trois personnes : sa mère, Annie Hoover ( Judi Dench) qui lui voyait un destin et voulait qu’il compense les échecs de son père et dont il recherchera toujours l’admiration, sa secrétaire Helen Gandy (Naomi Watts) qui lui restera toujours fidèle depuis ses débuts et même après sa mort, et son directeur adjoint Clyde Tolson (Armie Hammer) avec qui il entretint vraisemblablement une liaison.
Si l’histoire de Hoover nous permet de traverser l’Histoire des Etats-Unis, la seconde est bien en arrière-plan et c’est bien à la première que s’attache Eastwood, de son rôle dans l’instigation des méthodes modernes d’expertises médico-légales mais aussi à ses tentatives (vaines) pour faire tomber Martin Lurther King, son combat obstiné et même obsessionnel contre le communisme et évidemment la création du FBI et l’enlèvement du fils de Lindbergh, deux évènements qui témoignent de l’ambition de Hoover et de ses méthodes parfois contestables pour la satisfaire.
Le film de Clint Eastwood épouse finalement les contradictions de son personnage principal, sa complexité, et a l’intelligence de ne pas faire de Hoover un héros, prétexte à un film à la gloire des Etats-Unis mais au contraire un personnage qui en symbolise l’ombre et la lumière et surtout ce désir d’être dans la lumière (manipulation des médias mais aussi propagande avec des albums de bd consacrés au FBI et des vignettes ornant les paquets de corn-flakes) comme le revers de la médaille d’un American dream dont l’image se voudrait lisse et irréprochable.
La réussite du film doit évidemment beaucoup à celui qui incarne Hoover et qui tourne pour la première fois pour Eastwood : Di Caprio dont le maquillage n’est pour rien dans l’étonnante nouvelle métamorphose qui le fait devenir Hoover, avec sa complexité, son autorité, son orgueil, ses doutes qui passent dans son regard l’espace d’un instant, lorsque ses mots trahissent subitement son trouble et le font alors redevenir l’enfant en quête de l’amour de sa mère qu’il n’a finalement jamais cessé d’être derrière ce masque d’intransigeance et d’orgueil (très belle scène avec Noami Watts dans la bibliothèque du Congrès ou dans la suite avec Clyde, scènes au cours desquelles il passe d’une expression ou une émotion à une autre, avec une rapidité fascinante). Une nouvelle composition magistrale. Déjà dans « Shutter island », il était habité par son rôle qui, en un regard, nous plongeait dans un abîme où alternaient et se mêlaient même parfois, angoisse, doutes, suspicion, folie, désarroi (interprétation tellement différente de celle des "Noces rebelles" mais tout aussi magistrale qui témoigne de la diversité de son jeu). Il n’avait pourtant obtenu l’Oscar du meilleur acteur pour aucun de ces deux films, il ne l’a d’ailleurs jamais obtenu. Est-ce possible que celui qui est sans doute le plus grand acteur actuel passe une nouvelle fois à côté ? J’avoue que mon cœur balance sachant que Jean Dujardin sera sans doute nommé face à lui pour « The Artist ». Vous pourrez aussi le retrouver bientôt dans une nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Fitzgerald « Gatsby le magnifique » même si je vous recommande surtout la version de Jack Clayton.
En nous racontant avec une maîtrise incontestable des codes du récit l’histoire d’un homme soucieux du secret, de la trace qu’il laissera, de sa et ses mémoire(s) (et de sa subjectivité), de ses zones d’ombre, Clint Eastwood, par-delà la personnalité complexe et passionnante de Hoover traite d’un sujet particulièrement personnel (un homme qui se penche sur son passé, pétri de contradictions entre le culte du secret et l’envie d’être dans la lumière ) et universel et actuel (la manipulation des médias, le désir avide de notoriété). La marque d’un grand cinéaste. Et enfin, il permet à celui qui est le meilleur acteur actuel d’explorer une nouvelle facette de son immense talent et de trouver là un nouveau rôle, complexe et passionnant, à sa démesure et qui le mènera peut-être, enfin, à l’Oscar tant mérité.
Retrouvez également cet article sur mon blog "In the mood - Le Magazine": http://inthemoodlemag.com/2012/01/06/cinema-critique-de-j-edgar-de-clint-eastwood/
Sortie en salles : le 11 janvier