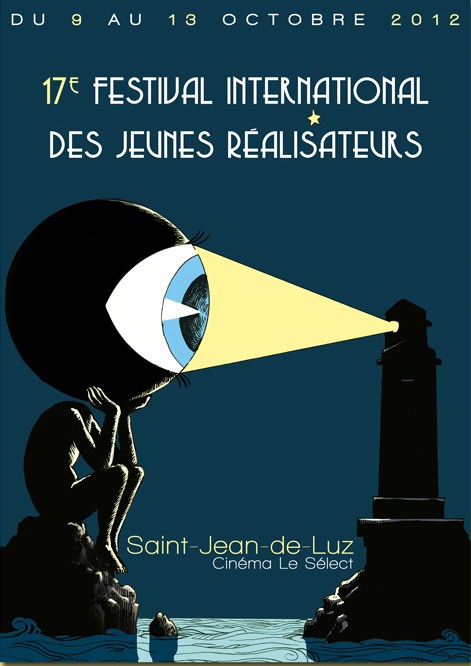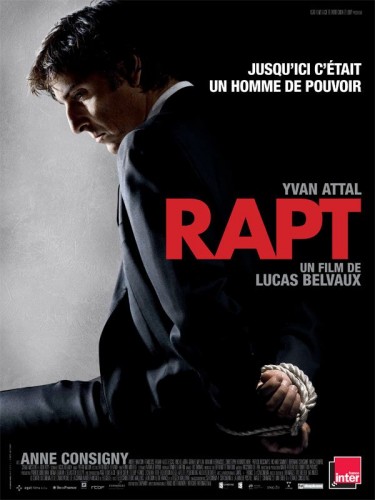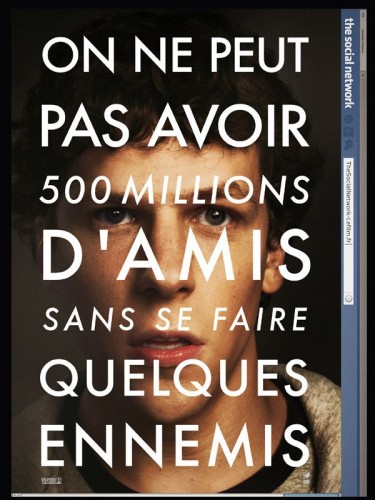Critique de "The Artist" de Michel Hazanavicius, ce 5 octobre 2012, à 20H55, sur Canal +
Photo ci-dessus : crédits inthemoodforcinema.com . Conférence de presse des lauréats du Festival de Cannes 2011.
Photo ci-dessus : crédits inthemoodforcinema.com . Conférence de presse des lauréats du Festival de Cannes 2011.
Photo ci-dessus : crédits inthemoodforcinema.com . Conférence de presse du Festival de Cannes 2011 du film "The Artist".
Photo ci-dessus : crédits inthemoodforcinema.com . Conférence de presse du Festival de Cannes 2011 du film "The Artist".
LE film à ne pas manquer ce soir, c'est "The Artist" de Michel Hazanavicius pour lequel Jean Dujardin a reçu le prix d'interprétation à Cannes et l'Oscar du meilleur acteur parmi une pluie de récompenses entièrement méritées. Retrouvez, ci-dessous, ma critique publiée suite à la projection dans le cadre du Festival de Cannes 2011.
C’était un dimanche matin de mai 2011, le début du Festival de Cannes encore, en projection presse. Pas encore vraiment l’effervescence mais un joli bruissement d’impatience parmi les regards déjà las, ou obstinément sceptiques. 1H40 plus tard, la salle résonnait d’applaudissements, pendant dix minutes, fait rare en projection presse. Le soir même, je suis retournée le voir en projection officielle. L’émotion fut la même, redoublée par la présence de l’équipe du film, terriblement émue elle aussi par les réactions enthousiastes du public, par les rires tendres, par cette cavalcade d’applaudissements qui a commencé lors de la dernière scène et ne s’est plus arrêtée pour continuer pendant un temps qui m’a paru délicieusement long. Un beau, rare et grand moment du Festival de Cannes.
Le pari était pourtant loin d’être gagné d’avance. Un film muet (ou quasiment puisqu’il y a quelques bruitages). En noir et blanc. Tourné à Hollywood. En 35 jours. Par un réalisateur qui jusque là avait excellé dans son genre, celui de la brillante reconstitution parodique, mais très éloigné de l’univers dans lequel ce film nous plonge. Il fallait beaucoup d’audace, de détermination, de patience, de passion, de confiance, et un peu de chance sans doute aussi, sans oublier le courage -et l’intuition- d’un producteur (Thomas Langmann) pour arriver à bout d’un tel projet. Le pari était déjà gagné quand le Festival de Cannes l’a sélectionné d’abord hors compétition pour le faire passer ensuite en compétition, là encore fait exceptionnel.
Le film débute à Hollywood, en 1927, date fatidique pour le cinéma puisque c’est celle de l’arrivée du parlant. George Valentin (Jean Dujardin) est une vedette du cinéma muet qui connait un succès retentissant…mais l’arrivée des films parlants va le faire passer de la lumière à l’ombre et le plonger dans l’oubli. Pendant ce temps, une jeune figurante, Peppy Miller (Bérénice Béjo) qu’il aura au départ involontairement placée dans la lumière, va voir sa carrière débuter de manière éblouissante. Le film raconte l’histoire de leurs destins croisés.
Qui aime sincèrement le cinéma ne peut pas ne pas aimer ce film qui y est un hommage permanent et éclatant. Hommage à ceux qui ont jalonné et construit son histoire, d’abord, évidemment. De Murnau à Welles, en passant par Borzage, Hazanavicius cite brillamment ceux qui l’ont ostensiblement inspiré. Hommage au burlesque aussi, avec son mélange de tendresse et de gravité, et évidemment, même s’il s’en défend, à Chaplin qui, lui aussi, lui surtout, dans « Les feux de la rampe », avait réalisé un hymne à l'art qui porte ou détruit, élève ou ravage, lorsque le public, si versatile, devient amnésique, lorsque le talent se tarit, lorsqu’il faut passer de la lumière éblouissante à l’ombre dévastatrice. Le personnage de Jean Dujardin est aussi un hommage au cinéma d’hier : un mélange de Douglas Fairbanks, Clark Gable, Rudolph Valentino, et du personnage de Charles Foster Kane (magnifiques citations de « Citizen Kane ») et Bérénice Béjo, avec le personnage de Peppy Miller est, quant à elle, un mélange de Louise Brooks, Marlène Dietrich, Joan Crawford…et nombreuses autres inoubliables stars du muet.
Le cinéma a souvent parlé de lui-même… ce qui a d’ailleurs souvent produit des chefs d’œuvre. Il y a évidemment « La comtesse aux pieds nus » de Mankiewicz, « La Nuit américaine de Truffaut », « Sunset Boulevard » de Billy Wilder, enfin « Une étoile est née » de George Cukor et encore « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen et Gene Kelly auxquels « The Artist », de par son sujet, fait évidemment penser. Désormais, parmi ces classiques, il faudra citer « The Artist » de Michel Hazanavicius. Ses précèdents films étaient d'ailleurs déjà des hommages au cinéma. On se souvient ainsi des références à "Sueurs froides" ou "La Mort aux trousses" d'Hitchcock dans "OSS 117 : Rio ne répond plus".
Hazanavicius joue ainsi constamment et doublement la mise en abyme : un film muet en noir et blanc qui nous parle du cinéma muet en noir et blanc mais aussi qui est un écho à une autre révolution que connaît actuellement le cinéma, celle du numérique.
Le mot jubilatoire semble avoir été inventé pour ce film, constamment réjouissant, vous faisant passer du rire aux larmes, ou parfois vous faisant rire et pleurer en même temps. Le scénario et la réalisation y sont pour beaucoup mais aussi la photographie (formidable travail du chef opérateur Guillaume Schiffman qui, par des nuances de gris, traduit les états d’âme de Georges Valentin), la musique envoûtante (signée Ludovic Bource, qui porte l’émotion à son paroxysme, avec quelques emprunts assumés là aussi, notamment à Bernard Herrmann) et évidemment les acteurs au premier rang desquels Jean Dujardin qui méritait amplement son prix d’interprétation (même si Sean Penn l’aurait également mérité pour « This must be the place »).
Flamboyant puis sombre et poignant, parfois les trois en même temps, il fait passer dans son regard (et par conséquent dans celui du spectateur), une foule d’émotions, de la fierté aux regrets, de l’orgueil à la tendresse, de la gaieté à la cruelle amertume de la déchéance. Il faut sans doute beaucoup de sensibilité, de recul, de lucidité et évidemment de travail et de talent pour parvenir à autant de nuances dans un même personnage (sans compter qu’il incarne aussi George Valentin à l’écran, un George Valentin volubile, excessif, démontrant le pathétique et non moins émouvant enthousiasme d’un monde qui se meurt). Il avait déjà prouvé dans « Un balcon sur la mer » de Nicole Garcia qu’il pouvait nous faire pleurer. Il confirme ici l’impressionnant éclectisme de sa palette de jeu et d'expressions de son visage.
Une des plus belles et significatives scènes est sans doute celle où il croise Peppy Miller dans un escalier, le jour du Krach de 1929. Elle monte, lui descend. A l’image de leurs carrières. Lui masque son désarroi. Elle, sa conscience de celui-ci, sans pour autant dissimuler son enthousiasme lié à sa propre réussite. Dujardin y est d’une fierté, d’une mélancolie, et d’une gaieté feinte bouleversantes, comme à bien d’autres moments du film. Et je ne prends guère de risques en lui prédisant un Oscar pour son interprétation, ou en tout cas un Oscar du meilleur film étranger pour Hazanavicius. Bérénice Béjo ne démérite pas non plus dans ce nouveau rôle de « meilleur espoir féminin » à la personnalité étincelante et généreuse, malgré un bref sursaut de vanité de son personnage. Il ne faudrait pas non plus oublier les comédiens anglo-saxons : John Goodman, Malcolm McDowell et John Cromwell (formidablement touchant dans le rôle du fidèle Clifton).
Il y aura bien quelques cyniques pour dire que ce mélodrame est plein de bons sentiments, mais Hazanicius assume justement ce mélodrame. « The Artist » est en effet aussi une très belle histoire d’amour simple et émouvante, entre Peppy et Georges mais aussi entre Georges et son cabot-in Uggy : leur duo donne lieu à des scènes tantôt drôles, tantôt poétiques, tantôt touchantes, et là encore parfois au trois en même temps. Hommage aussi à ce pouvoir magique du cinéma que de susciter des émotions si diverses et parfois contradictoires.
Michel Hazanavicius évite tous les écueils et signe là un hommage au cinéma, à sa magie étincelante, à son histoire, mais aussi et avant tout aux artistes, à leur orgueil doublé de solitude, parfois destructrice. Des artistes qu’il sublime, mais dont il montre aussi les troublantes fêlures et la noble fragilité.
Ce film m’a éblouie, amusée, émue. Parce qu’il convoque de nombreux souvenirs de cinéma. Parce qu’il est une déclaration d’amour follement belle au cinéma. Parce qu’il ressemble à tant de films du passé et à aucun autre film contemporain. Parce qu’il m’a fait ressentir cette même émotion que ces films des années 20 et 30 auxquels il rend un vibrant hommage. Parce que la réalisation est étonnamment inspirée (dans les deux sens du terme d’ailleurs puisque, en conférence de presse, Michel Hazanavicius a revendiqué son inspiration et même avoir « volé » certains cinéastes). Parce qu’il est burlesque, inventif, malin, poétique, et touchant. Parce qu’il montre les artistes dans leurs belles et poignantes contradictions et fêlures.
Il ne se rapproche d’aucun autre film primé jusqu’à présent à Cannes…et en sélectionnant cet hymne au cinéma en compétition puis en le primant, le Festival de Cannes a prouvé qu’il était avant tout le festival qui aime le cinéma, tous les cinémas, loin de la caricature d’une compétition de films d’auteurs représentant toujours le même petit cercle d’habitués dans laquelle on tend parfois à l’enfermer.
« The Artist » fait partie de ces films qui ont fait de cette édition cannoise 2011 une des meilleures de celles auxquelles j’ai assisté, pour ne pas dire la meilleure…avec des films aussi différents et marquants que « This must be the place » de Paolo Sorrentino, « Melancholia » de Lars von Trier, « La piel que habito » de Pedro Almodovar.
Un film à ne manquer sous aucun prétexte si, comme moi, vous aimez passionnément et même à la folie, le cinéma. Rarement un film aura aussi bien su en concentrer la beauté simple et magique, poignante et foudroyante. Oui, foudroyante comme la découverte de ce plaisir immense et intense que connaissent les amoureux du cinéma lorsqu’ils voient un film pour la première fois, et découvrent son pouvoir d’une magie ineffable, omniprésente ici.
Sortie en salles : le 12 octobre 2011. Vous pourrez également découvrir ce film lors de la soirée du palmarès du Festival du Cinéma Américain de Deauville, le 10 septembre…et si j’en ai la possibilité, je ne manquerai certainement pas d’y retourner une troisième fois, pour vous en livrer une critique plus précise (celle-ci étant basée sur mes souvenirs « vieux » d’il y a 4 mois).
Un dernier petit conseil : ne regardez pas la bande-annonce (dont je n’ai pas peur de dire qu’elle m’a émue, comme le film), pour conserver le plaisir de la découverte.
En bonus :
- Ma critique de « La Comtesse aux pieds nus » de Mankiewicz
-Ma critique de « OSS 117 : Rio ne répond plus » de Michel Hazanavicius