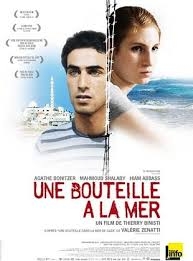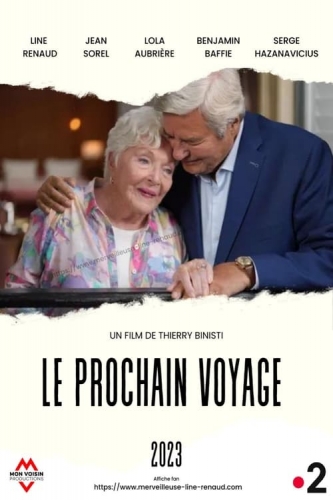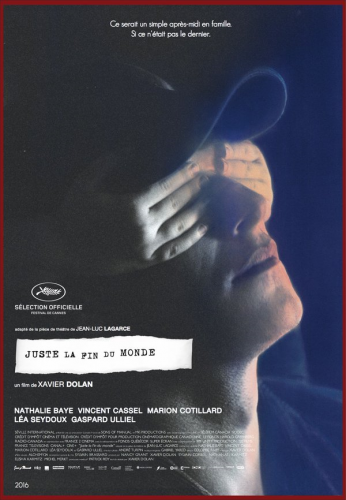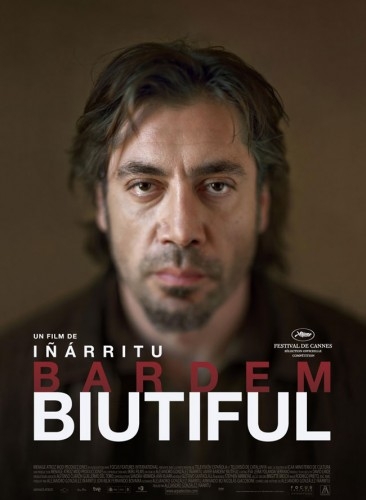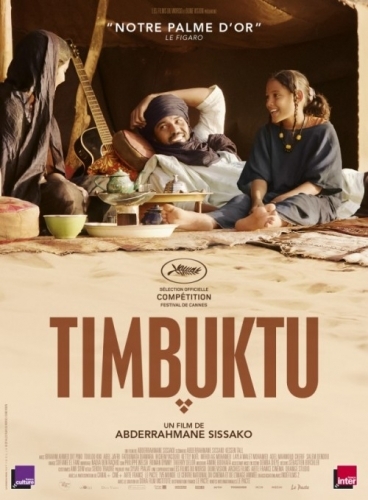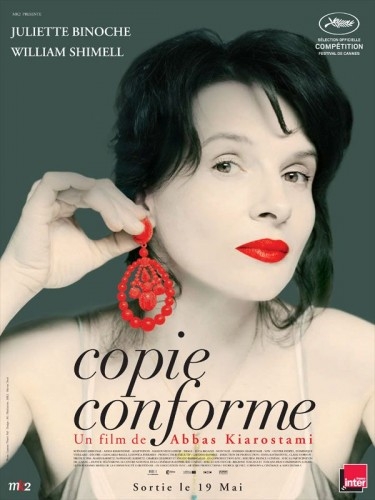Télévision – Documentaire - VOIR L’AUTOMNE, UNE SAISON EN FRANCE de Jeremy Frey (mardi 21 octobre à 21h10 sur France 2)

Que ce soit Verlaine avec sa Chanson d’automne (« Les sanglots longs Des violons De l’automne Blessent mon cœur D’une langueur Monotone… »), Camus ( « L’automne est un second printemps où chaque feuille est une fleur») ou Baudelaire (« La beauté de l’automne est un poème écrit par la nature»)…, nombreux sont les poètes et écrivains à avoir célébré cette saison plurielle et mystérieuse charriant une myriade de couleurs envoûtantes, ombrageuses et/ou éclatantes.
Voir l'automne, une saison en France. Tel est le titre du documentaire inédit de 97 minutes à découvrir dès le vendredi 17 octobre sur france.tv et le mardi 21 octobre à 21h10 sur France 2. Réalisé par Jeremy Frey, écrit par Jeremy Frey et Rémi Dupouy, il est produit par Hope Production (Yann Arthus-Bertrand…) et Calt Production.

© Hope production / Calt production
Je vous parlais hier, dans mon compte-rendu du troisième Festival de la Fiction et du Documentaire Politique de La Baule (à lire, ici), dont le palmarès a été délivré samedi dernier, du remarquable documentaire de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot, France, une histoire d’amour, à découvrir au cinéma le 5 novembre 2025, lauréat du prix des lycéens du festival. Un film dont la sublime photographie (justement signée Jeremy Frey, réalisateur de Voir l’automne) magnifie la beauté du territoire français, de ses visages et de leur générosité. Yann Arthus-Bertrand y prononce la phrase suivante, qui pourrait aussi s’appliquer à cet autre documentaire que je vous recommande aujourd’hui : « Là on va être dirigé par un dictateur sans conscience, le climat. La vie n'a aucun sens. C'est vous qui décidez de donner un sens à votre vie. On a tous la mission et le devoir de protéger la vie sur terre. J'ai passé ma vie à photographier la beauté. C'est quoi la beauté ? C'est les gens qui font, qui partagent. Cette beauté a un nom très simple. Elle s'appelle l'amour. »
En 2024, l’automne avait aussi inspiré une fiction avec François Ozon qui, dans Quand vient l’automne, filmait ainsi des personnages aux couleurs lunatiques à l'image de celles de cette saison dont il célébrait la mélancolie troublante. Un film ensorcelant et chamarré comme les couleurs automnales (photographie de Jérome Alméras), doux et cruel, savoureusement ambigu, qui célèbre autant l’automne de la vie que cette saison, et qui s’achève, comme toujours chez Ozon, par la fin logique d’un cycle, entre ambivalence et apaisement.
Ce documentaire lui rend aussi un magnifique hommage, sensoriel. C’est un hymne à cette saison et à la nature, et un vibrant plaidoyer pour sa préservation. En automne, la nature flamboie, déploie toute une palette de couleurs et d’émotions, dont le réalisateur capte ici avec une infinie sensibilité la moindre nuance et le moindre frémissement.
Synopsis : Au fil d'images insolites et grandioses, sensibles et inédites de la faune comme de la flore, une découverte de l'automne de l'intérieur, pour mieux en saisir le fonctionnement et les nuances. Des jardiniers, professeurs, pompiers, activistes, gardes forestiers, photographes amateurs ou cantonniers révèlent, à travers leurs expériences, anecdotes et récits, de multiples façons de regarder la nature. Dans des paysages hauts en couleur, ils invitent à une exploration inédite de la nature en France, à un décryptage des phénomènes qui font l'actualité en automne et à une invitation à s'émerveiller devant les temps forts et les bouleversements de cette saison si particulière. "Voir l'automne, une saison en France" nous entraîne dans un voyage sensible à travers ceux qui vivent la saison au plus près du vivant. Un couple de jeunes vignerons dont les festives vendanges marquent le début de l’automne. Un vieux berger, mémoire du Mercantour, qui transmet son savoir à sa fille en pleine transhumance. Un apnéiste qui vit une histoire avec un phoque dans le Finistère, au moment de la saison des amours. Une acousticienne qui tente de capturer la puissance du brame du cerf. Marie, jeune biologiste à Saint-Pierre-et-Miquelon, face à une baleine à bosse qui entame sa migration. Yann Arthus-Bertrand face à un chasseur à la hutte en baie de Somme. Vincent, dans les Pyrénées, photographe animalier en devenir, le seul à voir régulièrement l’ours, bientôt en hibernation.
Cela débute par des silhouettes qui s'avancent face à des images somptueuses d'automne dans la brume, comme si ces ombres nous invitaient à entrer dans l’image, à nous glisser dans le fascinant labyrinthe automnal, à nous laisser éblouir avec elles par la magie de cette saison, à pénétrer dans un conte qui narre les grandes étapes de l'automne en France, à travers les « rencontres avec ceux qui les vivent aux premières loges. » « Je crois que tu vas voir l'automne » annonce ainsi le réalisateur Jeremy Frey à Yann Arthus-Bertrand, comme s’il l’invitait lui aussi à entreprendre ce périple fabuleux grâce aux « images tournées en milieu naturel par l'équipe à cette saison ».
Dès les premiers plans, la beauté stupéfiante des images accompagnées et sublimées par la musique, lyrique et prenante, nous saisit et nous emporte. Nous voilà embarqués pour un voyage qui nous donne à voir la beauté versatile et captivante de l’automne. Chaque plan du film exhale et exalte la beauté éblouissante de la nature. Ses couleurs chatoyantes nous invitent ainsi à une danse consolante.
Une attention particulière est accordée aux sons. « Car l’automne, c’est aussi une musique. » Le réalisateur explique ainsi avoir travaillé avec « des ingénieurs du son, des acousticiens et des compositeurs pour révéler cette dimension acoustique, pour que les oreilles s’ouvrent autant que les yeux. » Et le résultat est époustouflant. Comme si nous étions un animal se faufilant dans cette nature vibrante, guidés et émerveillés par la poésie de ses bruits : le vent dans les feuilles mortes, le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles, le bruissement d’ailes ou de pattes sur les feuilles, la pluie qui rebondit et crépite sur la végétation…et même la force (d’autant plus) saisissante des silences et le rire cristallin des enfants.

© Hope production / Calt production
Dans sa note d’intention, le réalisateur explique qu’il souhaite filmer « le sauvage, réellement » et « nous réapprendre à voir l’automne, à l’écouter, à nous en émerveiller. » À cette époque insatiable, dans laquelle l’attention est constamment sollicitée, une émotion supplantée par une autre, dans une surenchère et un enchaînement harassants de bruits et d’images, ce documentaire remplit la salutaire et noble mission de nous inviter à saisir la beauté, à prendre le temps, à voir et à écouter ce qui est là, juste face à nous, et que nous ne distinguons pourtant bien souvent même plus. Ce tableau bouleversant de la nature ne le serait pas sans le regard empreint d’humanité, de sensibilité et de douceur qui se pose dessus mais aussi sans la vision de ceux qui racontent « leur » automne. L’entreprise n’est pas seulement esthétique et sensorielle mais pédagogique, aspirant à contribuer à renouer le lien entre l’homme et la nature, à redonner envie de préserver ce monde qui nous fait vivre.

© Hope production / Calt production
Ce voyage inoubliable, nous fait passer par toutes les couleurs et les émotions de l’automne, des plaines au littoral, en passant par la montagne, les marais, l’océan et les forêts, la mangrove, du mois de septembre avec ses dernières fleurs, en plaine avec les libellules, le sanglier d’Eurasie, le chevreuil d’Europe, en passant par les vignobles, la saison des amours des phoques, jusqu’à décembre avec les premières neiges dans les Alpes du Nord.
À travers les histoires de chacun, ce voyage intime et universel nous dévoile les merveilles de cette saison méconnue, pourtant essentielle pour beaucoup d’espèces. Le premier intervenant a été victime d’un accident de chasse à cause duquel il a perdu l’usage de tout son corps jusqu’au torse. Sans esprit de revanche mais animé par la bienveillance, il explore la biodiversité, apprend aux enfants à connaître les abeilles, leur explique que, à cause du frelon asiatique, la « survie de la ruche est engagée si on ne fait rien. » Ce film célèbre la diversité, la richesse et la magnificence de la vie à travers les témoignages. Les histoires à travers lesquelles l’automne est raconté humanisent la nature. Comme la bouleversante Élodie, photographe d’animaux sauvages, pour qui la nature était un refuge quand elle était harcelée à l’école : « La nature, c’était un refuge pour moi, parce que j’ai été harcelée à l’école. J’allais dans la nature pour évacuer. Dans la nature, il n’y a pas de bons ni de mauvais, il n’y a pas de juste ou d’injuste. En fait, la nature, elle est, tout simplement. » Tout concourt à souligner (sans jamais surligner, la caméra caresse l’environnement, avec respect) la puissance émotionnelle de la nature et à souligner le rôle crucial de tout ce et ceux qui la compose(nt). Il nous rappelle aussi que l’observation de la vie sauvage ne nécessite pas forcément d’aller au bout du monde.
Jeremy Frey est réalisateur de documentaires société comme 7 jours à Kigali la semaine où le Rwanda a basculé, qu’il avait coréalisé avec Mehdi Ba, dont je vous avais déjà parlé, ici. Un documentaire là aussi porté par une réalisation inspirée, élégante, sensible, respectueuse de la parole, des drames et des émotions des victimes auxquelles il rend magistralement hommage et donne une voix. Un documentaire qui nous laissait avec le souvenir glaçant de ces témoignages mais aussi le souvenir de sublimes vues (notamment aériennes) qui immortalisent la beauté vertigineuse de cette ville auréolée de lumières, malgré ses terribles cicatrices, une ville porteuse d’espoir, si lointaine et soudain si proche de nous. Grâce à la force poignante des images. Et des mots. Foudroyants. Comme le mariage improbable de la beauté et de l’horreur absolues. Jeremy Frey est aussi réalisateur de documentaires nature pour National Geographic, France Télévisions, Netflix et Arte. Il est également le directeur artistique de la série Affaires Sensibles, le réalisateur de Féminicides pour France2/Le Monde, et le fondateur des sociétés Jmage et Saola studio et enfin le directeur photo notamment sur les longs métrages de Yann Arthus-Bertrand, dont Human dont je vous avais longuement parlé, ici, qui est bien plus qu’un documentaire et un projet salutairement naïf et pharaonique. Human est en effet un voyage émotionnel d’une force redoutable (comme l'est Voir l'automne, d'ailleurs), une démonstration implacable de la réitération des erreurs de l’humanité, une radiographie saisissante du monde actuel, un plaidoyer pour la paix, pour l’écoute des blessures de la planète et de l’être humain dans toutes leurs richesses et leurs complexités, une confrontation clairvoyante, poignante au monde contemporain et à ceux qui le composent. Un documentaire nécessaire, d’une bienveillance, d’une empathie et d’une utopie salutaires quand le cynisme ou l’indifférence sont trop souvent glorifiés, et parfois aussi la cause des tourments et les ombres du monde que Human met si bien en lumière.
Avec la sensibilité et la délicatesse de son regard, qui saisit et suscite les émotions d'une manière si personnelle et universelle, avec une rare acuité, et avec la beauté éblouissante et si singulière de ses images, nous ne pouvons que souhaiter que le réalisateur de Voir l'automne, une saison en France passe à la fiction, genre qui n’est pas plus ou moins noble que le documentaire, mais auquel il apporterait certainement un supplément d’âme.
En attendant, vous l’aurez compris, je vous recommande vivement ce documentaire dans lequel, par ailleurs, l’ensemble de l’équipe qui y a contribué est sciemment et intelligemment mise en avant. Soulignons donc aussi le formidable travail de montage qui donne encore plus de vivacité, d’élan et de profondeur au film (montage signé Véronique Algan).
Un documentaire qui prend au cœur, qui nous donne la sensation de flotter comme la brume qui sinue au-dessus des arbres, ou de tournoyer comme le ballet des baleines, ou de virevolter avec les feuilles qui tombent au sol, ou d’être emportés par le vol majestueux de l’aigle royal. Comme le souligne une des intervenantes qui étudie les bruits de la nature, « On change d'échelle. On devient une fourmi. Un oiseau. » C’est aussi la sensation que procure ce documentaire au téléspectateur. Certaines images restent gravées comme la féérie mirifique des forêts qui s’embrasent. Comme ces chiens de protections de troupeaux. Comme cet « hypnotisant » iguane des petites Antilles, « L'animal du présent qui t'amène dans le passé » comme le qualifie Angeline, l’experte des mangroves, « monstre magnifique » comme le définit le réalisateur. Comme l’isard des Pyrénées et sa course folle et superbe sur les montagnes. Comme la fougue magnifique des chevaux qui galopent. Comme la « danse de la baleine ». Comme le vol des oiseaux dans la baie de Somme. Comme les contrastes entre la noirceur du ciel et la blancheur de la neige. Comme ces phoques absolument sublimes devant lesquels nous ne pouvons que partager le sentiment de Yann Arthus-Bertrand qui trouve si « émouvant de voir des animaux qui ont été exterminés revenir ici chez eux ». Rarement la biodiversité, à travers les différents témoignages et le portrait de l’automne, aura été aussi si bien célébrée.
Ce documentaire est comme une danse enivrante avec la nature. Il nous invite à valser avec elle, avec douceur, pour en éprouver la force paisible, en ressentir la respiration rassurante et fragile, vibrer à l'unisson de celle-ci. Comme un conte adressé à l’enfant qui subsiste en nous, pour réveiller son émerveillement. Il met en exergue ce que la nature recèle de plus subtil, d’infime ou grandiose. Les odeurs chantantes de l’automne. Le brasier féérique des forêts. Les trajectoires émouvantes de ceux qui traversent l’automne, femmes, hommes ou animaux. Un artifice de couleurs. Un périple étourdissant de beauté. Ours brun, salamandre, vautour fauve, baleine à bosse de l’Atlantique, chocards à bec jaune, bouquetin des Alpes…autant d’animaux (parmi de nombreux autres) qui en sont les héros admirables, filmés dans toute leur noblesse. Quelques animaux en images d’animation renforcent l’aspect poétique, et la beauté picturale de l’ensemble. La musique (elle aussi sublime), principalement la musique originale d’Anna Kova et Full Green mais aussi classique (Vivaldi…) procure encore plus de majestuosité grisante et de souffle épique au film comme s’il était la matérialisation visuelle de cette citation de George Sand : « L’automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l’hiver ». Un voyage envoûtant au cœur (battant la chamade) de l'automne. Une ode fabuleuse à la nature et à l'émerveillement. Un périple enrichissant, incontournable, pour petits et grands. Dès le vendredi 17 octobre sur france.tv et le mardi 21 octobre à 21h10 sur France 2.

("Voir l'automne" est gratuitement mis à la disposition des établissements scolaires, associations, ONG et toute initiative non commerciale pour organiser une projection, en toute autonomie. Sur le site voirlautomne.fr., vous trouverez aussi comment vous engager au quotidien (en limitant la consommation de viande, en protégeant les espèces en voie d’extinction, en limitant la chasse, en laissant un coin en friche dans votre jardin en évitant de tondre, en mangeant bio pour diminuer les pesticides si vous en avez les moyens, en plantant des haies, des arbres et des fleurs pour aider la pollinisation, en rejoignant une association de préservation de la biodiversité) et une liste d’associations.