
Cela fait 13 ans (déjà!) que j’ai eu le bonheur de faire partie du jury du Festival du Film Britannique de Dinard (retrouvez mon article publié dans le livre des 20 ans du festival « Flashback » en cliquant ici et en bas de cet article) et, depuis, à chaque fois que j’ai pu, j’y suis retournée avec grand plaisir (également en bas de cet article des liens vers mes articles sur d’autres éditions du Festival de Dinard) pour découvrir le meilleur du cinéma britannique dans un cadre sublime et convivial, malheureusement cette année, je n’ai pu être présente. Je vous livre néanmoins ci-dessous le palmarès attribué ce soir par le jury présidé par Patrick Bruel.
Le HITCHCOCK D’OR
qui comprend les prix suivants :
Le Grand Prix du Jury
Prix qui se compose d’une aide à la distribution
et d’un soutien direct au réalisateur
Le Prix Ciné+
Ciné+ s’engage à doter le film lauréat d’une promotion sur ses chaînes
lors de sa sortie en salle
Shadow Dancer de James Marsh
____________
Prix du Public Studio Ciné Live
Shadow Dancer de James Marsh
____________
Prix du Scénario Allianz
iLL MANORS de Ben Drew
____________
Prix de l’image Technicolor
Good Vibrations de Lisa Barros D’Sa & Glenn Leyburn
____________
Décerné par l’association LA REGLE DU JEU
Les films concourant pour ce prix ont déjà un distributeur en France
Distribution du film primé dans 40 salles du Grand Ouest
iLL MANORS de Ben Drew
MON ARTICLE PUBLIE DANS FLASHBACK, LE LIVRE DES 20 ANS DU FESTIVAL (pour vous convaincre de venir, au Festival du Film Britannique de Dinard, l’an prochain).

Avant 1999, Dinard représentait pour moi ce lieu délicieusement intemporel magnifié par cette incomparable couleur émeraude de la côte éponyme, exhalant un paradoxal parfum d’enfance et d’éternité, et sur lequel veillait, de son œil malicieux, la statue de mon réalisateur favori : le grand Alfred Hitchcock. En septembre 1999, je tombai sur une annonce dans un journal local annonçant un concours qui permettait de devenir membre du jury du Festival du Film Britannique. Je gardais de mon expérience dans le jury jeunes du Festival du Film de Paris, l’année précédente, un souvenir inaltérable et la féroce envie de renouveler cette expérience. Particulièrement passionnée par le cinéma britannique, le défi était d’autant plus passionnant et exaltant. Je rédigeai donc la lettre de motivation, la page exigée me semblant néanmoins bien trop courte pour exprimer mon amour inconditionnel pour le cinéma, et le cinéma britannique en particulier, et pour cette ambivalence qui en constitue la richesse et la particularité, cette influence a priori inconciliable de cinéma européen et américain ; j’exprimai mon admiration pour le réalisme social de Ken Loach ou pour celui du Free cinema, pour le lyrisme épique de David Lean, pour la sensible appréhension des atermoiements et des « ombres du cœur » de Richard Attenborough, et par-dessus tout pour « Les liaisons dangereuses » de Stephen Frears, « Les Virtuoses » de Mark Herman et pour le cinéma saisissant de vérité de Mike Leigh. Cinq jours avant le festival, on m’annonçait la bonne (et déstabilisante !) nouvelle : ma candidature avait été sélectionnée parmi plus de deux cents autres et j’allais intégrer le jury du 10ème Festival du Film Britannique de Dinard, alors présidé par Jane Birkin. Qui n’a jamais fait partie d’un jury ne peut imaginer à quel point une telle expérience est trépidante, enrichissante, singulière, à quel point elle cristallise tant d’émotions, cinématographiques et pas seulement, à quel point elle abolit la fragile frontière entre cinéma et réalité qui s’y défient et entrechoquent, nous emportant dans un troublant et ensorcelant tourbillon, suspendant le vol du temps. Alors jeune étudiante, écartelée entre mes études de cinéma et de sciences politiques, je me retrouvai dans cette réalité titubante et dans un jury avec des artistes que j’admirais (et d’autant plus désormais) comme Jane Birkin, présidente à l’empathie incomparable et à l’excentricité aussi joyeuse que nostalgique et mélancolique, Etienne Daho, Julian Barnes, Daniel Prévost et je faisais la connaissance de Tom Hollander et Mark Addy dont je constatais avec plaisir que, à l’image du festival, ils avaient tous l’humilité, l’affabilité et la simplicité des grands. Je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de les remercier, ni le festival et son directeur Hussam Hindi, pour l’accueil chaleureux qui m’a alors été réservé, ce livre me donne l’occasion de le faire aujourd’hui, dix ans après ces quatre jours hors du temps et de la réalité. Non seulement, je découvrais un festival de cinéma sous un angle différent, ses débats exaltés et exaltants mais aussi un cinéma dont je soupçonnais la richesse et l’inventivité et dont cette compétition me fit mesurer l’étendue à l’image des deux films qui partagèrent les suffrages de notre jury cette année-là : le palpitant thriller magnifiquement sombre, premier long métrage d’un certain Christopher Nolan « Following » (qui remporta le Hitchcock d’argent) qui révélait un cinéaste avec un univers d’une originalité sidérante qu’il a confirmé deux ans plus tard avec « Memento » et le déjanté et burlesque « Human Traffic » de Justin Kerrigan qui remporta le Hitchcock d’or. De mémoire de festivaliers, cette dixième édition fut la plus mémorable. En tout cas pour moi qui depuis ai été dix fois jurés dans divers festivals de cinéma et en ai parcouru de nombreux autres de Deauville à Cannes, cela reste sans aucun doute un souvenir indélébile et la cause du caractère incurable d’une triple passion dont deux étaient déjà ardentes : pour le cinéma en général, pour le cinéma britannique en particulier, et pour le Festival du Film Britannique de Dinard. J’eus alors un véritable coup de foudre pour le Festival de Dinard et si je le découvrais dans des conditions étranges et privilégiées, cette impression ne s’est jamais démentie par la suite : celle d’un festival convivial dont les festivaliers et le cinéma, et non ses organisateurs, sont les véritables stars, où la diversité du cinéma britannique s’exprime aussi dans le choix de ses invités, qui deviennent souvent des habitués (et pour cause…), et dans le choix de ceux qu’il a honorés ou révélés, et non des moindres : Danny Boyle, Peter Cattaneo, Stephen Daldry, Paul Greengrass, Peter Webber, Shane Meadows…. ! Retourner à Dinard chaque fois que j’en ai l’occasion signifie toujours pour moi une douce réminiscence de ces instants magiques ( et lorsque je ne peux pas me donne l’impression d’un rendez-vous manqué) qui ont déterminé la voie que je me suis enfin décidée à emprunter, celle de la passion irrépressible ; c’est aussi la perspective de découvrir ou redécouvrir de grands auteurs, une image de la société britannique avec tout ce qu’elle reflète de fantaisie désenchantée et enchanteresse, de pessimisme enchanté, de romantisme sombre, d’élégance triste, d’audace flegmatique et de réjouissants paradoxes et oxymores… et la perspective de jubilatoires frissons cinéphiliques . Dinard a priori si sombre et pourtant si accueillante, auréolée de sa très hitchcockienne et resplendissante noirceur facétieuse, est à l’image de ce cinéma qui possède à la fois le visage tourmenté et attendrissant de Timothy Spall et celui robuste et déterminé de Daniel Craig, un cinéma qui excelle dans les comédies romantiques (de Richard Curtis, de Mike Newell…) mais aussi dans des films ancrés dans la réalité sociale, un cinéma qui, récemment encore, à Dinard, nous a fait chavirer avec la complainte mélancolique de John Carney dans « Once » ou qui nous a ouvert les yeux sur les plaies de la société contemporaine avec le percutant « It’s a free world » de Ken Loach ou le tristement intemporel « Pierrepoint » d’Adrian Shergold, bref un cinéma éclectique qui sait concilier Histoire et contemporanéité, « raisons et sentiments », une fenêtre ouverte sur des mondes, garanties d’un avenir que je souhaite aussi lucide et radieux au Festival du Film Britannique de Dinard, incomparable antre de passions et découvertes cinématographiques qui a fait chavirer le cours de mon destin.
Before 1999, Dinard for me was a deliciously timeless place magnified by the wonderful emerald colour of its coastline, and a paradoxical odour of childhood and eternity watched over maliciously by the statue of my favourite director, the great Alfred Hitchcock.
In September 1999 I noticed a call for candidates in a local newspaper, to enter a competition which could lead to being a member of the jury of the British Film Festival. I already had wonderful memories of being one of the young jury members of the Paris Film Festival the previous year and was very keen to renew the experience. Since I am particularly interested in British cinema the challenge was even greater. So I applied thinking that the single page requested seemed far too short a space in which to express my absolute passion for film and for British films in particular as they represent a bridgehead between American and European cinema. I described my admiration for Ken Loach’s style of realism and its origins in Free Cinema. I also referred to the poetry to be found in David Lean’s films, to the prevariactions in Richard Attenborough’s « Shadowlands » but above all « Dangerous Liasions » by Stephen Frears, Mark Herman’s « Brassed Off » and for the remarkable truthfulness in Mike Leigh’s films. Five days before the festival started I received the good (and scary) news that I had been chosen out of some two hundred other applicants and was to become a member of the jury of the 10th British Film Festival of Dinard presided by Jane Birkin.
Impossible for someone who has never sat on a jury to imagine what an exciting, rewarding, exceptional experience it is and the extent to which so many emotions can be encompassed in such activity somehow banishing the fragile barrier between film and real life takiing us into a strange and betwitching whirlwind while time stood still. At the time I was torn between studying cinema and political sciences and I was staggered to find myself a part of a jury of artists I admired (even more so now) starting with the president, Jane Birkin, a person of incomparable sympathy yet full of joyful excentricity mixed with nostalgia and sadness, then there were Etienne Daho, Julian Barnes, Daniel Prévost. I came to know Tom Hollander and Mark Addy. I also discovered with pleasure that in common with all great people and like the festival itself, they shared the qualities of modesty, simplicity and friendliness. I have never really had the chance to thank either them or the Festival Director, Hussam Hindi, for the warm welcome I received. Thanks to this book, published ten years later, I am now given the opportunity to do so. Not only did I discover a film festival from a different angle with high minded and exhilarating discussions but I also discovered wider aspects to British cinema than I had expected through the films selected in competition. This is characterised by the two films singled out by the jury. « Following » a magnificient dark thriller by a certain Christopher Nolan (which was awarded the silver Hitchcock) first feature from a film maker who was soon to make his mark two years later with « Memento » and the crazy burlesque « Human Traffic » by Justin Kerrigan which was awarded the Golden Hitchcock.. This tenth edition was the most memorable one so far to the minds of regular festival goers. Since then I have served as a jury member in ten other festivals and have attended many others from Deauville to Cannes, but my special memory of Dinard will never fade because of my triple passion for cinema in general, British cinema in particular and for the Dinard Festival itself. I fell in love with this festival, which I discovered under strange and privileged conditions, and this impression has not changed since: a user-friendly festival where guests and festival goers are the real stars – not tthe organisers. The diversity of British cinema is also made apparent through the choice of the guests, many of whom, subsequently and understandably, become regulars. Also must be mentioned the judicious choices of people receiving tributes and new talents soon to become well known names: Danny Boyle, Peter Cattaneo, Stephen Daldry, Paul Greengrass, Peter Webber, Shane Meadows…. ! Going back to Dinard whenever I can always brings back the sweet memories of those magic moments (and the years I can’t attend it always seems to me that I have missed something important) and which led me to follow the course I am on today following a real passion. It is also the occasion to discover or rediscover established ‘auteurs’, a vision of British society with all it projects in the way of disenchanted yet enchanting fantasy, of pessimism, dark romanticism, sad elegance, phlegmatic daring and joyful pardoxes and oxymorons with the prospect of enjoyable film loving shivers. Dinard seems so sober yet is so welcoming, under the star of supreme film-maker Hitchcock , reflecting this cinema which has both the features of Timothy Spall (tormented and moving) and those of Daniel Craig, (rugged and determined). A cinema that excells in romantic comedies (by Richard Curtis or Mike Newell) but also in films anchored in social reality as was the case recently in Dinard with John Carney’s film « Once » or Ken Loach’s « It’s a Free World » which opened our eyes to the wounds of contemporary society.
I wish the British Film Festival of Dinard a radiant future and thank it for having dictated my destiny.
LIENS:
-mon compte-rendu du Festival du Film Britannique de Dinard 2010
-mon compte-rendu du Festival du Film Britannique de Dinard 2009
-mon compte-rendu du Festival du Film Britannique de Dinard 2007
-mon compte-rendu du Festival du Film Britannique de Dinard 2005
Site officiel du Festival: http://www.festivaldufilm-dinard.com/
Le Festival de Dinard sur Facebook: https://www.facebook.com/#!/pages/Festival-du-Film-Britan…
Programme du Festival du Film Britannique de Dinard 2012
















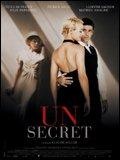
 L’ambiguïté du personnage de Maxime parcourt et enrichit tout le film : Maxime qui exhibe son corps, qui nie presque sa judaïté, qui fera dire à son père sur le ton de l’humour, certes, qu’il a un fils antisémite, à qui dans son roman Philippe Grimbert attribue des « ambitions de dandy ». L’ambiguïté est encore accrue quand il tombe amoureux de Tania : une femme blonde aux yeux bleus, sportive comme lui, et ce qui n’arrange rien, sa belle sœur, dont il tombe amoureux, pour couronner le tout, le jour de son mariage. Tania, si différente de sa femme, Hannah (Ludivive Sagnier), la timide, la mère parfaite, plus mère que femme dans le regard de Maxime, dans son regard hypnotisé par Tania, son double, celle qui lui ressemble tellement. Hanah : celle pour qui Maxime est pourtant tout. Et qui le signifiera tragiquement.
L’ambiguïté du personnage de Maxime parcourt et enrichit tout le film : Maxime qui exhibe son corps, qui nie presque sa judaïté, qui fera dire à son père sur le ton de l’humour, certes, qu’il a un fils antisémite, à qui dans son roman Philippe Grimbert attribue des « ambitions de dandy ». L’ambiguïté est encore accrue quand il tombe amoureux de Tania : une femme blonde aux yeux bleus, sportive comme lui, et ce qui n’arrange rien, sa belle sœur, dont il tombe amoureux, pour couronner le tout, le jour de son mariage. Tania, si différente de sa femme, Hannah (Ludivive Sagnier), la timide, la mère parfaite, plus mère que femme dans le regard de Maxime, dans son regard hypnotisé par Tania, son double, celle qui lui ressemble tellement. Hanah : celle pour qui Maxime est pourtant tout. Et qui le signifiera tragiquement. Passé et présent se répondent constamment en un vibrant écho. L’entrelacement de temporalités rendait d’ailleurs le roman quasiment inadaptable, selon les propres propos de Philippe Grimbert. Claude Miller y est pourtant admirablement parvenu. Echo entre le passé et le présent donc, Echo c’est aussi le nom du chien dans le roman. Celui dont la mort accidentelle fera ressurgir le passé, cette douleur ineffable intériorisée pendant tant d’années. Maxime s’effondre alors sur la mort de son chien alors qu’il avait surmonté les autres. Il s’effondre, enfin abattu par le silence meurtrier, le poids du secret et de la culpabilité.
Passé et présent se répondent constamment en un vibrant écho. L’entrelacement de temporalités rendait d’ailleurs le roman quasiment inadaptable, selon les propres propos de Philippe Grimbert. Claude Miller y est pourtant admirablement parvenu. Echo entre le passé et le présent donc, Echo c’est aussi le nom du chien dans le roman. Celui dont la mort accidentelle fera ressurgir le passé, cette douleur ineffable intériorisée pendant tant d’années. Maxime s’effondre alors sur la mort de son chien alors qu’il avait surmonté les autres. Il s’effondre, enfin abattu par le silence meurtrier, le poids du secret et de la culpabilité.