Critique- "Le bal des actrices" de Maïwenn
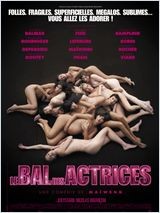 Le cinéma est à n'en pas douter un sujet très cinématographique et de nombreux réalisateurs ont déjà exploré le genre, à commencer par Blier en 2000 avec « Les acteurs » à qui Maïwenn adresse d'ailleurs un clin d'œil ou Truffaut en 1973 avec « La Nuit américaine ». Truffaut qui aimait passionnément le cinéma, au point de le trouver plus « harmonieux » que la vie. Je doute que Maïwenn aime autant le cinéma... et, après avour vu ce "bal des actrices", je me demande même si elle l'aime tout court.
Le cinéma est à n'en pas douter un sujet très cinématographique et de nombreux réalisateurs ont déjà exploré le genre, à commencer par Blier en 2000 avec « Les acteurs » à qui Maïwenn adresse d'ailleurs un clin d'œil ou Truffaut en 1973 avec « La Nuit américaine ». Truffaut qui aimait passionnément le cinéma, au point de le trouver plus « harmonieux » que la vie. Je doute que Maïwenn aime autant le cinéma... et, après avour vu ce "bal des actrices", je me demande même si elle l'aime tout court.
Synopsis : Maïwenn, vivant avec Joey Starr, décide de faire un documentaire sur les actrices. Leurs doutes, leurs espoirs, leurs névroses et leurs bassesses surtout. Ses rencontres avec les actrices (Karin Viard, Mélanie Doutey, Romane Bohringer, Marina Foïs...) sont entrecoupées de scènes de comédie musicales acidulées dans lesquelles les actrices expriment leurs rêves.
Premier plan : Maïwenn lit « Les Cahiers du cinéma » qui titrent sur le retour à un cinéma du réel. La manipulation est lancée. Cinéma du réel ? Rarement un film m'aura paru aussi artificiel que celui-ci. Comédie. Faux documentaire. Comédie musicale. En mêlant les genres son film n'appartient finalement à aucun. Dommage d'ailleurs que Maïwenn n'ait pas eu le courage d'aller au bout du faux documentaire, préférant montrer le contre-champ et se mettre en scène en train de filmer plutôt que d'aller au bout de la confusion entre cinéma et réalité.
D'une apparence « réaliste » le dispositif est finalement très commercial, à l'image de l'affiche d'ailleurs, racoleuse, laide... et de très mauvais goût (je suis visiblement la seule à qui elle fasse songer à une tragique période de l'Histoire, sans doute ai-je l'esprit mal tourné): au cas où nous n'aurions pas compris que les actrices se mettent à nu au sens figuré, il fallait bien le montrer au sens propre.
Chaque actrice interprète son petit morceau de comédie musicale. L'argument de Maïwenn pour convaincre les actrices ? Pour faire le contrepoids glamour ? Pour nous montrer qu'elle les aime ses actrices en les mettant en valeur ?
Muriel Robin rêve de rôles dramatiques, Julie Depardieu d'enfants entre deux séances jardinage. Karin Viard a un ego surdimensionné. Romane Bohringer s'invente des castings et vend son image pour Nokia contre une belle enveloppe d'argent en liquide. Karole Rocher galère. C'est plus facile que réellement cruel, chacune étant finalement mise en valeur en démontrant ainsi son humour en jouant avec son image (mention spéciale à Romane Bohringer et Estelle Lefébure pour leur justesse, aux autres on a demandé de surjouer leurs propres rôles même si Karin Viard est réjouissante dans sa propre caricature). S'il est plutôt jubilatoire de les voir se tourner en dérision, ces morceaux chantées réduisent cet effet à néant.
Le cinéma est un bal masqué, un monde de faux-semblants dans lequel les actrices sont toutes malheureuses, narcissiques, prétentieuses et pour se dédouaner de s'être attribuée le beau rôle, Maïwenn lors d'une scène finale (lors de laquelle toutes les actrices sont réunies pour voir son documentaire) devance toutes les critiques, ses actrices lui adressant les reproches que pourrait lui faire la critique.
Et puis, notez bien, si elle a fait tout ça c'est par amour. Enfin la Maïwenn du film. L'autre ? On ne sait pas très bien. Pour se montrer au-dessus de la mêlée tout en faisant croire qu'elle sait très bien qu'on lui reprochera sa prétention et son propre narcissisme signifiant ainsi qu'elle est suffisamment intelligente pour ne pas se prendre au sérieux... tout en le faisant quand même ?
En nous faisant croire qu'elle fait un film sur les masques et les mensonges des actrices, Maïwenn nous impose sa propre vérité. Son bal dont elle est la reine et la manipulatrice, très maligne certes. Quant à Joey Starr, il joue juste mais de là à le nommer aux César comme meilleur second rôle (notamment face à Poelvoorde, Arestrup ou Anglade !), j'ai cru à une mauvaise blague...
Maïwenn est indéniablement futée. Dommage que se dégage de son film un tel sentiment de supériorité (malgré tous ses efforts pour en devancer la critique). Un bal des actrices qui ne m'a pas permis d'entrer dans sa danse, finalement macabre et surtout très démagogique. Sinon...le très bon générique de fin ferait un excellent début...



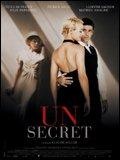
 L’ambiguïté du personnage de Maxime parcourt et enrichit tout le film : Maxime qui exhibe son corps, qui nie presque sa judaïté, qui fera dire à son père sur le ton de l’humour, certes, qu’il a un fils antisémite, à qui dans son roman Philippe Grimbert attribue des « ambitions de dandy ». L’ambiguïté est encore accrue quand il tombe amoureux de Tania : une femme blonde aux yeux bleus, sportive comme lui, et ce qui n’arrange rien, sa belle sœur, dont il tombe amoureux, pour couronner le tout, le jour de son mariage. Tania, si différente de sa femme, Hannah (Ludivive Sagnier), la timide, la mère parfaite, plus mère que femme dans le regard de Maxime, dans son regard hypnotisé par Tania, son double, celle qui lui ressemble tellement. Hanah : celle pour qui Maxime est pourtant tout. Et qui le signifiera tragiquement.
L’ambiguïté du personnage de Maxime parcourt et enrichit tout le film : Maxime qui exhibe son corps, qui nie presque sa judaïté, qui fera dire à son père sur le ton de l’humour, certes, qu’il a un fils antisémite, à qui dans son roman Philippe Grimbert attribue des « ambitions de dandy ». L’ambiguïté est encore accrue quand il tombe amoureux de Tania : une femme blonde aux yeux bleus, sportive comme lui, et ce qui n’arrange rien, sa belle sœur, dont il tombe amoureux, pour couronner le tout, le jour de son mariage. Tania, si différente de sa femme, Hannah (Ludivive Sagnier), la timide, la mère parfaite, plus mère que femme dans le regard de Maxime, dans son regard hypnotisé par Tania, son double, celle qui lui ressemble tellement. Hanah : celle pour qui Maxime est pourtant tout. Et qui le signifiera tragiquement. Passé et présent se répondent constamment en un vibrant écho. L’entrelacement de temporalités rendait d’ailleurs le roman quasiment inadaptable, selon les propres propos de Philippe Grimbert. Claude Miller y est pourtant admirablement parvenu. Echo entre le passé et le présent donc, Echo c’est aussi le nom du chien dans le roman. Celui dont la mort accidentelle fera ressurgir le passé, cette douleur ineffable intériorisée pendant tant d’années. Maxime s’effondre alors sur la mort de son chien alors qu’il avait surmonté les autres. Il s’effondre, enfin abattu par le silence meurtrier, le poids du secret et de la culpabilité.
Passé et présent se répondent constamment en un vibrant écho. L’entrelacement de temporalités rendait d’ailleurs le roman quasiment inadaptable, selon les propres propos de Philippe Grimbert. Claude Miller y est pourtant admirablement parvenu. Echo entre le passé et le présent donc, Echo c’est aussi le nom du chien dans le roman. Celui dont la mort accidentelle fera ressurgir le passé, cette douleur ineffable intériorisée pendant tant d’années. Maxime s’effondre alors sur la mort de son chien alors qu’il avait surmonté les autres. Il s’effondre, enfin abattu par le silence meurtrier, le poids du secret et de la culpabilité.