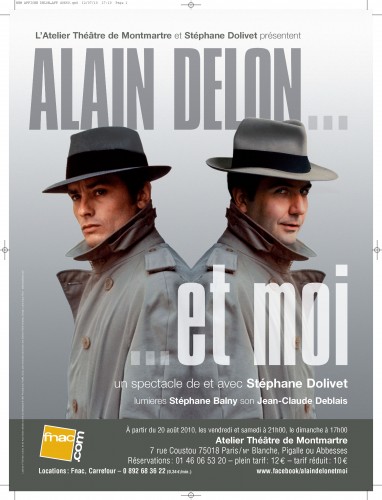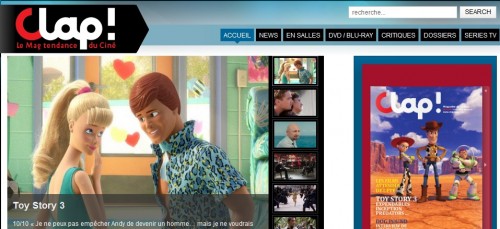Aujourd'hui sort en salles "L'Autre monde" de Gilles Marchand dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises.
Alors que le virtuel prend de plus en plus le pas sur le réel ou en tout cas fait partie intégrante de nos existences, le cinéma s'empare de plus en plus du sujet, thème d'ailleurs récurrent de ce Festival de Cannes 2010. Gilles Marchand réalise là son deuxième long après « Qui a tué Bambi » qui, comme « L'Autre monde » sélectionné hors compétition du Festival de Cannes 2010, figurait en sélection officielle du Festival de Cannes (2003). Gilles Marchand est avant tout scénariste, notamment des films de Dominik Moll dans lesquels une situation ordinaire dérapait déjà toujours vers une réalité déroutante. Déjà vers un autre monde.
L'été dans le Sud de la France. Gaspard (Grégoire Leprince-Ringuet) vient de tomber amoureux de Marion (Pauline Etienne.) Il partage son temps entre cette dernière et ses deux meilleurs amis. Mais un jour, alors qu'il se trouve avec Marion, il va tomber par hasard sur un portable égaré, celui d'Audrey (Louise Bourgoin). Les jeunes amoureux vont alors aller à un rendez-vous donné sur le portable d'Audrey. Gaspard ne peut s'empêcher d'être attiré par cette jeune femme belle, sombre et double. Gaspard découvre que sur un jeu en réseau « Black hole » Audrey est Sam. Gaspard se crée à son tour un avatar pour la rejoindre. La vie de Gaspard va alors basculer. Dans L'Autre Monde...et dans celui-ci.
L'écueil à éviter était de tomber dans le film pour jeunes ou uniquement destiné aux amateurs de jeux vidéos. Un écueil intelligemment contourné par un scénario qui mêle judicieusement l'univers réaliste et lumineux de la réalité par lequel le film commence, à celui inquiétant et sombre de l'univers virtuel dans lequel il nous plonge progressivement. Si les adultes ou du moins les personnes responsables sont peu présentes, (à l'exception du père de Marion, autoritaire et menaçant) chacun peut néanmoins s'identifier à Grégoire Leprince Ringuet qui incarne un jeune homme normal et heureux qui perd progressivement le sens des réalités.
Par un habile jeu de mise en abyme, le frère d'Audrey (Melvil Poupaud) est d'une certaine manière le double du scénariste/réalisateur et le spectateur celui de Gaspard puisque le film le plonge lui aussi dans un « autre monde » sur lequel il désire en savoir davantage et puisqu'il est lui aussi manipulé par le réalisateur/démiurge comme l'est Gaspard. Le film joue sur la tentation universelle de fuir la réalité que ce soit par le cinéma ou en s'immergeant dans un univers virtuel. Audrey/Sam symbolise à elle seule cet autre monde, celui du fantasme, et des tentations adolescentes de jouer avec son identité et avec la mort. Un monde de leurres, ici aussi troublant, fascinant que malsain. Un univers factice qui donne une illusion d'évasion et rejaillit sur la réalité. Un monde qui a pour seul loi les désirs, érotiques et/ou morbides. Que serait un monde sans morale et sans loi ? Black hole. Un trou noir.
Sans être moraliste (et heureusement), le film met en garde contre ces univers virtuels dans lesquels mourir se fait d'un simple clic et où jouer avec la vie devient un jeu enfantin. Le sens, absurde, de cette réalité virtuelle se substitue alors au sens des réalités et la mort, mot qui perd alors tout sens, devient un jeu dans la vie réelle comme dans cette scène où les amis de Garspard se placent devant des voitures lancées à vive allure.
« Black hole » c'est à la fois l'évasion et le paradis (heaven comme le tatouage que porte Audrey) mais Heaven symbolise aussi cet univers de perdition dans lequel Audrey est Sam. Un univers auquel les images d'animation procurent une beauté sombre et troublante.
Par une réalisation fluide, Gilles Marchand nous embarque nous aussi dans un autre monde, un monde de contrastes entre luminosité et noirceur, entre film réaliste et archétypes du film noir (avec sa femme fatale et ses rues sombres de rigueur), un monde dangereusement fascinant, sombre et sensuel comme cette plage noire, purgatoire où se retrouvent les morts de « Black hole ».
Louise Bourgoin est parfaite en fragile femme fatale, sensuelle et mystérieuse face à un Grégoire Leprince-Ringuet dont la douceur et la normalité semblent à tout instant pouvoir basculer, un être lumineux dont « Black hole » va révéler les zones d'ombre. Pauline Etienne est elle aussi parfaite en jeune fille enjouée et fraîche qui connaît ses premiers émois amoureux.
« L'Autre monde » est une brillante mise en abyme, un film sur le voyeurisme, la manipulation, la frontière de plus en plus étroite entre réel et virtuel qui plonge le spectateur dans un ailleurs aussi inquiétant que fascinant, un film haletant, savamment « addictif » comme « Black hole », qui nous déroute et détourne habilement de la réalité. Un film que je vous recommande vivement !
En introduction à la projection, Gilles Marchand a ainsi précisé que le rapport du joueur au jeu, à l'écran l'avait toujours intrigué : « Les choses qui se passent dans le monde virtuel me paraissent particulières à notre époque et universelles. Ce qui m'intéressait c'était d'avoir une narration fluide et un montage parallèle entre ces deux mondes. Second life a fait partie de l'inspiration. Le fait qu'il n'y ait pas de but précis dans le jeu m'intéressait. On était entre le réseau social et le jeu. Ce qui m'intéressait aussi c'était le parcours de Gaspard, son hésitation entre deux femmes, deux archétypes de femmes ».