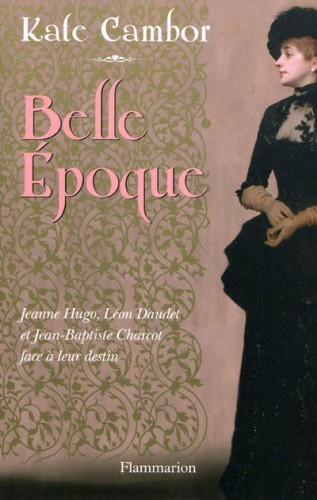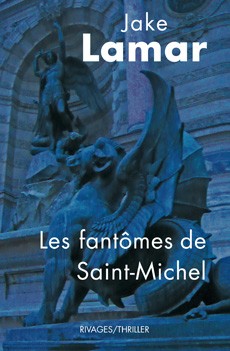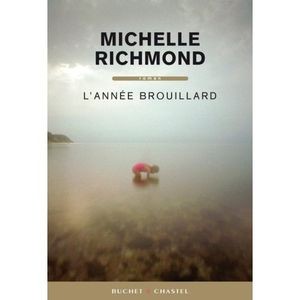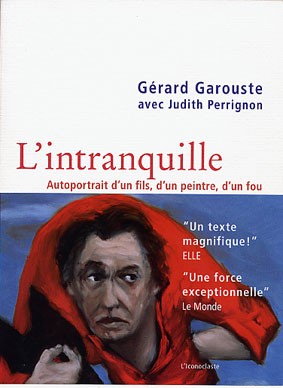« Belle Epoque » de Kate Cambor (sélection prix littéraire des lectrices de Elle 2010)
Cinquième des sept livres que je dois lire ce mois-ci pour le jury du prix littéraire des lectrices de Elle 2010, « Belle Epoque » de Kate Cambor était un premier roman particulièrement prometteur. Signée par une historienne vivant aux Etats-Unis, il ambitionnait de nous raconter la Belle Epoque à travers trois destinées et celles de ceux qu'ils ont côtoyés : le fils d'Alphonse Daudet, la petite-fille de Victor Hugo et le fils du professeur Charcot respectivement nommés Léon, Jeanne et Jean-Baptiste. Héritiers de noms illustres mais aussi de la jalousie et de l'admiration suscitées par leurs aînés. Jeanne est la seule qui n'a pas souhaité avoir de destin propre, qui a toujours revendiqué sa condition de petite-fille de Victor Hugo, ce grand-père tant admiré qui avait écrit pour elle « L'Art d'être grand-père ». Léon va vivre entre littérature, journalisme et politique et Jean-Baptiste va partir explorer les mers et continents. Ces trois jeunes gens sont très liés et ont presque grandi ensemble, vivant la même jeunesse dorée. Jeanne épousera ainsi Léon avant de divorcer pour épouser Jean-Baptiste avant... de divorcer à nouveau. En suivant les fils de leurs destinées nous croisons d'autres noms tout aussi illustres : Flaubert, Zola, Tourgueniev, Goncourt... et les grands faits de cette époque : le scandale de Panama, l'affaire Dreyfus...
Quelle ambition, certes louable, que de vouloir raconter l'histoire de la Belle Epoque. Pour la vulgariser, Kate Cambor a donc choisi trois personnages au centre des évènements qui l'ont jalonnée et qui vont voir les attentes qu'ils ont suscitées anéanties autant par « leurs propres démons » que par les évènements internationaux. Leur quête identitaire et leur envie de s'écrire une histoire va se heurter à l'Histoire, la grande, en pleine ébullition. Plus que de vivre à la Belle Epoque, ils en incarnent les espoirs et les désillusions, les réussites et les défaites, « les possibilités et les frustrations ».
Kate Chambor à force de vouloir vulgariser a peut-être trop simplifié des évènements parfois complexes, et à trop vouloir romancer donne souvent l'impression de broder sur des sentiments, des évènements, des personnalités qu'elle rend ainsi certes vivants, humains mais auxquels elle fait perdre de l'épaisseur et de la crédibilité. Plutôt que de m'immerger dans l'époque, cela n'a fait que me tenir à distance, ayant l'impression qu'elle ne cessait d'extrapoler, de prêter à ses personnages des pensées qu'ils n'ont pas forcément eues.
Quant à l'aspect historique, les évènements relatés figurent dans tous les livres d'Histoire et Kate Cambor ne nous apprend finalement pas grand-chose. En alternant entre roman et essai historique, elle a finalement fait perdre de la crédibilité et de l'intensité à l'un et à l'autre. Les incessants retours en arrière nous empêchent de suivre les histoires de Jeanne, Léon et Jean-Baptises comme celles d'un roman et les évènements historiques au lieu de les intégrer à cette Histoire donnent souvent l'impression d'être catalogués à des moments inopportuns.
Sans doute ma plus grande déception de cette sélection tant la quatrième couverture nous promettait un voyage historique alléchant mais après tout il ne s'agit que d'un premier roman avec ses faiblesses inhérentes qui a au moins le mérite de nous replonger dans cette époque palpitante jalonnée de grands bouleversements qui ont fait changer la face du monde entre grandes découvertes, grands hommes et montées des totalitarismes! Ainsi l'explique très bien Kate Cambor : «Personne mieux que Léon Daudet, Jean-Baptiste Charcot et Jeanne Hugo ne reflète les contradictions et les confusions inhérentes à cette génération. Ils ont grandi à l'époque où les voitures à chevaux circulaient dans Paris et ils sont morts alors que les avions s'emparaient du ciel. Enfants, on leur parlait d'une Europe pas si lointaine gouvernée par des rois et des conquérants corses; adultes, ils ont vu avec terreur et incrédulité des dictateurs et des assassins en chemise brune asservir un continent apeuré et docile.»