Critique de QUAND VIENT L’AUTOMNE de François Ozon (au cinéma le 2 octobre 2024)

Il faut toujours être particulièrement attentif dès les premières minutes des films de François Ozon qui sont toujours de brillants exercices d’exposition mais aussi de manipulation, éléments incontournables de ses scénarios ciselés, délicieusement retors et labyrinthiques. Ces premières minutes sont toujours annonciatrices des thématiques que chacun de ses films explore : deuil, mensonge, désir, enfoui et/ou inavoué et/ou dévorant. Avec toujours ce sens précis de la mise en scène (maligne, complice ou traîtresse), riche de mises en abyme. Dès les premières secondes, il happe l’attention et pose les fondations d’un univers dont la suite consistera bien souvent à le déconstruire. Été 85 était particulièrement symptomatique de cela. Ainsi débutait-il par le cliquetis d’une cellule qu'on ouvre, précédant la vision de deux silhouettes dans la pénombre, fantomatiques. Leur succédaient ces mots tranchants et saisissants : « Je dois être dingue. Quand on a choisi la mort comme passe-temps, c'est qu'on est dingue. […]Ce qui m'intéresse, c'est la mort. Un cadavre m'a fait un effet pas possible. Si vous n'avez pas envie de savoir comment il est devenu un cadavre alors vous n'avez qu'à laisser tomber, ce n'est pas une histoire pour vous. » Rupture de style ensuite avec des images éblouissantes de la plage du Tréport, sur fond de In Between days de The Cure. D’emblée, il mettait en scène cette dichotomie également récurrente dans ses films (ici entre ombre et lumière, désirs -de vie, amoureux- et mort qui plane), laissant présager un drame, inéluctable. L’illusion aussi : du bonheur, et celle que crée le cinéma. Un début qui rappelait celui de Frantz : les cloches d’une église qui retentissent et une silhouette fantomatique qui apparaît, furtivement, un homme de dos, courant dans la rue. Les premiers plans d’Une nouvelle amie jouent aussi avec notre perception de la réalité, et là aussi, se réfèrent à la mort, donnant l’impression qu’une femme se prépare pour une cérémonie de mariage qui est en fait son enterrement. Là aussi, un premier plan dans lequel tout est dit : le deuil, l’apparence trompeuse, l’illusion, la double identité. Mon crime, son précédent film, commence ainsi par un lever de rideau pour nous signifier que tout est scène de théâtre, jeu, mise en scène, tromperie.
Après un libre remake des Larmes Amères de Petra Von Kant de Fassbinder avec Peter Von Kant, François Ozon changeait radicalement d’univers avec cette adaptation d’une pièce de Georges Berr et Louis Verneuil de 1934, qui, dans le ton et la forme, nous rappelait davantage 8 femmes et Potiche que le précédent film du cinéaste. La fantaisie, la légèreté, la théâtralité, l’absurde, la vivacité, le jeu étaient ici à l’honneur. Les répliques fusaient comme dans les « screwball comedies » auxquelles il rendait ouvertement hommage (mêmes dialogues vifs et ton burlesque), notamment au cinéma de Lubitsch. La diversité des genres cinématographiques dans lesquels Ozon excelle est époustouflante, même si cette diversité est souvent prétexte à évoquer des thèmes récurrents évoqués plus hauts.
Ce film de 2024, plus ancré dans le réel, est cette fois un scénario original (de François Ozon, avec la collaboration de Philippe Piazzo), qui répond au titre mélancolique et poétique de Quand vient l’automne. Cependant, il ne déroge pas à la règle : la scène d’exposition, une fois encore, en dit long…
Elle nous présente Michelle (Hélène Vincent), en plein recueillement, à l’Église, une grand-mère « bien sous tous rapports », qui vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, à quelques pas de sa meilleure amie Marie-Claude (Josiane Balasko). À la Toussaint, sa fille Valérie (Ludivine Sagnier) vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas (Garlan Erlos) pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu.
Le premier quart d’heure du film est quasiment dépourvu de dialogue. Seul le tintement des cloches du village vient troubler le silence. Les films de François Ozon glorifient pourtant habituellement presque toujours le pouvoir des mots. Dans Frantz, Rilke était le poète préféré d’Anna, lui qui dans Lettres à un jeune poète, mieux que quiconque, a su définir l’art et l’amour, et les liens qui les unissent. Dans Été 85 aussi, l’écriture à nouveau permet à la vérité d’éclater et à l’amour de revivre, en tout cas une vérité, celle vue à travers le regard et les mots d’Alexis. Dans Dans la maison, Ozon rend déjà hommage au prodigieux pouvoir des mots (dans Swimming pool aussi, évidemment), à leur troublante beauté, nous donnant des pistes pour mieux nous en écarter, bref, nous manipulant tout comme l’élève y manipule son professeur par un savant jeu de mise en abyme.
Chaque année ou presque compte son nouveau film de François Ozon, à chaque fois différent et pourtant, comme nous venons de le voir, avec des « techniques » et thématiques récurrentes.
En 2001, Sous le sable, était le premier film de François Ozon sur le deuil et le refus de son acceptation. Le personnage incarné par Charlotte Rampling refusait ainsi d’accepter la mort de son mari tout comme Adrien et Anna, dans Frantz sont éprouvés par la mort de ce dernier qu’ils tentent de faire revivre à leur manière. Dans Une nouvelle amie, lorsque Claire et David révèlent leurs vraies personnalités en assumant leur féminité, travestissant la réalité, maquillant leurs désirs et leurs identités, c’est aussi pour faire face au choc dévastateur du deuil. Dans Le temps qui reste, film sur les instantanés immortels d’un mortel qui en avait plus que jamais conscience face à l’imminence de l’inéluctable dénouement, là aussi, déjà, la mort rôdait constamment.
Dans Quand vient l’automne, la mort vient aussi troubler l’apparente sérénité de cet automne en Bourgogne. Elle est d’abord évitée de peu, à cause d’un acte intentionnel ou manqué de Michelle…qui envoie sa fille à l’hôpital.
Dans le cinéma de François Ozon, les êtres ne sont jamais réellement ce qu’ils paraissent. Ils dissimulent une blessure, un secret, leur identité, un amour, une culpabilité. Ses films sont ainsi souvent à l’image de ceux dont ils relatent l’histoire : en trompe-l’œil, multiples et audacieux, derrière une linéarité et un classicisme apparent.
Manipulateur hors-pair, Ozon fait ainsi l’éloge de l’illusion et ainsi de son propre art comme dans Dans la maison dans lequel il s’amuse avec les mots faussement dérisoires ou terriblement troublants et périlleux. Jeu de doubles, de miroirs et de reflets dans la réalisation comme dans les identités sont aussi souvent à l’œuvre dans le cinéma d’Ozon. Une fois de plus, Ozon fait ici l’éloge de l’imaginaire, son pouvoir destructeur et salvateur. Il fait revenir la fille de Michelle sous forme d’un fantôme, il aide Michelle à s’accommoder avec la réalité.
Par le portrait de ces deux femmes âgées, François Ozon nous donne à voir des personnages peu souvent filmés au cinéma, des femmes à l’automne de leur vie montrées dans leur quotidien entre jardinage et promenades en forêt, loin de la nostalgie adolescente d’Eté 85. Si ce film semble plus sage et académique, il ne faut pas se fier aux apparences, et ne pas oublier le goût de la dissimulation et du trompe-l’œil d’Ozon évoqués plus haut. Ce nouveau film est délicieusement amoral, et recourt brillamment aux non-dits et au hors-champ, brouillant les frontières entre le bien et le mal, comme dans un Chabrol ou un Simenon.
Ozon, une fois de plus, joue et jongle en effet avec les genres cinématographiques et les références, et avec le mensonge. Dans Mon Crime, Madeleine, en s’accusant d’un crime qu’elle aurait commis dans un acte de légitime défense, devenait ainsi célèbre et admiré de tous. Son crime devenait sa gloire, sa carte de visite, son fait d’arme, son passeport pour la célébrité.
Ozon a surtout le don, même en la filmant dans sa quotidienneté, de magnifier la vie. Comme ici, le temps d’une danse sur Aimons-nous vivants de François Valéry. Dans Frantz, il fallait tout le talent du cinéaste pour, avec Le Suicidé (1877), le magnifiquement sinistre tableau de Manet, nous donner ainsi envie d’embrasser la vie. Dans Mon crime, en théâtralisant à merveille, il nous donnait envie d'appréhender la vie comme un jeu, un mensonge, ou un crime…savoureux et toujours (faussement) innocents.
Ce Quand vient l’automne vaut avant tout par ses personnages troubles et troublants, aux couleurs lunatiques comme celles de l’automne (comme Vincent le fils de Marie-Claude qui sort de prison et dont on sait seulement « qu’il a fait des bêtises », incarné par Pierre Lottin, inquiétant, écorché vif), mais aussi pour l’atmosphère automnale, faussement douce. Une fois de plus dans un film d'Ozon, le mensonge est à l’honneur, celui que Michelle se fait à elle-même pour supporter la vérité, pour survivre. Hélène Vincent est magistrale. Dans ses gestes et ses silences, elle exprime l’ambiguïté fascinante de son personnage, captivante, entre dureté et tendresse (quand elle s’occupe de son petit-fils adoré), rassurante et légèrement inquiétante. Sophie Guillemin, dans le rôle de la capitaine, dégage aussi une grande douceur, et ses regards sont d’une impressionnante intensité.
Si les films d’Ozon sont en apparence très différents, ils se répondent tous plus ou moins. Ainsi, la présence de Ludivine Sagnier est à nouveau fantomatique comme dans Swimming pool, vingt ans plus tôt. Le film est vu du point de vue de Michelle comme il l’était de celui de Sarah Morton (Charlotte Rampling) dans cet autre film. L’un sublime la langueur torride de l’été, l’autre la mélancolie troublante de l’automne. Contraste des saisons mais aussi de la jeunesse et de la vieillesse. Même étrangeté douce et effrayante aussi qui provoque la tension psychologique. On retrouve aussi l’idée d’amitié qui était déjà présente dans Mon crime dans lequel les deux jeunes filles s’entraidaient. Ici Michelle et Marie-Claude sont comme deux sœurs.
Ce sentiment de tension est renforcé par la musique atmosphérique (thème au piano) de Sacha et Evgueni Galperine. Un film ensorcelant et chamarré comme les couleurs de l’automne (magnifique photographie de Jérome Alméras), doux et cruel, savoureusement ambigu, qui célèbre autant l’automne de la vie que cette saison et qui s’achève, comme toujours chez Ozon, par la fin logique d’un cycle, entre trouble et apaisement. Passionnant de la première à la dernière minute.



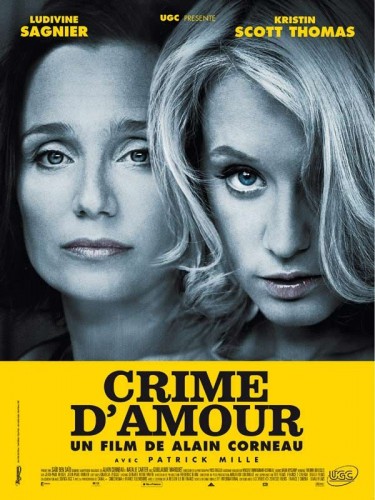


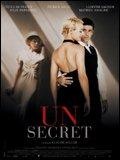
 L’ambiguïté du personnage de Maxime parcourt et enrichit tout le film : Maxime qui exhibe son corps, qui nie presque sa judaïté, qui fera dire à son père sur le ton de l’humour, certes, qu’il a un fils antisémite, à qui dans son roman Philippe Grimbert attribue des « ambitions de dandy ». L’ambiguïté est encore accrue quand il tombe amoureux de Tania : une femme blonde aux yeux bleus, sportive comme lui, et ce qui n’arrange rien, sa belle sœur, dont il tombe amoureux, pour couronner le tout, le jour de son mariage. Tania, si différente de sa femme, Hannah (Ludivive Sagnier), la timide, la mère parfaite, plus mère que femme dans le regard de Maxime, dans son regard hypnotisé par Tania, son double, celle qui lui ressemble tellement. Hanah : celle pour qui Maxime est pourtant tout. Et qui le signifiera tragiquement.
L’ambiguïté du personnage de Maxime parcourt et enrichit tout le film : Maxime qui exhibe son corps, qui nie presque sa judaïté, qui fera dire à son père sur le ton de l’humour, certes, qu’il a un fils antisémite, à qui dans son roman Philippe Grimbert attribue des « ambitions de dandy ». L’ambiguïté est encore accrue quand il tombe amoureux de Tania : une femme blonde aux yeux bleus, sportive comme lui, et ce qui n’arrange rien, sa belle sœur, dont il tombe amoureux, pour couronner le tout, le jour de son mariage. Tania, si différente de sa femme, Hannah (Ludivive Sagnier), la timide, la mère parfaite, plus mère que femme dans le regard de Maxime, dans son regard hypnotisé par Tania, son double, celle qui lui ressemble tellement. Hanah : celle pour qui Maxime est pourtant tout. Et qui le signifiera tragiquement. Passé et présent se répondent constamment en un vibrant écho. L’entrelacement de temporalités rendait d’ailleurs le roman quasiment inadaptable, selon les propres propos de Philippe Grimbert. Claude Miller y est pourtant admirablement parvenu. Echo entre le passé et le présent donc, Echo c’est aussi le nom du chien dans le roman. Celui dont la mort accidentelle fera ressurgir le passé, cette douleur ineffable intériorisée pendant tant d’années. Maxime s’effondre alors sur la mort de son chien alors qu’il avait surmonté les autres. Il s’effondre, enfin abattu par le silence meurtrier, le poids du secret et de la culpabilité.
Passé et présent se répondent constamment en un vibrant écho. L’entrelacement de temporalités rendait d’ailleurs le roman quasiment inadaptable, selon les propres propos de Philippe Grimbert. Claude Miller y est pourtant admirablement parvenu. Echo entre le passé et le présent donc, Echo c’est aussi le nom du chien dans le roman. Celui dont la mort accidentelle fera ressurgir le passé, cette douleur ineffable intériorisée pendant tant d’années. Maxime s’effondre alors sur la mort de son chien alors qu’il avait surmonté les autres. Il s’effondre, enfin abattu par le silence meurtrier, le poids du secret et de la culpabilité.