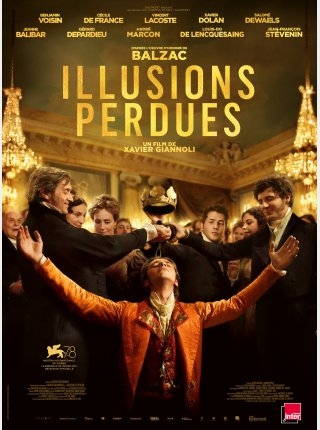Critique de AMANTS de Nicole Garcia

Amants est le neuvième long métrage de Nicole Garcia. L'idée du scénario vient du scénariste Jacques Fieschi avec qui elle collabore ici pour la neuvième fois. Je vous explique pourquoi il faut le voir avec quelques digressions sur d’autres films de Nicole Garcia que vous pouvez actuellement (re)voir à la Cinémathèque Française qui lui consacre une rétrospective jusqu’au 26 novembre.
Pour son précédent film, Mal de pierres (2016), Nicole Garcia se penchait sur les méandres de la mémoire et sur la complexité de l’identité comme c’était déjà le cas dans le non moins passionnant Un balcon sur la mer. Nicole Garcia est une des rares cinéastes à savoir raconter des « histoires simples » qui révèlent subtilement la complexité des « choses de la vie ». L’écriture du scénariste de Claude Sautet n’y est certainement pas étrangère. Rarement un film avait aussi bien saisi la force créatrice et ardente des sentiments, les affres de l’illusion amoureuse et de la quête d’absolu que Mal de pierres. Un film qui sublime les pouvoirs magiques et terribles de l’imaginaire qui portent et dévorent, comme un hommage au cinéma. Un grand film romantique et romanesque. La caméra délicate et sensuelle de Nicole Garcia a su mieux que nulle autre transcender la beauté âpre de cette femme libre que Marion Cotillard incarne, intensément et follement vibrante de vie. La Barcarolle de juin de Tchaïkovsky et ce plan à la John Ford qui, de la grange où se cache Gabrielle, dans l’ombre, ouvre sur l’horizon, la lumière, l’imaginaire, parmi tant d’autres images, nous accompagnent bien longtemps après avoir vu ce film enfiévré. Un plan qui ouvre sur un horizon d’espoirs à l’image de ces derniers mots où la pierre, alors, ne symbolise plus un mal mais un avenir rayonnant, accompagné d’un regard qui, enfin, se pose et se porte au bon endroit. Un très grand film d’amour(s).
Le fascinant premier plan d’Amants pourrait presque entrer en résonance avec celui-ci dont il est l’opposé : la caméra zoome sur deux corps entrelacés qui ne font qu’un, plongés dans le sommeil et l’obscurité. Des corps d’êtres endormis qui pourraient aussi être des corps sans vie…La tragédie est déjà annoncée, tapie dans l’ombre. Ces corps, ce sont ceux de Lisa (Stacy Martin) et Simon (Pierre Niney) qui s’aiment passionnément depuis leur adolescence. Simon subvient à leurs besoins en vendant de la drogue. Lisa suit une formation dans une prestigieuse école hôtelière. Un jour, alors que Simon se trouve avec Lisa chez un de ses « clients », celui-ci décède suite à une prise de drogue. Simon décide de fuir. Lisa l’attend en vain. Ils se retrouveront trois ans plus tard, en plein Océan Indien. Lisa est désormais mariée à Léo (Benoît Magimel)…
Trois actes. Trois lieux (Paris. Océan Indien. Genève). Trois personnages. Trois solitudes. Trois périodes. Trois mouvements. Comme dans Mal de pierres, ce sont trois personnages blessés, trois fauves fascinants et égarés, mystérieux, soumis aux tumultes de l’existence, aux affres de la passion. Comme dans Mal de pierres, dans ce triangle amoureux, il y a forcément quelqu’un de trop. Même si les films de Nicole Garcia sont toujours teintés de noirceur, ici on lorgne davantage encore vers le thriller. Comme toujours aussi, les personnages sont confrontés à leur passé.
Ce matin, je vous parlais de l’empathie avec laquelle Xavier Beauvois filme et regarde ses personnages dans Albatros. Même si leurs cinémas sont très différents, je pourrais dire la même chose de la manière dont Nicole Garcia considère ses personnages à la différence près qu’ils sont d’abord a priori antipathiques et que les failles n’apparaissent que peu à peu. Même Léo, cet homme d’affaires énigmatique, taciturne, glacial, dominateur, brutal même, porte en lui des failles ineffables qui l’humanisent. Il fallait le charisme de Benoît Magimel pour procurer toute cette ambiguïté à ce personnage, pour instiller de la fragilité dans la carapace glaciale de cet inquiétant personnage dont on ne connaît rien du passé et dont le présent reste trouble. C’est d’ailleurs dans l’ombre qu’il apparaît la première fois et son visage est ensuite filmé à demi plongé dans l’obscurité. Dans Selon Charlie, Nicole Garcia filmait des hommes perdus, à un carrefour de leurs existences, au bord de l’Atlantique, hors saison. Trois jours, sept personnages, sept vies en mouvement, en quête d’elles-mêmes, qui se croisent, se ratent, se frôlent, se percutent et qui, en se quittant, ne seront plus jamais les mêmes. Tous ces personnages ont un désir de fuite, de changement, tous sont des «hommes de solitude» comme ce squelette que le chercheur étudie, ainsi le qualifie-t-il en tout cas. Benoît Magimel était là aussi magistral dans ce rôle de professeur de biologie ayant abandonné ses rêves en même temps que sa carrière de chercheur. Progressivement, la fragilité de ces hommes va affleurer et, ainsi, d’abord antipathiques, ils vont peu à peu susciter notre intérêt. C’est à nouveau le cas du personnage de Magimel ici, des trois personnages d’ailleurs, tous ambivalents, et peut-être les miroirs les uns des autres (Léo pourrait ainsi être un Simon plus âgé...surtout que les sources de sa fortune demeurent floues, et un personnage dira à Simon et Lisa qu'ils pourraient être frères et sœurs).
Stacy Martin est elle aussi parfaite en jeune femme évanescente, perdue, mélancolique, absente, détachée, ballotée par l’existence, comme son père (militaire) dont la solitude fait écho à la sienne. Elle représente une version de la femme fatale comme en contient tout film noir. Pierre Niney incarne un Simon fiévreux, ombrageux, fébrile, romantique (l’épris d’absolu qu’incarnait Marion Cotillard-Gabrielle dans Mal de pierres, ici, ce serait finalement lui), à nouveau remarquablement juste, comme dans son précédent film, Boîte noire, qui dresse le portrait d’un homme face à ses contradictions, ses failles, ses rêves brisés (les siens ou ceux que son père avait forgés pour lui) qui veut tout contrôler et qui semble perdre progressivement le contact avec la réalité. Ainsi, au cinéma, a-t-il déjà notamment interprété un personnage lunaire, un pompier, un idéaliste, un menteur, un artiste timide, ou le violoniste Frantz dans le film éponyme de François Ozon, véritable poème mélancolique, toujours avec le même souci du détail et la même crédibilité.
Nicole Garcia confronte, comme souvent dans son cinéma, les sentiments à l’argent. La mise en scène est sobre et élégante au service de cette histoire et des acteurs. Même les lieux censés être paradisiaques paraissent déshumanisés, des prisons froides qui portent en elles le poids de la fatalité. En filigrane, Nicole Garcia se penche sur l’enfance, ce qu’il reste de ses élans, sur les méandres et la complexité de l’identité qui étaient au centre d'Un balcon sur la mer, un film à l’image de la lumière du sud dont il est baigné, d’abord éblouissante puis laissant entrevoir la mélancolie et la profondeur, plus ombrageuse, derrière cette luminosité éclatante, laissant entrevoir aussi ce qui était injustement resté dans l’ombre, d’une beauté a priori moins étincelante mais plus profonde et poignante. A l’image de la mémoire fragmentaire et sélective de Marc (Jean Dujardin), le passé et la vérité apparaissent par petites touches, laissant sur le côté ce qui devient secondaire. Un subtil thriller sentimental au parfum doux, violent et enivrant des souvenirs d’enfance.
À nouveau, dans Amants, la caméra de Nicole Garcia sait caresser les corps, exhaler leur beauté brute comme celui de Gabrielle dans Mal de pierres pour qui l’amour est d’ailleurs un art, un rêve qui se construit. Elle ne voit plus, derrière la beauté ténébreuse d’André Sauvage (Louis Garrel), son teint blafard, ses gestes douloureux, la mort en masque sur son visage, ses sourires harassés de souffrance. Elle ne voit qu’un mystère dans lequel elle projette ses fantasmes d’un amour fou et partagé.
Une fois de plus, dans Amants, comme dans les précédentes collaborations de Nicole Garcia avec Jacques Fieschi, l’écriture est ciselée et l’habileté à déshabiller les âmes et à éclairer leurs tourments est soulignée par une construction scénaristique parfaite qui sait faire aller crescendo l’émotion sans non plus jamais la forcer. Nicole Garcia fait partie de ces cinéastes dont j’ai aimé tous les films sans exception, chacun étant la marque du regard aiguisé qu’elle porte sur ses personnages, celui d’une actrice au grand talent, même lorsqu’elle a un rôle secondaire comme dans le formidable Celle que vous croyez de Safy Nebbou dans lequel elle incarne une psychiatre dont le retrait et la distance apparents se fragilisent peu à peu quand son empathie envers la patiente que joue Juliette Binoche l’emporte sur la frontière professionnelle qui se fissure progressivement. Je me souviens encore de sa réplique, « vous seriez surprise par ce qui me passe par la tête », et de l’intonation avec laquelle elle la prononce, entre fougue et retenue.
Amants est un film noir, sensuel et envoûtant, romantique et sombre, porté par de les notes de Grégoire Hetzel et la photographie de Christophe Beaucarne, froides comme le métal…ou l’argent. Ce dernier plan de Lisa perdue au milieu de la foule, nous suggère paradoxalement qu’elle s’est peut-être enfin trouvée, qu’elle fait face. Un film à l’image de la réalisation et de ses trois personnages principaux : au charme vénéneux, mystérieux et intense. Passionnants.