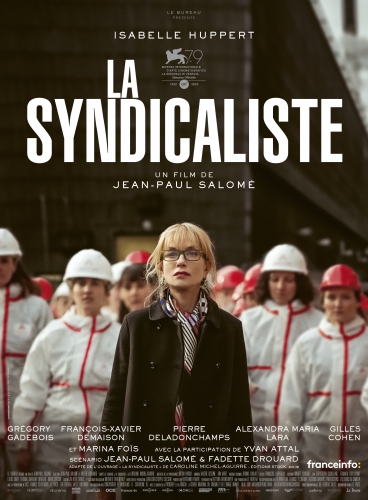Critique - LE FIL de Daniel Auteuil

La sortie en VOD du dernier film en tant que réalisateur de Daniel Auteuil est pour moi l'occasion de vous parler à nouveau de ce long-métrage qui m'avait tant marquée lors de sa projection en séance spéciale, dans le cadre du Festival de Cannes 2024.
Il y a des films comme cela, rares, qui capt(ur)ent votre attention dès la première seconde pour ne plus la lâcher, vous tenant en haleine jusqu’au dernier plan, lequel vous laisse sidérés, ne souhaitant dès lors qu’une chose : le revoir, pour en saisir la moindre nuance, pour décortiquer la moindre pièce du puzzle, pour déceler un indice qui nous aurait échappé. Le fil est de ceux-là. Les films de procès sont pourtant nombreux, et il devient de plus en plus difficile d’innover et de surprendre en la matière. Le film de Daniel Auteuil y parvient pourtant magistralement. Plus qu’un film de procès, Le Fil est la dissection de la quête de la vérité et de l’intime conviction. Il brosse le portrait de deux hommes que tout oppose en apparence, si ce n'est, peut-être, une quête de reconnaissance ou du moins de considération.
Le titre se réfère au seul élément de preuve qui pourrait aboutir à la condamnation du suspect, un fil de sa veste retrouvé sous l’ongle de la victime, une veste qu’il avait dit ne pas avoir portée le soir du crime.
Cela commence par des plans de tribunal auxquels succèdent ceux d’un paysage nimbé de lumière qui défile sur une musique entêtante, des notes pressées, impatientes même, qui coulent, ironisent peut-être. Puis, des enfants sur une balançoire. Le père qui les appelle à table. Le confort est spartiate, il ne semble pas faire très chaud dans la maison, mais le père s’occupe d’eux. On frappe à la porte. On lui annonce qu’il est placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de son épouse. Le père s’inquiète d’abord pour ses enfants : « Je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. » On retrouve ensuite Maître Monier (Daniel Auteuil) avec son épouse, la rudesse qui émane de la scène précédente contraste avec la chaleur et la douceur qui les unissent. Complices, ils parlent d’un tableau venant de leur première année de mariage.
Depuis qu’il a fait innocenter un meurtrier récidiviste, quinze ans auparavant, Maître Jean Monier ne prend plus de dossiers criminels. Ce soir-là, Maître Annie Debret (Sidse Babett Knudsen), son épouse, est appelée comme avocat commis d’office. Fatiguée, elle l’implore de la remplacer : « Tu vas faire la garde à vue et je récupère l'affaire demain ». Il accepte. Il rencontre alors Nicolas Milik (Grégory Gadebois), père de famille accusé du meurtre de sa femme qui lui raconte que cette dernière avait bu comme cela lui arrivait souvent, qu’ils se sont disputés, qu’elle a voulu le mettre dehors et a essayé de le frapper puis qu’elle est sortie. Touché par cet homme, il décide de le défendre. Convaincu de l’innocence de son client (« Pas de casier, ni un coupable crédible, ni un innocent évident, dit-il d’abord), il est prêt à tout pour lui faire gagner son procès aux assises, retrouvant ainsi le sens de sa vocation.
La fille de Daniel Auteuil, Nelly Auteuil, qui produit le film avec Hugo Gélin (producteur mais aussi réalisateur des formidables Comme des frères, Demain tout commence, Mon Inconnue etc), a fait découvrir à l’acteur le blog que tenait un avocat aujourd’hui disparu, Jean-Yves Moyart, sous le pseudo de Maître Mô. C’est une des affaires qu’il relatait sur ce blog qui a inspiré le film.
Le village, le bureau de l’avocat, le bar, les rues (vides souvent) … : le décor dépouillé permet de mettre en avant la force des mots et des silences, la puissance des visages et des gestes. Le spectateur se met alors à la place des jurés confrontés aux doutes face à la force de conviction de l’avocat.
Nicolas Milik est apparemment un homme simple, qui ne boit pas, s’occupe de ses enfants qui l’aiment visiblement en retour. En apparence, il est une sorte de grand enfant désemparé, maladroit avec le langage et avec ses gestes, que personne ne semble avoir vraiment considéré, regardé ou écouté, à part son ami Roger (remarquable Gaëtan Roussel) qui le houspille pourtant sans vraiment le ménager. Le visage, le corps tout entier, les silences de Grégory Gadebois expriment tout cela avec maestria, ce mélange de rugosité et de tendresse bourrue. Il nous embarque alors dans sa vérité.
Auteuil est lui aussi, une fois de plus, magistral, dans le rôle de cet avocat fragilisé, nerveux, que l’on sent pétri d’humanité, qui reprend vie et confiance en défendant son client (en pensant même le « sauver »), aveuglé en toute bonne foi, avec l’envie ardente de ceux qui veulent se bercer d’illusions pour tenter d’affronter la réalité et les noirceurs de l’âme humaine : « Je suis certain de son innocence. Rien dans son dossier n'indique le contraire. », « Il était un bon père. Il ne voulait que du bien à ses enfants. Rendez-vous ce père à ses enfants. »
Autour d’eux, une pléiade d’acteurs aussi remarquables : Alice Belaïdi, convaincante dans le rôle de l’avocate générale persuadée de la culpabilité de l’accusé, Gaëtan Roussel dont on ne voit pas qu’il fait là ses débuts au cinéma tant il est crédible dans ce rôle de patron de bar acerbe et antipathique, et la formidable Sidse Babett Knudsen toujours à fleur d’émotions (dans L’Hermine de Christian Vincent, notamment, elle était irrésistiblement lumineuse).
Avec ce sixième film en tant que réalisateur (La fille du puisatier, et la « trilogie marseillaise de Pagnol », César, Marius, Fanny – au passage beau cinéma populaire d’un romantisme sombre illuminé par la lumière du sud aussi incandescente que les deux acteurs principaux, par l’amour immodéré de Daniel Auteuil pour les mots de Pagnol, pour ses personnages et ses acteurs, et Amoureux de ma femme), Daniel Auteuil prouve qu’il n’est pas seulement un de nos plus grands acteurs si ce n’est le plus grand – je crois que je vous ai assez dit à quel point le personnage de Stéphane qu’il incarne dans Un cœur en hiver, chef-d'œuvre de Claude Sautet est un des plus riches, fascinants, complexes de l’histoire du cinéma- et pour moi un grand auteur, poète et chanteur, ( si vous en doutez, écoutez ces chansons sublimes que sont Si vous m’aviez connu …-paroles de Daniel Auteuil et musique d’un certain… Gaëtan Roussel-, et toutes les autres de l’album éponyme) mais aussi un cinéaste digne de ce nom.
La photographie de Jean-François Hensgens éclaire et sonde au plus près les fragilités et les doutes de chacun, et nous plonge dans l'obscurité de ce tribunal (l'intrigue se déroule pourtant dans une région solaire, la Camargue, le contraste est d'autant plus frappant). La caméra scrute le moindre frémissement, le moindre vacillement.
La musique est judicieusement à l’unisson des émotions de l’avocat, par exemple elle s’emballe en même temps qu’il retrouve l’énergie et l’envie quand il sort de la gendarmerie nationale et décide de défendre Milik, mais parfois des notes de piano lancinantes viennent instiller le doute. Le violoncelliste Gaspar Claus, pour ce film, a composé trois nouvelles compositions avec son violoncelle dont une variation autour de Bach avec également une pièce de piano de Johann Sebastian Bach Prélude en Do mineur qui rappelle un autre film récent de procès.
Je crois que la scène finale restera à jamais gravée dans ma mémoire, cette estocade après la corrida, le coup mortel (une allégorie qui parcourt le film), quand l’avocat revient voir son client en prison, que ce dernier le salue comme un bon copain, que son visage se reflète dans la vitre qui les sépare, symbole de cette terrible dualité que des mots effroyables vont transcrire, d’autant plus effroyables qu’ils sont prononcés avec une indécente innocence (et alors, on se souvient, abasourdis, que tout cela est inspiré d’une histoire vraie). Une fin aussi magistrale, sidérante, aiguisée, que glaçante et bouleversante qui révèle les méandres insoupçonnés et terrifiants de l’âme humaine et qui nous laisse comme celle de Garde à vue de Claude Miller : assommés. Un film captivant porté par une réalisation maligne et des comédiens au sommet de leur art.