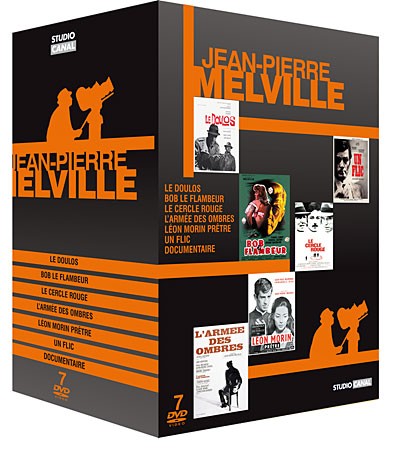Avant-première d'Harry Potter 7 à Tours, le 22 novembre
Je vous annonçais, ici, dès hier, le nom de la ville lauréate, Tours, qui accueillera l'avant-première française officielle d"Harry Potter et les reliques de la mort", 1ère partie, tandis que, ce soir, aura lieu l'avant-première mondiale à Londres. Je vous précise donc aujourd'hui que cette avant-première à Tours aura lieu le lundi 22 novembre. Cette avant-première aura lieu en présence des acteurs suivants: James et Oliver Phelps (les Jumeaux Weasley), Matthew Lewis (Neville Londubat), Mark Williams (Arthur Weasley), Clémence Poesy (Fleur Delacour), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Warwick Davis (Gripsec). Le lieu précis est encore à confirmer. Je vous en informerai. Retrouvez ma critique de "Harry Potter et les reliques de la mort-1ère partie- en cliquant ici et ma critique d' "Harry Potter et le prince de sang-mêlé" de David Yates.