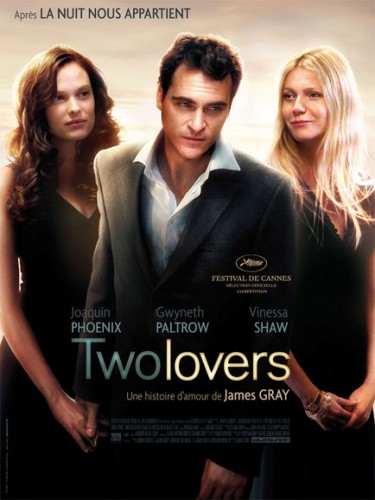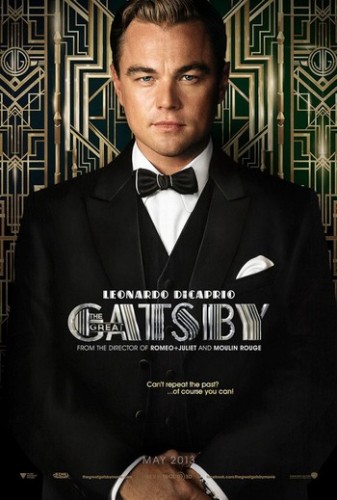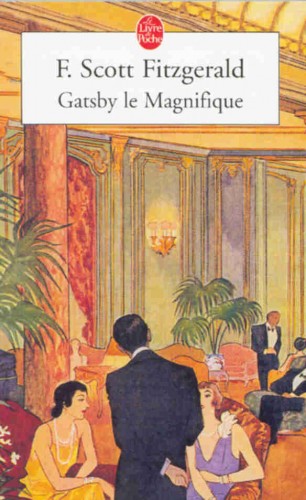CRITIQUE - THE IMMIGRANT de James Gray

Dans mon dossier publié dans le magazine des anciens élèves de l'ENA, "L'ENA hors les murs", de juillet/août 2013, à lire en cliquant ici, je vous parlais notamment de "The Immigrant" de James Gray (en salles le 27 nombre 2013), un de mes énormes coups de cœur de cette année cinématographique, le grand oublié du palmarès cannois. Retrouvez ma critique, ci-dessous et en bonus celles de "Two lovers" et "La Nuit nous appartient".
Projeté en compétition officielle du 66ème Festival de Cannes, The Immigrant de James Gray décidément à l’honneur cette année puisqu’il est aussi le coscénariste de Blood ties réalisé par Guillaume Canet (également présenté à Cannes) est, seulement, le cinquième long-métrage du cinéaste américain ( après Little Odessa, The Yards, La Nuit nous appartient, Two lovers) et nous avons bien du mal à le croire tant chacun de ses films précédents était déjà maîtrisé, et James Gray comptant, déjà, comme un des plus grands cinéastes américains contemporains. The Immigrant a apparemment déçu bon nombre de ses admirateurs alors que, au contraire, c’est à mon sens son film le plus abouti, derrière son apparente simplicité. Il s’agit en effet de son film le plus sobre, intimiste et épuré mais quelle maîtrise dans cette épure et sobriété!
On y retrouve les thèmes chers au cinéaste: l’empreinte de la Russie, l’importance du lien fraternel, le pardon mais c’est aussi son film le plus personnel puisque sa famille d’origine russe est arrivée à Ellis Island, où débute l’histoire, en 1923.
L’histoire est centrée sur le personnage féminin d’Ewa interprétée par Marion Cotillard. 1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New York. Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine et Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution. L’arrivée d’Orlando (Jeremy Renner), illusionniste et cousin de Bruno (Joaquin Phoenix), lui redonne confiance et l'espoir de jours meilleurs. Mais c'est sans compter sur la jalousie de Bruno...
James Gray a écrit le rôle en pensant à Marion Cotillard (très juste et qui aurait mérité un prix d’interprétation) qui ressemble ici à une actrice du temps du cinéma muet, au visage triste et expressif. The Immigrant est ainsi un mélo assumé qui repose sur le sacrifice de son héroïne qui va devoir accomplir un véritable chemin de croix pour (peut-être…) accéder à la liberté et faire libérer sa sœur. Les personnages masculins, les deux cousins ennemis, sont en arrière-plan, notamment Orlando. Quant à Bruno interprété par l’acteur fétiche de James Gray, Joaquin Phoenix, c’est un personnage complexe et mystérieux qui prendra toute son ampleur au dénouement et montrera aussi à quel point le cinéma de James Gray derrière un apparent manichéisme est particulièrement nuancé et subtil.
Le tout est sublimé par la photographie de Darius Khondji (qui avait d’ailleurs signé la photographie de la palme d’or du Festival de Cannes 2012, Amour de Michael Haneke) grâce à laquelle certains plans sont d’une beauté mystique à couper le souffle.
James Gray a par ailleurs tourné à Ellis Island, sur les lieux où des millions d’immigrés ont débarqué de 1892 à 1924, leur rendant hommage et, ainsi, à ceux qui se battent, aujourd’hui encore, pour fuir des conditions de vie difficiles, au péril de leur vie. C’est de dos qu’apparaît pour eux la statue de la liberté au début du film. C’est en effet la face sombre de cette liberté qu’ils vont découvrir, James Gray ne nous laissant d’ailleurs presque jamais entrevoir la lumière du jour. Si le film est situé dans les années 1920, il n’en est pas moins intemporel et universel. Une universalité et intemporalité qui, en plus de ses très nombreuses qualités visuelles, ne lui ont pas permis de figurer au palmarès cannois auquel il aurait mérité d’accéder.
Tout comme dans La Nuit nous appartient qui en apparence opposait les bons et les méchants, l’ordre et le désordre, la loi et l’illégalité, et semblait au départ très manichéen, dans lequel le personnage principal était écartelé, allait évoluer, passer de l’ombre à la lumière, ou plutôt d’un univers obscur où régnait la lumière à un univers normalement plus lumineux dominé par des couleurs sombres, ici aussi le personnage de Bruno au cœur qui a « le goût du poison », incarne toute cette complexité, et le film baigné principalement dans des couleurs sombres, ira vers la lumière. Un plan, magistral, qui montre son visage à demi dans la pénombre sur laquelle la lumière l’emporte peu à peu, tandis qu’Ewa se confesse, est ici aussi prémonitoire de l’évolution du personnage. L’intérêt de Two lovers provenait avant tout des personnages, de leurs contradictions, de leurs faiblesses. C’est aussi le cas ici même si le thème du film et la photographie apportent encore une dimension supplémentaire. James Gray s’est inspiré des photos « quadrichromes » du début du XXe siècle, des tableaux qui mettent en scène le monde interlope des théâtres de variétés de Manhattan. Il cite aussi comme référence Le Journal d’un curé de campagne, de Robert Bresson.
James Gray parvient, comme avec Two lovers, à faire d’une histoire a priori simple un très grand film d’une mélancolie d’une beauté déchirante et lancinante qui nous envahit peu à peu et dont la force ravageuse explose au dernier plan et qui nous étreint longtemps encore après le générique de fin. Longtemps après, en effet, j’ai été éblouie par la noirceur de ce film, une noirceur de laquelle émerge une lueur de clarté sublimée par une admirable simplicité et maitrise des contrastes sans parler du dernier plan, somptueux, qui résume toute la richesse et la dualité du cinéma de James Gray et de ce film en particulier.
Critique de TWO LOVERS de James Gray
Direction New York, ville fétiche du cinéma de James Gray, où, après avoir tenté de se suicider, un homme hésite entre suivre son destin et épouser la femme que ses parents ont choisie pour lui, ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine, belle, fragile et inconstante, dont il est tombé éperdument amoureux, un amour dévastateur et irrépressible.
L’intérêt de « Two lovers » provient avant tout des personnages, de leurs contradictions, de leurs faiblesses. Si James Gray est avant tout associé au polar, il règne ici une atmosphère de film noir et une tension palpable liée au désir qui s’empare du personnage principal magistralement interprété par Joaquin Phoenix avec son regard mélancolique, fiévreux, enfiévré de passion, ses gestes maladroits, son corps même qui semble crouler sous le poids de son existence, sa gaucherie adolescente.
Ce dernier interprète le personnage attachant et vulnérable de Leonard Kraditor (à travers le regard duquel nous suivons l’histoire : il ne quitte jamais l’écran), un homme, atteint d'un trouble bipolaire (mais ce n'est pas là le sujet du film, juste là pour témoigner de sa fragilité) qui, après une traumatisante déception sentimentale, revient vivre dans sa famille et fait la rencontre de deux femmes : Michelle, sa nouvelle voisine incarnée par Gwyneth Paltrow, et Sandra, la fille d’amis de ses parents campée par l’actrice Vinessa Shaw. Entre ces deux femmes, le cœur de Leonard va balancer…
Il éprouve ainsi un amour obsessionnel, irrationnel, passionnel pour Michelle. Ces « Two lovers » comme le titre nous l’annonce et le revendique d’emblée ausculte la complexité du sentiment amoureux, la difficulté d’aimer et de l’être en retour, mais il ausculte aussi les fragilités de trois êtres qui s’accrochent les uns aux autres, comme des enfants égarés dans un monde d’adultes qui n’acceptent pas les écorchés vifs. Michelle et Leonard ont, parfois, « l’impression d’être morts », de vivre sans se sentir exister, de ne pas trouver « la mélodie du bonheur ».
Par des gestes, des regards, des paroles esquissés ou éludés, James Gray dépeint de manière subtile la maladresse touchante d’un amour vain mais surtout la cruauté cinglante de l’amour sans retour qui emprisonne ( plan de Michelle derrière des barreaux de son appartement, les appartements de Leonard et Michelle donnant sur la même cour rappelant ainsi « Fenêtre sur cour » d’Hitchcock de même que la blondeur toute hitchcockienne de Michelle), et qui exalte et détruit.
James Gray a délibérément choisi une réalisation élégamment discrète et maîtrisée et un scénario pudique et la magnifique photographie crépusculaire de Joaquin Baca-Asay qui procurent des accents lyriques à cette histoire qui aurait pu être banale, mais dont il met ainsi en valeur les personnages d’une complexité, d’une richesse, d’une humanité bouleversantes. James Gray n’a pas non plus délaissé son sujet fétiche, à savoir la famille qui symbolise la force et la fragilité de chacun des personnages (Leonard cherche à s’émanciper, Michelle est victime de la folie de son père etc).
Un film d’une tendre cruauté, d’une amère beauté, et parfois même d'une drôlerie désenchantée, un thriller intime d’une vertigineuse sensibilité à l’image des sentiments qui s’emparent des personnages principaux, et de l’émotion qui s’empare du spectateur. Irrépressiblement. Ajoutez à cela la bo entre jazz et opéra ( même influence du jazz et même extrait de l’opéra de Donizetti, L’elisir d’amore, « Una furtiva lagrima » que dans le chef d’œuvre de Woody Allen « Match point » dans lequel on retrouve la même élégance dans la mise en scène et la même "opposition" entre la femme brune et la femme blonde sans oublier également la référence commune à Dostoïevski… : les ressemblances entre les deux films sont trop nombreuses pour être le fruit du hasard ), et James Gray parvient à faire d’une histoire a priori simple un très grand film d’une mélancolie d’une beauté déchirante qui nous étreint longtemps encore après le générique de fin. Trois ans après sa sortie : d’ores et déjà un classique du cinéma romantique.
Critique de LA NUIT NOUS APPARTIENT de James Gray
La nuit nous appartient. Voilà un titre très à-propos pour un film projeté en compétition officielle au Festival de Cannes. Cannes : là où les nuits semblent ne jamais vouloir finir, là où les nuits sont aussi belles et plus tonitruantes que les jours et là où les nuits s’égarent, délicieusement ou douloureusement, dans une profusion de bruits assourdissants, de lumières éblouissantes, de rumeurs incessantes. Parmi ces rumeurs certaines devaient bien concerner ce film de James Gray et lui attribuer virtuellement plusieurs récompenses qu’il aurait amplement méritées (scénario, interprétation, mise en scène...) au même titre que « My blueberry nights », mon grand favori, ou plutôt un autre de mes grands favoris du festival, l’un et l’autre sont pourtant repartis sans obtenir la moindre récompense…
Ce titre poétique (« We own the night » en vo, ça sonne encore mieux en Anglais non ?) a pourtant une source plus prosaïque qu’il ne le laisserait entendre puisque c’est la devise de l’unité criminelle de la police de New York chargée des crimes sur la voie publique. Ce n’est pas un hasard puisque, dans ce troisième film de James Gray ( « The Yards » son précèdent film avait déjà été projeté en compétition au Festival de Cannes 2000) qui se déroule à New York, à la fin des années 80, la police en est un personnage à part entière. C’est le lien qui désunit puis réunit trois membres d’une même famille : Bobby Green (Joaquin Phoenix), patron d’une boîte de nuit appartenant à des Russes, à qui la nuit appartient aussi, surtout, et qui représentent pour lui une deuxième et vraie famille qui ignore tout de la première, celle du sang, celle de la police puisque son père Burt (Robert Duvall) et son frère Joseph (Mark Walhberg) en sont tous deux des membres respectés et même exemplaires. Seule sa petite amie Amada (Eva Mendes), une sud américaine d’une force fragile, vulgaire et touchante, est au courant. Un trafic de drogue oriente la police vers la boîte détenue par Bob, lequel va devoir faire un choix cornélien : sa famille d’adoption ou sa famille de sang, trahir la première en les dénonçant et espionnant ou trahir la seconde en se taisant ou en consentant tacitement à leurs trafics. Mais lorsque son frère Joseph échappe de justesse à une tentative d’assassinat orchestrée par les Russes, le choix s’impose comme une évidence, une nécessité, la voie de la rédemption pour Bobby alors rongé par la culpabilité.
Le film commence vraiment dans la boîte de nuit de Bobby, là où il est filmé comme un dieu, dominant et regardant l’assemblée en plongée, colorée, bruyante, gesticulante, là où il est un dieu, un dieu de la nuit. Un peu plus tard, il se rend à la remise de médaille à son père, au milieu de la police de New York, là où ce dernier et son frère sont des dieux à leur tour, là où il est méprisé, considéré comme la honte de la famille, là où son frère en est la fierté, laquelle fierté se reflète dans le regard de leur père alors que Bobby n’y lit que du mépris à son égard. C’est avec cette même fierté que le « parrain » (les similitudes sont nombreuses avec le film éponyme ou en tout cas entre les deux mafias et notamment dans le rapport à la famille) de la mafia russe, son père d’adoption, regarde et s’adresse à Bobby. Le décor est planté : celui d’un New York dichotomique, mais plongé dans la même nuit opaque et pluvieuse, qu’elle soit grisâtre ou colorée. Les bases de la tragédie grecque et shakespearienne, rien que ça, sont aussi plantées et même assumées voire revendiquées par le cinéaste, de même que son aspect mélodramatique (le seul bémol serait d’ailleurs les mots que les deux frères s’adressent lors de la dernière scène, là où des regards auraient pu suffire...)
Les bons et les méchants. L’ordre et le désordre. La loi et l’illégalité. C’est très manichéen me direz-vous. Oui et non. Oui, parce que ce manichéisme participe de la structure du film et du plaisir du spectateur. Non, parce que Bobby va être écartelé, va évoluer, va passer de l’ombre à la lumière, ou plutôt d’un univers obscur où régnait la lumière à un univers normalement plus lumineux dominé par des couleurs sombres. Il va passer d’un univers où la nuit lui appartenait à un autre où il aura tout à prouver. Une nuit où la tension est constante, du début et la fin, une nuit où nous sommes entraînés, immergés dans cette noirceur à la fois terrifiante et sublime, oubliant à notre tour que la lumière reviendra un jour, encerclés par cette nuit insoluble et palpitante, guidés par le regard lunatique (fier puis désarçonné, puis déterminé puis dévasté de Joaquin Phoenix, magistral écorché vif, dont le jeu est d’ailleurs un élément essentiel de l’atmosphère claustrophobique du film). James Gray a signé là un film d’une intensité dramatique rare qui culmine lors d’une course poursuite d’anthologie, sous une pluie anxiogène qui tombe impitoyablement, menace divine et symbolique d’un film qui raconte aussi l’histoire d’une faute et d’une rédemption et donc non dénué de références bibliques. La scène du laboratoire (que je vous laisse découvrir) où notre souffle est suspendu à la respiration haletante et au regard de Bob est aussi d’une intensité dramatique remarquable.
« La nuit nous appartient », davantage qu’un film manichéen est donc un film poignant constitué de parallèles et de contrastes (entre les deux familles, entre l’austérité de la police et l’opulence des Russes,-le personnage d’Amada aussi écartelé est d’ailleurs une sorte d’être hybride, entre les deux univers, dont les formes voluptueuses rappellent l’un, dont la mélancolie rappelle l’autre- entre la scène du début et celle de la fin dont le contraste témoigne de la quête identitaire et de l’évolution, pour ne pas dire du changement radical mais intelligemment argumenté tout au long du film, de Bob) savamment dosés, même si la nuit brouille les repères, donne des reflets changeants aux attitudes et aux visages. Un film noir sur lequel plane la fatalité : fatalité du destin, femme fatale, ambiance pluvieuse. James Gray dissèque aussi les liens familiaux, plus forts que tout : la mort, la morale, le destin, la loi.
Un film lyrique et parfois poétique, aussi : lorsque Eva Mendes déambule nonchalamment dans les brumes de fumées de cigarette dans un ralenti langoureux, on se dit que Wong Kar-Wai n’est pas si loin... même si ici les nuits ne sont pas couleur myrtille mais bleutées et grisâtres. La brume d’une des scènes finales rappellera d’ailleurs cette brume artificielle comme un écho à la fois ironique et tragique du destin.
C’est épuisés que nous ressortons de cette tragédie, heureux de retrouver la lumière du jour, sublimée par cette plongée nocturne. « La nuit nous appartient » ne fait pas partie de ces films que vous oubliez sitôt le générique de fin passé (comme celui que je viens de voir dont je tairai le nom) mais au contraire de ces films qui vous hantent, dont les lumières crépusculaires ne parviennent pas à être effacées par les lumières éblouissantes et incontestables, de la Croisette ou d’ailleurs…