Critique - "Zero dark thirty" de Kathryn Bigelow (en salles ce mercredi)
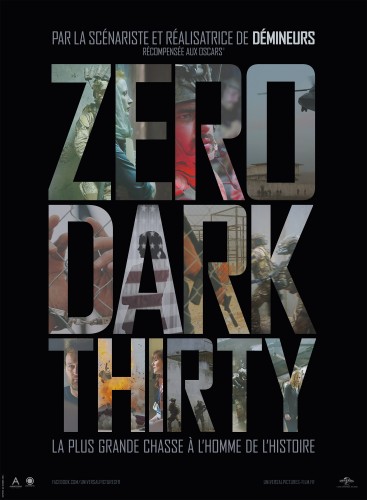
En 2009, Kathryn Bigelow remportait l’Oscar du meilleur film avec “Démineurs”. Elle est à nouveau nommée cette année, de retour avec son scénariste/producteur Mark Boal, avec « Zero dark thirty », dans pas moins de 5 catégories et à nouveau dans celle du meilleur film face à Argo, L’Odyssée de Pi, Lincoln, Django unchained. Mérite-t-elle cette récompense ?
« Zero dark thirty » raconte les dix années de traque qui aboutirent à la mort de Ben Laden et à le découvrir non pas terrée dans une grotte inaccessible comme le voulait la rumeur mais vivant confortablement dans une habitation fortifiée de la banlieue d’Abbottābād, au Pakistan, ce qui lui permettait de communiquer efficacement et facilement, et ainsi de transmettre ses ordres. C’est à travers les yeux de Maya (Jessica Chastain), agent de la CIA, que nous suivons cette traque depuis le 11 septembre 2001 jusqu’à Zero dark thirty (qui signifie 0H30 dans le langage militaire), heure à laquelle Ben Laden a été trouvé et tué, dix ans plus tard.
Reconnaissons au moins à Kathryn Bigelow l’intelligence de n’avoir pas fait de son film une fiction à la gloire des Etats-Unis s’achevant (forcément) par une bannière étoilée flottant insolemment et fièrement et alors que la sortie avait été repoussée les Républicains redoutant que le film ne soit à la gloire de l'administration Obama, à la veille des élections (ce qui est d'ailleurs très loin d'être le cas). Pour le reste, rarement un film m’aura inspiré une telle indifférence, ce qui est sans doute étonnant au regard de la polémique suscitée par le film (Kathryn Bigelow est accusée de faire l’apologie de la torture puisque celle-ci ici est ouvertement montrée et permet d’obtenir des informations cruciales). Au contraire, j’ai plutôt eu l’impression qu’elle se glorifiait d’oser l’aborder tout en se justifiant en montrant tout de même que l'agent Dan (Jason Clarke) qui menait ces actes de tortures et y initie en quelque sorte Maya finit par quitter le terrain des opérations pour Washington, subitement las de cette torture qui semblait d’ailleurs à aucun moment auparavant ne lui poser problème. Dans le même temps, elle montre bien que les agents de la CIA sont davantage motivés par leur avancement que la gloire de la patrie et qu’ils sont dotés d’un cynisme redoutable : « Faites votre boulot et amenez moi des gens à tuer » dit ainsi George (Mark Strong), chef des divisions d’antiterrorisme d’Afghanistan et du Pakistan. Quelle courageuse, cette Kathryn Bigelow.
Elle revendique par ailleurs de ne pas faire de psychologie, mais de là à créer des personnages aux motivations totalement opaques, il y a un fossé qu’elle a allègrement franchi. Jessica Chastain, sans doute très bonne actrice par ailleurs, a ici deux expressions à son actif (l'abattement et la détermination) et passe de l’une à l’autre de manière complètement incompréhensible et injustifiée. Son Golden Globe et sa nomination comme meilleure actrice aux Oscars demeurent un mystère pour moi. On ne comprend jamais pourquoi elle s’investit à ce point et encore moins (parait-il en partie pour protéger la personne qui a inspiré le rôle mais alors pourquoi dans ce cas ne pas avoir opté pour de la fiction pure ou au contraire pour le documentaire) pourquoi en un quart de seconde elle semble passer de la terreur devant la torture à la résignation puis à son adoption. On ne comprend JAMAIS ses motivations, ni son changement de caractère.
Kathryn Bigelow, elle-même, semble constamment hésiter entre l’œuvre exigeante basée sur des informations réelles, un vrai travail de recherche et les concessions à un film divertissant destiné au plus grand nombre (le film fait d’ailleurs un carton au box office américain). Preuve en sont ces dernières minutes dans l’habitation de Ben Laden à Abbottabad filmées avec un minimum de lumière par une caméra très sensible, l’Alexa qui, comme Kathryn Bigelow l’a elle-même expliqué, « donne aux images une texture unique qui ne s’apparente ni à du 35 mm ni à du numérique. La netteté n’est pas parfaite, le rendu est un peu grenu, mais avec une large échelle de couleurs qui permet une image dense, saturée et riche". En émane un sentiment de réalisme et en résulte une scène plutôt réussie dont les effets sont totalement annihilés lorsqu’un des Seals (agents du Raid) appelle « Oussama » pour le faire sortir de sa cachette, ce qui a d’ailleurs suscité l’hilarité d’une partie de la salle. Le dernier plan, en pleine lumière, qui répond à l’obscurité ( et la noirceur) du début du film nous laisse aussi décontenancés et perdus que celle qui a consacré dix ans de sa vie à un but enfin atteint.
Ce film ne m’a pas ailleurs rien appris que je ne savais déjà, ne m’a même pas ennuyé, m’a simplement laissé indifférente (ce qui est pire que tout). Finalement, on ne sait jamais ce que Kathryn Bigelow souhaite dire, dénoncer, montrer et quel est sont point de vue, elle-même paraissant constamment écartelée entre le désir de susciter l’intérêt du plus grand monde et le souci de véracité, faisant finalement des concessions aux uns et aux autres et aboutissant à cette œuvre tiède et sans personnalité.
La musique du compositeur français Alexandre Desplat et le « plaisir » de retrouver le talentueux comédien français Reda Kateb dans le rôle (particulièrement difficile) d’Ammar ne m’auront pas sortie de ma léthargie.
Vous l’aurez compris : ma préférence va largement à « Django unchained » de Tarantino et plus encore à « Lincoln » de Spielberg pour cet Oscar du meilleur film à côté duquel cette polémique certes biaisée devrait faire passer Kathryn Bigelow, si l’absence de qualités de ce film sans âme et finalement dénué de réel point de vue (d’où la polémique qui fait que chacun a sa propre interprétation, celle que veut donner la réalisatrice/scénariste du film étant particulièrement floue) n’y suffisent pas.
Sortie en salles : le 23 janvier 2013



