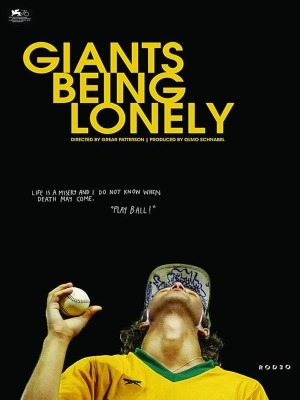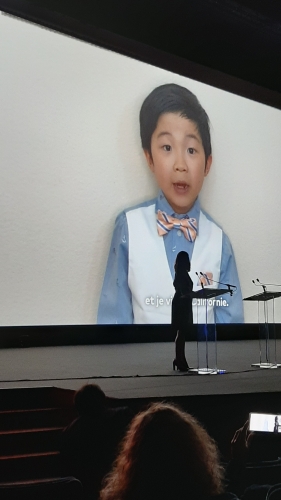« Un bon film est un film qui a un point de vue sur le monde et un point de vue sur le cinéma » selon François Truffaut. Les deux films projetés dans le cadre du Festival du Cinéma Américain de Deauville dont j’ai choisi de vous parler aujourd’hui, deux films de la sélection de Cannes 2020, reflétaient en tout cas indéniablement un point de vue sur le monde. Sur notre monde, ou plutôt sur la vision effroyable de ce qu’il est en train de devenir dans un avenir plus ou moins proche. Le premier a glacé l'assemblée tant la résonance était terriblement forte avec la crise que nous traversons. Le second a fait déferler une inhabituelle vague de rires dans la majestueuse salle du CID.
Adapté de « Mes derniers mots » de Santiago Amigorena, « Last words » de Jonathan Nossiter nous propulse ainsi en juin 2086. Face caméra, un homme nous déclare être le dernier humain sur terre, laquelle Terre n’est alors plus qu’un immense désert. Il nous raconte alors comment les derniers survivants s’étaient retrouvés à Athènes, appelés par un ultime espoir...Ce dernier homme sur terre, un jeune homme qui ne connaît pas son prénom, dans un Paris dévasté, découvre des pellicules de la Cineteca de Bologne. Il décide de partir pour la ville italienne. Dans ce monde hostile, dénué d'humanité ou même de lueur de vie, un vieil homme se terre au milieu de ses bobines et ce qu’il reste des affiches de films, entre Mastroianni, Barry Lindon, le Guépard comme les derniers vestiges d’un monde disparu. Avec un projecteur à pédales, il fait découvrir le cinéma au jeune homme, d'abord légèrement effrayé comme le furent les premiers spectateurs de L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat puis bientôt fasciné. Tous deux partent pour Athènes, où survivent les ultimes êtres humains.
Après tout, si un espoir existe, c’est probablement au pied de l’Acropole, en ce lieu symbolique de la démocratie dans une des plus vieilles villes du monde. « Vert, vert » crient les nouveaux arrivants comme des navigateurs égarés auraient autrefois crié « terre, terre ». Dans ce monde oppressant, sur cette terre décharnée, inhospitalière, jonchée de carcasses, menacée par une mer rougeoyante comme ensanglantée, la végétation a en effet disparu et cette lande de verdure apparaît comme un espoir providentiel. Là comme ailleurs, on ne se nourrit néanmoins que de cannettes et la nourriture telle que nous la connaissons n'est désormais plus qu'une étrangeté figée sur pellicule.
Thierry Frémaux a présenté le film comme « un film d'auteur qui a l'humour du désespoir ». « Le fait que vous soyez là donne de l'espoir. Ne pas être ensemble est la chose la plus terrifiante » a également déclaré Jonathan Nossiter lors de la présentation. « On se souviendra que c'est le moment où on s'est tous reréunis au cinéma » a conclu Thierry Frémaux.
Comment, en effet, ne pas établir un parallèle édifiant, suffocant, dramatiquement ironique entre ces derniers humains qui disparaissent en raison d’une pandémie et la situation à laquelle nous sommes confrontés ? Dans ce monde apocalyptique, le cinéma devient l’ultime joie, soudain plus « vivant » que la réalité devenue un champ de ruines dans lequel n’existent plus ni plaisir ni émotion, permettant à ceux qui y évoluent de redevenir des hommes dotés d’humanité, d’expressions. « Rêver la beauté du cinéma avant de mourir ». Tel est le dernier souhait du vieil homme. Si nous savions le cinéma indispensable, ici il pourrait même presque sauver le monde…
Le réalisateur de « Mondovino », lui-même devenu agriculteur en Italie où il cultive des légumes en permaculture, par cette fable, nous alerte sur une montée des périls sur laquelle il nous incombe de ne pas fermer les yeux comme d'autres en 1939 n'ont pas su ou voulu voir planer un autre danger.
On en ressort avec un sentiment de malaise, la conscience accrue de l’urgence et de la menace, imminente, et l’envie de s’abreuver plus que jamais à cette source de plaisirs, de joie, de rires, bref d’émotions et de vie : le cinéma !

« Les deux Alfred » de Bruno Podalydès évoque un avenir beaucoup plus proche dans lequel le cinéma ne sauve pas le monde mais dans lequel les mots (anglicismes et acronymes) et l’uberisation de la société font courir à leur perte ou du moins à l’égarement ceux qui s’y débattent.
« J'en suis fou. Il est représentatif de la forte présence et du grand talent des comédiens français. Quelque chose d'une âme fraternelle masculine passe dans ce film » a déclaré Thierry Frémaux lors de la présentation.
Là aussi il est question de déshumanisation. Alexandre (Bruno Podalydès), chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme partie en mission dans un sous-marin qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Seulement, « The Box », la start-up qui veut l'employer à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant ». Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... ». Dans cette startup, même l’intitulé de son travail et de sa fonction sont absconses sans parler de son pdg, sorte d’adolescent attardé éthéré qui sous des dehors décontractés à l'outrance et jusqu'au ridicule mène son petit monde de manière tyrannique. Sa rencontre avec Arcimboldo (Denis Podalydès), « entrepreneur de lui-même » qui multiplie les petits boulots sur appli pourrait bien aider Alexandre…Ajoutez à ce duo Séverine, une supérieure survoltée incarnée par Sandrine Kiberlain et vous obtiendrez un trio irrésistible qui se débat dans un monde de plus en plus absurde qui, comme ans « The Assistant » dont je vous parlais hier, aurait pu être croqué par Jacques Tati.
La première scène entre Alexandre et son banquier donne le ton de cette comédie : tendre, mordante, décalée, aux dialogues ciselés. Tous trois sont finalement à leur manière enfermés dans leurs « box ». Séverine, elle, est dépendante d’une voiture sans chauffeur qui dicte sa loi et dont la reconnaissance faciale ne fonctionne plus.
Les deux Alfred éponymes, ce sont deux doudous, qui ne peuvent vivre l’un sans l’autre, deux peluches qui ressemblent à des pantins désarticulés et attachants à l’image des protagonistes du film. Attachants aussi comme ce film qui vous donne envie de croquer la vie sur un air de claquettes ou de Jean Ferrat. Dans lequel la magie du cinéma nous fait croire qu’un slow peut surgir d’une voiture en pleine rue et rapprocher deux êtres qui semblaient si dissemblables.
Dans cette comédie irrésistible à la fantaisie réjouissante, Bruno Podalydès porte un regard à la fois doux et acéré sur l’absurdité de notre société. Un monde à la liberté illusoire dans lequel l’apparence prévaut.
Il y a peu, je vous rappelais cette citation de Tennessee Williams dans « Un tramway nommé désir » : « Je ne veux pas du réalisme. Je veux de la magie ». Espérons que cette journée de festival nous emportera aussi dans un tourbillon de magie, sur les écrans et sur les planches deauvillaises, pour nous faire oublier, un temps, suspendu, le vacarme assourdissant de la réalité.
À suivre...