« Frankie » de Fabienne Berthaud : le miroir à deux faces
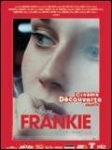 Frankie a 26 ans. Frankie est mannequin. Son travail exige d’elle qu’elle renvoie une image lisse et parfaite, qu’elle ne laisse entrevoir ni la fragilité ni les fêlures qu’elle dissimule. Oui, Frankie est mannequin, pas un top model qui parcourt le monde mais un mannequin en fin de carrière comme il y en a des milliers d’autres, qui erre d’hôtels médiocres en studios, en bars moroses où, esseulée, elle laisse tomber le masque, et n’en a plus que faire. L’image elle aussi s’est fissurée : plus vraiment belle, plus vraiment jeune selon des critères plus cruels dans son métier qu’ailleurs, où les stigmates du temps, si imperceptibles pourtant, ennemi impitoyable et invincible, sont inexcusables. Seule, surtout. Quand l’image se craquelle, il faut sourire avec plus d’entrain encore, dire bonjour avec plus d’enthousiasme, feindre avec un talent démultiplié. Seulement Frankie n’a plus envie. Elle a perdu l’envie d’avoir envie. L’envie de cacher l’être blessé par un paraître irréprochable. N’être qu’un corps qu’on voit sans le regarder devient insupportable. Frankie (Diane Krüger d’une touchante fragilité) est à fleur de peau, dans cet état où un seul mot prononcé ou oublié, un seul geste déplacé peuvent faire basculer et dériver. Au départ le film est un peu comme cet univers dans lequel elle se perd, celui de faux semblant : superficiel, détaché de nous, lointain comme une image de papier glacé ( l’image du film, très réaliste, est d'ailleurs délibérément ici très éloignée d’une image de papier glacé) puis peu à peu sa solitude, son mal être s’emparent subrepticement de nous grâce à un montage savamment déstructuré et chaotique à l’image de celle dont il reflète l’égarement. Les images de sa décadence se mêlent à celles de son séjour en hôpital psychiatrique. La poésie ne vient pas suffisamment de là où on l’attend. La poésie du désenchantement. Une jolie forme de politesse. Celle d’un ange aux ailes brisées. Elle s’égare, elle vacille comme la caméra de Fabienne Berthaud dont c’est ici le premier long métrage, aux allures de faux documentaire. C’est un film imparfait, mais c’est justement cette imperfection qui le distingue et l’enrichit. Il laisse entrevoir ses fêlures, il se met à nu comme celle qu’il immortalise. Comme si Dorian Gray et son portrait se côtoyaient. Sauf qu’ici ce que dissimule le masque est peut-être finalement plus beau que le masque lui-même ; surtout si un regard bienveillant se pose dessus, comme celui de Tom que je vous laisse découvrir… Finalement dériver permet peut-être de mieux retrouver son chemin ? Il faut parfois avoir le courage de sombrer, de se montrer chancelant pour mieux refaire surface, revenir sans un masque en trompe l’œil, pour que les autres regards n’effleurent pas seulement mais voient réellement. Et savoir ainsi à nouveau admirer le bleu du ciel ou retrouver les ailes d’un ange. Un film cruel et poétique. Mélancolique et drôle. Comme les deux faces d'un même visage. Une fin qui justifie les moyens et qui mérite d’être attentif jusqu’au bout, de ne pas nous aussi céder à la tyrannie du temps, de ne pas nous aussi zapper ce qui n’est pas lisse, immédiat, formaté comme nous y sommes trop souvent habitués et encouragés. La fissure en dit peut-être plus que le masque. Oui, Frankie est mannequin mais elle porte le masque et dissimule les blessures de chacun de nous…
Frankie a 26 ans. Frankie est mannequin. Son travail exige d’elle qu’elle renvoie une image lisse et parfaite, qu’elle ne laisse entrevoir ni la fragilité ni les fêlures qu’elle dissimule. Oui, Frankie est mannequin, pas un top model qui parcourt le monde mais un mannequin en fin de carrière comme il y en a des milliers d’autres, qui erre d’hôtels médiocres en studios, en bars moroses où, esseulée, elle laisse tomber le masque, et n’en a plus que faire. L’image elle aussi s’est fissurée : plus vraiment belle, plus vraiment jeune selon des critères plus cruels dans son métier qu’ailleurs, où les stigmates du temps, si imperceptibles pourtant, ennemi impitoyable et invincible, sont inexcusables. Seule, surtout. Quand l’image se craquelle, il faut sourire avec plus d’entrain encore, dire bonjour avec plus d’enthousiasme, feindre avec un talent démultiplié. Seulement Frankie n’a plus envie. Elle a perdu l’envie d’avoir envie. L’envie de cacher l’être blessé par un paraître irréprochable. N’être qu’un corps qu’on voit sans le regarder devient insupportable. Frankie (Diane Krüger d’une touchante fragilité) est à fleur de peau, dans cet état où un seul mot prononcé ou oublié, un seul geste déplacé peuvent faire basculer et dériver. Au départ le film est un peu comme cet univers dans lequel elle se perd, celui de faux semblant : superficiel, détaché de nous, lointain comme une image de papier glacé ( l’image du film, très réaliste, est d'ailleurs délibérément ici très éloignée d’une image de papier glacé) puis peu à peu sa solitude, son mal être s’emparent subrepticement de nous grâce à un montage savamment déstructuré et chaotique à l’image de celle dont il reflète l’égarement. Les images de sa décadence se mêlent à celles de son séjour en hôpital psychiatrique. La poésie ne vient pas suffisamment de là où on l’attend. La poésie du désenchantement. Une jolie forme de politesse. Celle d’un ange aux ailes brisées. Elle s’égare, elle vacille comme la caméra de Fabienne Berthaud dont c’est ici le premier long métrage, aux allures de faux documentaire. C’est un film imparfait, mais c’est justement cette imperfection qui le distingue et l’enrichit. Il laisse entrevoir ses fêlures, il se met à nu comme celle qu’il immortalise. Comme si Dorian Gray et son portrait se côtoyaient. Sauf qu’ici ce que dissimule le masque est peut-être finalement plus beau que le masque lui-même ; surtout si un regard bienveillant se pose dessus, comme celui de Tom que je vous laisse découvrir… Finalement dériver permet peut-être de mieux retrouver son chemin ? Il faut parfois avoir le courage de sombrer, de se montrer chancelant pour mieux refaire surface, revenir sans un masque en trompe l’œil, pour que les autres regards n’effleurent pas seulement mais voient réellement. Et savoir ainsi à nouveau admirer le bleu du ciel ou retrouver les ailes d’un ange. Un film cruel et poétique. Mélancolique et drôle. Comme les deux faces d'un même visage. Une fin qui justifie les moyens et qui mérite d’être attentif jusqu’au bout, de ne pas nous aussi céder à la tyrannie du temps, de ne pas nous aussi zapper ce qui n’est pas lisse, immédiat, formaté comme nous y sommes trop souvent habitués et encouragés. La fissure en dit peut-être plus que le masque. Oui, Frankie est mannequin mais elle porte le masque et dissimule les blessures de chacun de nous…
Sandra.M



 Avec La Bûche, Danièle Thompson et Christopher Thompson , son co-scénariste (également pour Décalage horaire et pour Fauteuils d’orchestre) avaient, selon moi, réussi le film choral parfait dans lequel chaque personnage a un rôle d’égale importance, dans lequel chaque personnage constitue un rouage indispensable de l’intrigue ou plutôt des intrigues, dans lequel chaque personnage et chaque intrigue se suivent avec un intérêt égal, avec un dénouement reliant les fils de ces destins blessés, un brillant divertissement au sens noble du terme. Je m’attendais donc à une impression similaire avec Fauteuils d’orchestre, précédé d’un bouche à oreille favorable.
Avec La Bûche, Danièle Thompson et Christopher Thompson , son co-scénariste (également pour Décalage horaire et pour Fauteuils d’orchestre) avaient, selon moi, réussi le film choral parfait dans lequel chaque personnage a un rôle d’égale importance, dans lequel chaque personnage constitue un rouage indispensable de l’intrigue ou plutôt des intrigues, dans lequel chaque personnage et chaque intrigue se suivent avec un intérêt égal, avec un dénouement reliant les fils de ces destins blessés, un brillant divertissement au sens noble du terme. Je m’attendais donc à une impression similaire avec Fauteuils d’orchestre, précédé d’un bouche à oreille favorable.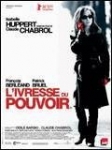 et donc de la sacralisation intéressée de la parole de la télévision dans la production cinématographique française ? Toujours est-il que le cinéma français devient de plus en plus frileux, académique, convenu, uniformisé. Quand on sait que des cinéastes aussi talentueux que Téchiné peinent aujourd’hui à être produits, il y a de quoi être désabusée et/ou révoltée. Que les fictions de TF1 soient toutes construites sur le même modèle pour un public lui aussi être censé toujours construit sur le même modèle et selon les même goûts peut être compréhensible, pas forcément cautionné mais compréhensible, en revanche quand la frilosité se remarque aussi chez des cinéastes auparavant connus pour leur inventivité, leur anticonformisme, leur salutaire ironie, je ne peux m’empêcher d’être déçue. Tel était le cas de Claude Chabrol, cinéaste pourtant parmi les premiers de mon panthéon cinématographique, dont l’air débonnaire avait pour habitude de masquer des films noirs, cyniques, miroirs impitoyables d’une bourgeoisie auscultée avec une froide ironie et une jubilatoire impertinence.
et donc de la sacralisation intéressée de la parole de la télévision dans la production cinématographique française ? Toujours est-il que le cinéma français devient de plus en plus frileux, académique, convenu, uniformisé. Quand on sait que des cinéastes aussi talentueux que Téchiné peinent aujourd’hui à être produits, il y a de quoi être désabusée et/ou révoltée. Que les fictions de TF1 soient toutes construites sur le même modèle pour un public lui aussi être censé toujours construit sur le même modèle et selon les même goûts peut être compréhensible, pas forcément cautionné mais compréhensible, en revanche quand la frilosité se remarque aussi chez des cinéastes auparavant connus pour leur inventivité, leur anticonformisme, leur salutaire ironie, je ne peux m’empêcher d’être déçue. Tel était le cas de Claude Chabrol, cinéaste pourtant parmi les premiers de mon panthéon cinématographique, dont l’air débonnaire avait pour habitude de masquer des films noirs, cyniques, miroirs impitoyables d’une bourgeoisie auscultée avec une froide ironie et une jubilatoire impertinence.